LES PLAISIRS
DE LA TABLE
« Dans le livre VIII de la République, Platon est encore le premier à justifier ce célèbre principe énoncé par les Épicuriens :
« Il y a des plaisirs naturels et nécessaires, d'autres naturels et non nécessaires et d'autres encore non naturels et non nécessaires. »
Il écrit encore :
« Le désir de manger, tout au moins dans la mesure où la santé et l'entretien de la force physique le nécessitent, bref ce désir de s'alimenter tout bonnement, n'est-il point indispensable à la gent humaine ? Oui, le désir de se restaurer est nécessaire pour deux raisons : parce qu'il est utile et parce que, sans lui, on ne pourrait guère subsister. »
— Oui.
— Même chose en ce qui concerne les assaisonnements, pourvu qu'il contribue à maintenir nos forces. »
— Parfaitement. -
Mais le désir qui se galvaude et se porte sur des mets plus raffinés, désir qui, par ailleurs, peut s'évacuer de nous-même si nous avons pris soin de le réprimer dès l'enfance grâce à l'éducation, ce désir détestable à notre organisme, tout aussi nocif pour l'âme sous l'angle de la modération, ne devrions-nous pas le qualifier avec justesse de superflu ?
— C'est tout à fait vrai, je le conçois ! »
Athénée de Naucratis,
Du Luxe, Livre XII des Deipnosophistes,

L'ambassade auprès d'Achille
Homère,
L’Iliade, chant IX
« Les deux ambassadeurs suivirent le bord de la mer retentissante, priant instamment Celui qui soutient et ébranle la terre de leur faire convaincre l’âme orgueilleuse de l’Éacide. Ils arrivèrent aux barques et aux vaisseaux des Myrmidons, et trouvèrent Achille charmant son âme avec la lyre au son clair, belle, bien ouvrée, garnie en haut d’une traverse d’argent, qu’il avait prise parmi les dépouilles, quand il détruisit la ville d’Éétion. Avec cette lyre, il charmait son cœur et chantait les exploits des guerriers. Patrocle seul était assis devant lui, en silence, attendant que l’Éacide eût fini de chanter. Les deux ambassadeurs s’avancèrent, le divin Ulysse le premier, et s’arrêtèrent devant lui. Surpris, Achille se leva, la lyre encore à la main, laissant le siège où il était assis ; et, comme lui, Patrocle, voyant ces visiteurs, se leva. Avec un geste d’accueil, Achille aux pieds rapides leur dit :
« Salut ; certes vous êtes les bienvenus. Sans doute une nécessité vous amène. Malgré ma colère, vous êtes ceux des Achéens que j’aime le mieux. »
Ayant ainsi parlé, le divin Achille les fit avancer, et asseoir sur des chaises longues aux tapis de pourpre. Puis il dit à Patrocle qui était près de lui :
“ Installe, fils de Ménoetios, un cratère plus grand ; fais un mélange plus fort et prépare une coupe pour chacun. Car les hommes que j’aime le mieux se trouvent sous mon toit. ”
Il dit, et Patrocle obéit à son compagnon. Puis il tira vivement un grand étal à la lueur du feu, y mit le dos d’un mouton et d’une chèvre grasse, et une belle échine de porc, brillante de graisse. Automédon lui tenait les viandes, et le divin Achille les dépeçait ; il les coupait habilement et les embrochait, tandis que le fils de Ménoetios, homme semblable à un dieu, allumait un grand feu. Quand le feu fut tombé, la flamme éteinte, ayant étalé la braise, il étendit les broches au-dessus ; puis il les saupoudra de sel sacré, en les soulevant de leurs chenets.
Les viandes cuites et versées dans des plats, Patrocle prit le pain et le distribua autour de la table, dans de belles corbeilles ; et Achille servit les viandes. Il s’assit en face du divin Ulysse, contre le mur opposé ; et l’offrande aux dieux, il la fit faire par Patrocle, son compagnon, qui jeta dans le feu les prémices. Les convives tendirent les mains vers les mets préparés et servis ; puis, quand ils eurent satisfait la faim et la soif, Ajax fit signe à Phénix. Le divin Ulysse s’en aperçut, et, remplissant sa coupe de vin, il la leva en l’honneur d’Achille :
“ Salut, Achille. Le repas où tous sont égaux ne nous a pas manqué, ni dans la baraque d’Agamemnon l’Atride, ni, maintenant, ici : car les mets qui convenaient, en abondance, vous nous les avez servis. Mais les repas agréables ne nous importent pas. Un malheur trop grand, ô nourrisson de Zeus, attire nos regards et nous effraie ; nous ne savons si nous sauverons ou si nous perdrons les vaisseaux bien charpentés, à moins que tu ne revêtes ta vaillance. Car près des navires et du rempart ont établi leur camp les Troyens fougueux, et leurs alliés des pays lointains ; ils ont allumé beaucoup de feux dans leurs lignes, et prétendent qu’on ne les arrêtera plus, et qu’ils tomberont sur les vaisseaux noirs. ”[…] »
Au fil des temps…
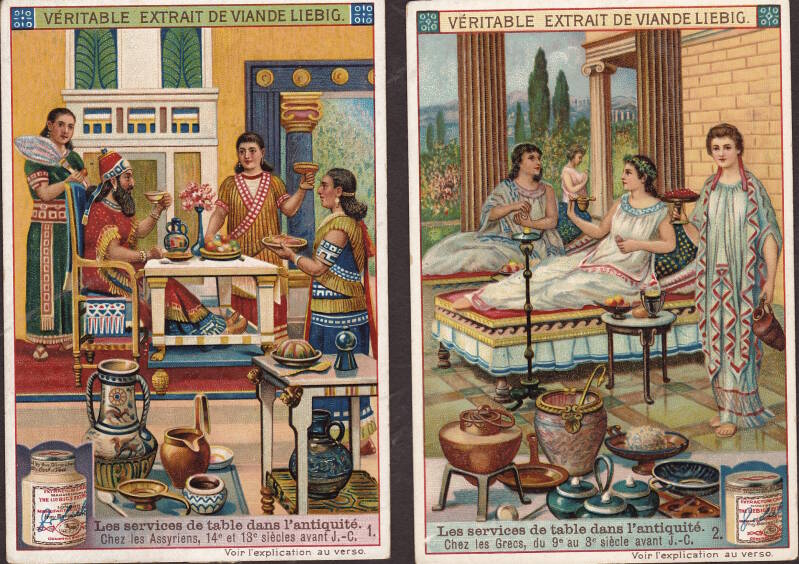
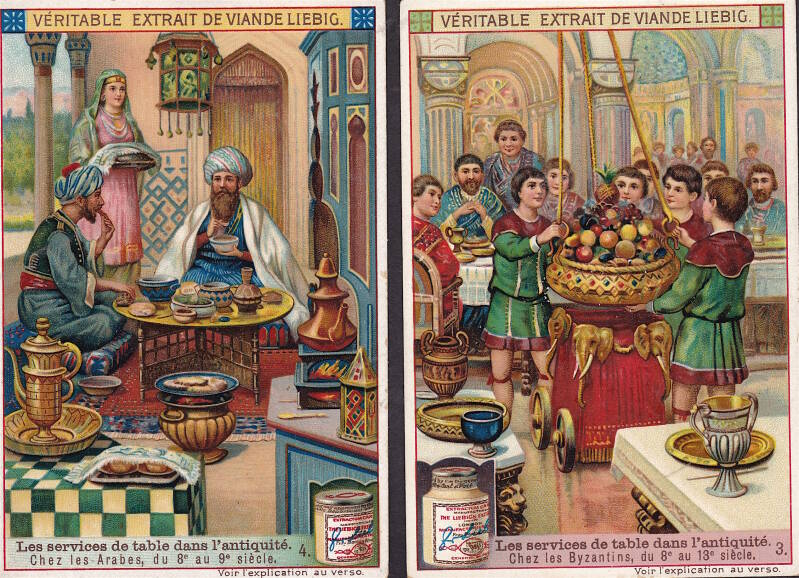

Coll. A. P.-R.
Un hôte divin…
John Milton
Paradis Perdu, V
« Raphaël s’avançait à travers la forêt parfumée ;
Adam l’aperçut ; il était assis à la porte
De son frais berceau, tandis que le soleil à son sommet
Dardait tout droit ses rayons brûlants pour échauffer
La terre jusqu’en ses entrailles, chaleur plus forte qu’Adam ne réclamait ;
Á l’intérieur Ève, exacte à son heure, préparait
Des fruits savoureux, d’un goût à plaire
Au véritable appétit et à ne pas ôter, par intervalles, la soif
D’un breuvage de nectar venant de l’onde limpide,
De la baie ou de la grappe. Adam appelle Eve :
— Hâte-toi ici, Eve, contemple une chose digne de ta vue ;
Á l’orient, entre ces arbres, quelle forme resplendissante
S’avance de ce côté ; on dirait une autre aurore
Levée à midi. Ce messager nous apporte peut-être
Quelque grand commandement du Ciel et daignera
Ce jour être notre hôte. Mais dépêche-toi
Et ce que contiennent tes réserves, apporte-le ; prodigue
L’abondance convenable pour honorer et recevoir
Notre divin étranger. Nous pouvons bien offrir
Leurs dons à nos donateurs, et accorder largement
Ce qui nous est largement accordé, ici où la nature multiplie
Sa fertile production et en s’en débarrassant devient
Plus féconde, ce qui nous enseigne à ne point épargner. —
Eve lui répond : — Adam, moule sanctifié de la terre,
Auquel Dieu a insufflé la vie, peu de provisions sont nécessaires là où ces provisions,
En toutes les saisons mûrissent, suspendues à la branche pour l’usage,
Excepté des fruits qui, dans une réserve frugale, acquièrent consistance
Pour nourrir et perdent une humidité superflue.
Mais je vais me hâter, et de chaque rameau et de chaque tige,
De chaque plante et de chaque courge juteuse, je vais recueillir un tel choix
Pour traiter notre hôte angélique qu’en le voyant
Il avouera qu’ici sur la terre
Dieu a répandu ses dons comme dans le ciel. —
Elle dit et avec des regards empressés part à la hâte,
Préoccupée de pensées hospitalières.
Comment choisir ce qu’il y a de plus délicat ?
Quel ordre disposer pour ne pas mêler les goûts ?
Pour bien les assortir et avec élégance, pour relever
Goût après goût par le changement le plus agréable ?
Eve s’active, et de chaque tendre tige
Elle cueille ce que la terre, cette mère qui porte tout, donne
Dans l’Inde orientale ou occidentale, sur les rivages
Du Pont ou de la côte punique, sur les bords
Qui virent régner Alcinoüs ; fruits de toutes espèces
D’écorce raboteuse ou de peau unie, renfermés dans une bogue ou dans une coquille ;
Large tribut qu’Eve recueille et sur la table
Amoncelle d’une main prodigue. Pour boisson
Elle exprime la grappe, moût inoffensif, et le jus
De différentes baies, et de douces amandes pressées
Elle mélange une crème onctueuse ; et pour contenir ces boissons
Elle ne manque point de vases convenables et purs. Puis elle sème la terre
De roses et de parfums de plantes que le feu n’a point exhalés. »
Nostalgie gastronomique
Jean Maillart,
Le Roman du comte d’Anjou
Ayant dû quitter le château familial, pour fuir un père incestueux, la comtesse d’Anjou trouve asile dans une humble maison paysanne. Le modeste repas qui lui est offert la confronte aux souvenirs des fastueux apprêts auxquels elle était habituée…
« Hélas, dolente
Une telle vie pas apprise je ne l’avais
Quand chez mon père on m’amenait
Mes viandes chères et fines,
Chapons en rôt, oisons, gélines,
Cygnes, paons, perdrix, faisans,
Hérons, butors, qui sont plaisants,
Et venaisons de maintes guises
Á chiens courants par force prises :
Cerfs, daims, connins, sangliers sauvages,
Qui habitent en ces bocages,
Et toute bonne venaison ;
Poissons j’en avais à foison,
Des meilleurs de tout le pays :
Esturgeons, saumons et plies,
Congres, gournars et grandes morues,
Tombes, rougets et grandes barbues,
Maquereaux gras et gros merlans
Et harengs frais et éperlans,
Sartres grasses, mulets et soles,
Brêmes et bescuits et moules ;
J’avais de maintes manières
Poissons d’étangs et de rivières
Atournés chacun par grande cure
Selon son droit et sa nature,
Au poivre, à la sauce cameline ;
J’avais lus en galentine,
Grosses lamproies à cela même,
Bars et carpes, gardons et brêmes,
Appareillés en autres guises ;
Truites j’avais, en pâtés mises,
Les dars, les vendoises rôties,
En verjus de grain enfouies,
Et grosses anguilles en pâte,
Ou bien encore rôties en hâte
Et les gros becqués chaudumés
Comme sont de les faire accoutumés
Les queux qui savent les sentences
Pour les préparer… »
De la primauté de la bonne chère
Grimod de La Reynière,
Avantages de la bonne chère sur les femmes,
discours d’un vrai gourmand, 1870
« Posons les principes : vous conviendrez d’abord, messieurs, que les plaisirs que procure la bonne chère sont ceux que l’on connaît le plus tôt, qu’on quitte le plus souvent. Or, pourriez-vous en dire autant des autres ?
Est-il une femme, tant jolie que vous la supposiez, eût-elle la tête de Mme Récamier, le port de Mlle Georges Weimer, les grâces enchanteresses de Mme Henry Belmont, l’éclat et l’appétissant embonpoint de Mlle Émilie Contat, la bouche et le sourire de Mlle Arsène, etc., qui puisse valoir ces admirables perdrix de Cahors, du Languedoc et des Cévennes, dont le fumet divin l’emporte sur tous les parfums de l’Arabie ? La mettrez-vous en parallèle avec ces pâtés de foie d’oie ou de canards auxquels les villes de Strasbourg, de Toulouse et d’Auch doivent la meilleure partie de leur célébrité ? Qu’est-elle donc auprès de ces langues fourrées de Troyes, de ces mortadelles de Lyon, de ce fromage d’Italie de Paris et de ces saucissons d’Arles ou de Bourgogne, qui ont acquis tant de gloire à la personne du cochon ? Pouvez-vous mettre un joli petit minois bien fardé, bien grimacier, à côté de ces admirables moutons de pré-salé, de Cabourg, des Vosges ou des Ardennes, qui, en fondant sous la dent, deviennent un manger délectable ? Qui osera la comparer à ces indicibles veaux de rivière, de Pontoise ou de Rouen, dont la blancheur et la tendreté feraient rougir les grâces elles-mêmes ? Quel est le gourmand assez dépravé pour préférer une beauté maigre et chétive à ces énormes et succulents aloyaux de la Limagne et du Cotentin, qui inondent celui qui les dépèce, et font tomber en pamoison ceux qui les mangent ? Rôtis incomparables ! C’est dans vos vastes flancs, sources de tous les principes vitaux et des vraies sensations, que le gourmand va puiser son existence, le musicien son talent, l’amant sa tendresse, et le poète son génie créateur ! Quel apport pouvez-vous établir entre cette figure piquante, mais chiffonnée, et ces poulardes de Bresse, ces chapons de La Flèche et du Mans, ces coqs vierges du pays de Caux, dont la finesse, la beauté, la succulence et l’embonpoint exaltent tous les sens à la fois et délectent merveilleusement les houppes nerveuses et sensitives de tout palais délicat ? Et dans mes arguments, remarquez, messieurs, que je ne comprends même pas les pâtés de mauviettes de Pithiviers, ceux de canards d’Amiens, ceux de guignards de Chartres, les rouges-gorges d’Alençon, les langues fourrées de Constantinople, le bœuf fumé de Hambourg, le cabillaud d’Ostende, les huîtres de Marennes, de Dieppe, de Cancale et d’Étretat ; que je ne parle point du beurre de Bretagne, d’Isigny ou de la Prévalaye, ni de la délicieuse crème de Sotteville ; que, renonçant même aux armes que je pourrais puiser dans des arguments plus doux et plus sacrés, je passe sous silence les noix confites et la gelée de pommes de Rouen, les pruneaux de Tours, les poires de rousselet et tapées, le pain d’épice et les nonettes de Reims, les mirabelles de Metz, les groseilles de Bar, le cotignac d’Orléans, l’épine-vinette de Dijon, les poules de Roquevaire, les raisins de Malaga, les figues fines d’Ollioules, les prunes tapées de Brignoles, les raisins muscats de Pézénas, les prunes du roi et la fleur d’orange pralinée d’Agen, les dragées et les pastilles à la rose et à la vanille de Montpellier, les pâtés de pommes et d’abricots de Clermont, les confitures sèches de Beaucaire et de Béziers, etc. Ce que je ne vous cite pas même, renonçant aux forces qu’ils pourraient me fournir dans cette discussion, l’anisette de Bordeaux, l’eau-de-vie d’Andaye ou de Dantzick, l’eau de noyau de Strasbourg, l’huile d’anis et le kirsch-wasser de Verdun, la crème de moka de Montpellier, l’eau de Colladon de Genève, l’huile de rose de Cette, l’huile de jasmin de Mardrille (la meilleure de toutes les liqueurs indigènes), le ratafia de cerises de Louvres ou de Grenoble, l’eau de la côte Saint-André, la crème d’Arabie, les sirops Tanrade, enfin le baume humain, la crème de menthe, le bois d’Inde et les autres liqueurs de la Martinique. Sachez-moi donc gré, Messieurs, de mon silence, et voyez si vous pouvez établir quelque comparaison entre ces comestibles, ces boissons délectables, et les caprices d’une femme, ses humeurs, ses bouderies et, osons toucher le mot, ses fugitives faveurs ! Figurez-vous les mets que j’ai nommés d’abord, préparés par les cuisiniers de la nouvelle France, torréfiés par des rôtisseurs de Vargue, dépecés par les sommeliers d’Allemagne, et puis soutenez encore votre opinion !
Résumons-nous donc, et convenez que les jouissances de la bonne chère pour un riche gourmand doivent être mises au premier rang ; que, bien autrement prolongées que celles qu’on goûte dans l’infraction du sixième commandement de Dieu, elles n’amènent ni langueurs, ni dégoûts, ni craintes, ni remords ; que la source s’en renouvelle sans cesse, sans jamais se tarir ; que loin d’énerver le tempérament ou d’affaiblir le cerveau, elles deviennent l’heureux principe d’une santé ferme, des idées brillantes et des plus vigoureuses sensations. Aussi, loin d’enfanter les regrets, de disposer à l’hypocondrie, et de finir par rendre un homme insupportable à lui-même, et trop souvent aux autres, on leur doit au contraire cette face de jubilation, le cachet distinctif de tous les enfants de Comus, bien différente de ce visage pâle et blême, le masque ordinaire des amoureux transis.
Tel fut le discours de notre gourmand. Nous ignorons s’il ramena tout le monde à son avis ; mais ce que nous savons positivement, c’est que le lendemain l’on compta dans cette société plus d’une Ariane et cinq ou six indigestions. »
Erckmann-Chatrian
L’Ami Fritz, 1860
« Est-il rien de plus agréable en ce bas monde que de s’asseoir, avec trois ou quatre vieux camarades, devant une table bien servie, dans l’antique salle à manger de ses pères ; et là, de s’attacher gravement la serviette au menton, de plonger la cuiller dans une bonne soupe aux queues d’écrevisses, qui embaume, et de passer les assiettes en disant : “ Goûtez-moi cela, mes amis, vous m’en donnerez des nouvelles.
Qu’on est heureux de commencer un pareil dîner, les fenêtres ouvertes sur le ciel bleu du printemps ou de l’automne.
Et quand vous prenez le grand couteau à manche de corne pour découper les tranches de gigot fondantes, ou la truelle d’argent pour diviser tout du long avec délicatesse un magnifique brochet à la gelée, la gueule pleine de persil, avec quel air de recueillement les autres vous regardent ! Puis, quand vous saisissez derrière votre chaise, dans la cuvette, une autre bouteille et que vous la placez entre vos genoux pour en tirer le bouchon sans secousse, comme ils rient en pensant : “ Qu’est-ce qui va venir à cette heure ?”
Ah ! je vous le dis, c’est un grand plaisir de traiter ses vieux amis, et de penser : “ Cela recommencera de la sorte d’année en année, jusqu’à ce que le Seigneur Dieu nous fasse signe de venir, et que nous dormions en paix dans le sein d’Abraham. ” Et quand à la cinquième ou sixième bouteille, les figures s’animent… c’est alors que la chose devient tout à fait réjouissante, et que le paradis, le vrai paradis, est sur la terre. »
Souvenirs d'enfance, à Nohant
George Sand,
Histoire de ma vie, 1875
« Il [“ mon grand-oncle ”] était gourmand, quoi qu’il mangeât fort peu, mais il avait une gourmandise sobre et de bon goût comme le reste, point fastueuse, sans ostentation, et qui se piquait même d’être positive. Il était plaisant de l’entendre analyser ses théories culinaires, car il le faisait tantôt avec une gravité et une logique qui eussent pu s’appliquer à toutes les données de la politique et de la philosophie, tantôt avec une verve comique et indignée. “ Rien n’est si bête, disait-il avec ses paroles enjouées dont l’accent distingué corrigeait la crudité, que de se ruiner pour sa gueule. Il n’en coûte pas plus d’avoir une omelette délicieuse que de se faire servir, sous prétexte d’omelette, un vieux torchon brûlé. Le tout, c’est de savoir soi-même ce que c’est qu’une omelette, et quand une ménagère l’a bien compris, je la préfère, dans ma cuisine, à un savant prétentieux qui se fait appeler monsieur par ses marmitons, et qui baptise une charogne des noms les plus pompeux. ”
Tout le temps du dîner, la conversation était sur ce ton et roulait sur la mangeaille. J’en ai donné cet échantillon pour qu’on se figure bien cette nature de chanoine, qui n’a guère plus de type dans le temps présent. Ma grand-mère, qui était d’une friandise extrême, bien que très petite mangeuse, avait aussi des théories scientifiques sur la manière de faire une crème à la vanille et une omelette soufflée. Madame Bourdieu se faisait quereller par mon oncle, parce qu’elle avait laissé mettre dans la sauce quelques parcelles de muscade de plus ou de moins : ma mère riait de leurs disputes. Il n’y avait que la mère La Marlière qui oubliât de babiller au dîner, parce qu’elle mangeait comme un ogre. Quant à moi, ces longs dîners servis, discutés, analysés et savourés avec tant de solennité m’ennuyaient mortellement. J’ai toujours mangé vite et en pensant à autre chose. Une longue séance à table m’a toujours rendue malade, et j’obtenais la permission de me lever de temps en temps pour aller jouer avec un vieux caniche qui s’appelait Babet, et qui passait sa vie à faire des petits et à les allaiter dans un coin de la salle à manger. »
Un luxe inaccoutumé
Guy de Maupassant, Pierre et Jean, II.
« Le dîner fut annoncé, et comme le vieux Roland allait offrir son bras à Mme Rosémilly : « Non, non, père, cria sa femme, aujourd’hui tout est pour Jean. »
Sur la table éclatait un luxe inaccoutumé : devant l’assiette de Jean, assis à la place de son père, un énorme bouquet rempli de faveurs de soie, un vrai bouquet de grande cérémonie, s’élevait comme un dôme pavoisé, flanqué de quatre compotiers dont l’un contenait une pyramide de pêches magnifiques, le second un gâteau monumental gorgé de crème fouettée et couvert de clochettes de sucre fondu, une cathédrale en biscuit, le troisième des tranches d’ananas noyées dans un sirop clair, et le quatrième, luxe inouï, du raisin noir, venu des pays chauds.
— Bigre ! dit Pierre en s’asseyant, nous célébrons l’avènement de Jean le Riche.
Après le potage on offrit du madère ; et tout le monde déjà parlait en même temps. Beausire racontait un dîner qu’il avait fait à Saint-Domingue à la table d’un général nègre. Le père Roland l’écoutait, tout en cherchant à glisser entre les phrases le récit d’un autre repas donné par un de ses amis, à Meudon, et dont chaque convive avait été quinze jours malade. Mme Rosémilly, Jean et sa mère faisaient un projet d’excursion et de déjeuner à Saint-Jouin, dont ils se promettaient déjà un plaisir infini ; et Pierre regrettait de ne pas avoir dîné seul, dans une gargote au bord de la mer, pour éviter tout ce bruit, ces rires et cette joie qui l’énervaient.
Il cherchait comment il allait s’y prendre, maintenant, pour dire à son frère ses craintes et pour le faire renoncer à cette fortune acceptée déjà, dont il jouissait, dont il se grisait d’avance. Ce serait dur pour lui, certes, mais il le fallait ; il ne pouvait hésiter, la réputation de leur mère étant menacée.
L’apparition d’un bar énorme rejeta Roland dans les récits de pêche. Beausire en narra de surprenantes au Gabon, à Sainte-Marie de Madagascar et surtout sur les côtes de la Chine et du Japon, où les poissons ont des figures drôles comme les habitants. Et il racontait les mines de ces poissons, leurs gros yeux d’or, leurs ventres bleus ou rouges, leurs nageoires bizarres, pareilles à des éventails, leur queue coupée en croissant de lune, en mimant d’une façon si plaisante que tout le monde riait aux larmes en l’écoutant.
Seul, Pierre paraissait incrédule et murmurait : « On a bien raison de dire que les Normands sont les Gascons du Nord. »
Après le poisson vint un vol-au-vent, puis un poulet rôti, une salade, des haricots verts et un pâté d’alouettes de Pithiviers. La bonne de Mme Rosémilly aidait au service ; et la gaieté allait croissant avec le nombre des verres de vin. Quand sauta le bouchon de la première bouteille de champagne, le père Roland, très excité, imita avec sa bouche le bruit de cette détonation, puis déclara :
— J’aime mieux ça qu’un coup de pistolet.
Pierre, de plus en plus agacé, répondit en ricanant :
— Cela est peut-être, cependant, plus dangereux pour toi.
Roland, qui allait boire, reposa son verre plein sur la table et demanda :
— Pourquoi donc ?
Depuis longtemps il se plaignait de sa santé, de lourdeurs, de vertiges, de malaises constants et inexplicables. Le docteur reprit :
— Parce que la balle du pistolet peut fort bien passer à côté de toi, tandis que le verre de vin te passe forcément dans le ventre.
— Et puis ?
— Et puis il te brûle l’estomac, désorganise le système nerveux, alourdit la circulation et prépare l’apoplexie dont sont menacés tous les hommes de ton tempérament.
L’ivresse croissante de l’ancien bijoutier paraissait dissipée comme une fumée par le vent ; et il regardait son fils avec des yeux inquiets et fixes, cherchant à comprendre s’il ne se moquait pas.
Mais Beausire s’écria :
— Ah ! ces sacrés médecins, toujours les mêmes : ne mangez pas, ne buvez pas, n’aimez pas, et ne dansez pas en rond. Tout ça fait du bobo à petite santé. Eh bien ! j’ai pratiqué tout ça, moi, Monsieur, dans toutes les parties du monde, partout où j’ai pu, et le plus que j’ai pu, et je ne m’en porte pas plus mal.
Pierre répondit avec aigreur :
— D’abord, vous, capitaine, vous êtes plus fort que mon père ; et puis tous les viveurs parlent comme vous jusqu’au jour où… et ils ne reviennent pas le lendemain dire au médecin prudent : « Vous aviez raison, docteur. » Quand je vois mon père faire ce qu’il y a de plus mauvais et de plus dangereux pour lui, il est bien naturel que je le prévienne. Je serais un mauvais fils si j’agissais autrement.
Mme Roland désolée intervint à son tour :
— Voyons, Pierre, qu’est-ce que tu as ? Pour une fois, ça ne lui fera pas de mal. Songe quelle fête pour lui, pour nous. Tu vas gâter tout son plaisir et nous chagriner tous. C’est vilain, ce que tu fais là !
Il murmura en haussant les épaules :
— Qu’il fasse ce qu’il voudra, je l’ai prévenu.
Mais le père Roland ne buvait pas. Il regardait son verre, son verre plein de vin lumineux et clair, dont l’âme légère, l’âme enivrante s’envolait par petites bulles venues du fond et montant, pressées et rapides, s’évaporer à la surface ; il le regardait avec une méfiance de renard qui trouve une poule morte et flaire un piège.
Il demanda, en hésitant :
— Tu crois que ça me ferait beaucoup de mal ?
Pierre eut un remords et se reprocha de faire souffrir les autres de sa mauvaise humeur :
— Non, va, pour une fois, tu peux le boire ; mais n’en abuse point et n’en prends pas l’habitude.
Alors le père Roland leva son verre sans se décider encore à le porter à sa bouche. Il le contemplait douloureusement, avec envie et avec crainte ; puis il le flaira, le goûta, le but par petits coups, en les savourant, le cœur plein d’angoisse, de faiblesse et de gourmandise, puis de regrets, dès qu’il eut absorbé la dernière goutte.
Pierre, soudain, rencontra l’œil de Mme Rosémilly ; il était fixé sur lui limpide et bleu, clairvoyant et dur. Et il sentit, il pénétra, il devina la pensée nette qui animait ce regard, la pensée irritée de cette petite femme à l’esprit simple et droit, car ce regard disait : « Tu es jaloux, toi. C’est honteux, cela. »
Il baissa la tête en se remettant à manger.
Il n’avait pas faim, il trouvait tout mauvais. Une envie de partir le harcelait, une envie de n’être plus au milieu de ces gens, de ne plus les entendre causer, plaisanter et rire.
Cependant le père Roland, que les fumées du vin recommençaient à troubler, oubliait déjà les conseils de son fils et regardait d’un œil oblique et tendre une bouteille de champagne presque pleine encore à côté de son assiette. Il n’osait la toucher, par crainte d’admonestation nouvelle, et il cherchait par quelle malice, par quelle adresse, il pourrait s’en emparer sans éveiller les remarques de Pierre. Une ruse lui vint, la plus simple de toutes : il prit la bouteille avec nonchalance et, la tenant par le fond, tendit le bras à travers la table pour emplir d’abord le verre du docteur qui était vide ; puis il fit le tour des autres verres, et quand il en vint au sien il se mit à parler très haut, et s’il versa quelque chose dedans on eût juré certainement que c’était par inadvertance. Personne d’ailleurs n’y fit attention.
Pierre, sans y songer, buvait beaucoup. Nerveux et agacé, il prenait à tout instant, et portait à ses lèvres d’un geste inconscient la longue flûte de cristal où l’on voyait courir les bulles dans le liquide vivant et transparent. Il le faisait alors couler très lentement dans sa bouche pour sentir la petite piqûre sucrée du gaz évaporé sur sa langue.
Peu à peu une chaleur douce emplit son corps. Partie du ventre, qui semblait en être le foyer, elle gagnait la poitrine, envahissait les membres, se répandait dans toute la chair, comme une onde tiède et bienfaisante portant de la joie avec elle. Il se sentait mieux, moins impatient, moins mécontent ; et sa résolution de parler à son frère ce soir-là même s’affaiblissait, non pas que la pensée d’y renoncer l’eût effleuré, mais pour ne point troubler si vite le bien-être qu’il sentait en lui.
Beausire se leva afin de porter un toast.
Ayant salué à la ronde il prononça :
— Très gracieuses dames, Messeigneurs, nous sommes réunis pour célébrer un événement heureux qui vient de frapper un de nos amis. On disait autrefois que la fortune était aveugle, je crois qu’elle était simplement myope ou malicieuse et qu’elle vient de faire emplette d’une excellente jumelle marine, qui lui a permis de distinguer dans le port du Havre le fils de notre brave camarade Roland, capitaine de la Perle.
Des bravos jaillirent des bouches, soutenus par des battements de mains ; et Roland père se leva pour répondre.
Après avoir toussé, car il sentait sa gorge grasse et sa langue un peu lourde, il bégaya :
— Merci, capitaine, merci pour moi et mon fils. Je n’oublierai jamais votre conduite en cette circonstance. Je bois à vos désirs.
Il avait les yeux et le nez pleins de larmes, et il se rassit, ne trouvant plus rien.
Jean, qui riait, prit la parole à son tour :
— C’est moi, dit-il, qui dois remercier ici les amis dévoués, les amis excellents (il regardait Mme Rosémilly), qui me donnent aujourd’hui cette preuve touchante de leur affection. Mais ce n’est point par des paroles que je peux leur témoigner ma reconnaissance. Je la leur prouverai demain, à tous les instants de ma vie, toujours, car notre amitié n’est point de celles qui passent.
Sa mère, fort émue, murmura :
— Très bien, mon enfant.
Mais Beausire s’écriait :
— Allons, madame Rosémilly, parlez au nom du beau sexe.
Elle leva son verre, et, d’une voix gentille, un peu nuancée de tristesse :
— Moi, dit-elle, je bois à la mémoire bénie de M. Maréchal.
Il y eut quelques secondes d’accalmie, de recueillement décent, comme après une prière ; et Beausire, qui avait le compliment coulant, fit cette remarque :
— Il n’y a que les femmes pour trouver de ces délicatesses.
Puis se tournant vers Roland père :
— Au fond, qu’est-ce que c’était que ce Maréchal ? Vous étiez donc bien intimes avec lui ?
Le vieux, attendri par l’ivresse, se mit à pleurer, et d’une voix bredouillante :
— Un frère… vous savez… un de ceux qu’on ne retrouve plus… nous ne nous quittions pas… il dînait à la maison tous les soirs… et il nous payait de petites fêtes au théâtre… je ne vous dis que ça… que ça… que ça… Un ami, un vrai… un vrai… n’est-ce pas, Louise ?
Sa femme répondit simplement :
— Oui, c’était un fidèle ami.
Pierre regardait son père et sa mère, mais comme on parla d’autre chose, il se remit à boire.
De la fin de cette soirée il n’eut guère de souvenir. On avait pris le café, absorbé des liqueurs, et beaucoup ri en plaisantant. Puis il se coucha, vers minuit, l’esprit confus et la tête lourde. Et il dormit comme une brute jusqu’à neuf heures le lendemain. »
Un dîner bourgeois
« Les Danquin habitaient un vieil appartement de la rue Saint-André-des-Arts, où logeait Pierre de L’Estoile au temps de la Ligue. Ils vivaient dans l’aisance et n’avaient pas d’enfants. Ces excellents gens recueillirent vers 1858 le fils et la fille d’un frère malheureux de Madame Danquin, les jeunes Bondois, Marthe et Claudius, nés et élevés à Lyon, menus et gentils, l’air étonné. Madame Danquin, la plus maternelle des femmes, aimait les jeunes Bondois comme s’ils eussent été les fruits de ses entrailles. Cependant, ils restaient pressés l’un contre l’autre, le frère et la sœur, comme des orphelins et des exilés. Obèse et infirme, gaie par tempérament, madame Danquin bornait aux soins domestiques son inlassable activité. Elle attirait dans sa maison, pour l’égayer, tout ce qu’elle connaissait de jeunes gens et de jeunes filles. Filleul de M. Danquin, j’étais souvent invité à dîner et à passer la soirée. M. Danquin consacrait à l’art de bien vivre toutes les heures qu’il n’accordait pas à la paléontologie. Il avait dans la tête une carte gastronomique de la France où ne manquaient ni les pâtés de Chartres, d’Amiens et de Pithiviers, ni les foies gras de Strasbourg, ni les andouillettes de Troyes, ni les chapons du Mans, ni les rillettes de Tours, ni les prés-salés du Cotentin.
Ainsi que tous les bourgeois de Paris à cette époque, il avait une bonne cave et soignait ses vins avec une sagesse vigilante. Cet honnête homme ne regardait pas comme au-dessous de lui d’acheter lui-même les melons, alléguant qu’une femme est incapable de connaître un cantaloup parvenu au moment fugitif de sa maturité savoureuse d’avec un autre encore vert ou déjà passé. Aussi les dîners de la rue Saint-André-des-Arts étaient-ils excellents. Mon père et ma mère y étaient souvent priés,m ainsi que mesdames Giray et Delarche et leurs filles, fort jolies toutes deux, mademoiselle Guerrier, élève du Conservatoire, le docteur Renaudin, à la fois joyeux et sinistre, madame Gobelin, vieille dame miniaturiste, d’une grande distinction, élève de madame de Mirbel, et sa fille Philippine, maigre, dégingandée, les cheveux fades, les yeux petits, le nez long, sinueux avec un bout détaché ovale ou plutôt ovoïde, la bouche grande, un air de bonté, pas de teint, la taille plate, les genoux perçants. Ses bras n’étaient pas beaux, mais, par compensation, ils étaient démesurément longs et elle les portait démesurément nus, on ne sait pourquoi. En tout cas, ce ne semblait pas être coquetterie de sa part, car elle disait que la nature, par maladresse ou distraction, lui avait fait le gras du bras plus mince que le poignet ; bonne personne, rieuse, mélancolique, moqueuse et tendre, ingénieuse et si animée, si diverse, si changeante qu’elle formait à elle seule tout un chœur de longues jeunes filles, une ronde folle de demoiselles Gobelin, les unes très laides, les autres presque jolies, toutes sympathiques et divertissantes au possible. Mademoiselle Gobelin vivait et aidait sa mère à vivre en faisant des portraits d’enfants et voyait avec résignation la main sale du photographe logé sur le toit de sa maison, dans une cage de verre, lui tirer toutes ses clientes. Laborieuse au delà de tout ce qu’on peut imaginer, elle savait quatre ou cinq langues, avait lu une infinité de livres et était assez bonne musicienne.
Mon parrain découpait lui-même les grosses pièces et servait en faisant parvenir les parts à ses invités, vieil usage, suivi autrefois dans les meilleures maisons. Le prince de Talleyrand, réputé pour le plus accompli des amphitryons, en usait de la sorte. Il découpait lui-même les viandes et en faisait passer une part à chacun en mesurant la civilité de l’offre au rang des convives. M. Amédée Pichot, le fondateur de la Revue Britannique, a conté comment l’archichancelier envoyait du bœuf aux princes et aux ducs en déclarant que ce lui serait un très grand honneur de voir cette offre agréée, puis aux personnages de quelque distinction en les priant d’accepter ce bœuf, et enfin aux convives du bas bout en frappant la table du manche de son couteau et en les interrogeant d’un seul mot « bœuf ? ». M. Danquin, fils de la Révolution, ne croyait pas continuer les grands seigneurs d’autrefois en tranchant et découpant lui-même les pièces.
C’était moins le rang que l’appétit qu’il considérait dans ses distributions. Il mettait les morceaux doubles pour les affamés et avait soin de verser une cuillerée de sang dans l’assiette des débiles et des convalescents. Magnifique et libéral pour tous, il envoyait les meilleurs morceaux à mademoiselle Élise Guerrier, pour qui il avait une préférence imperceptible et décidée. Il choisissait pour elle, dans la longe de veau, le morceau du rognon, et dans le rôti de porc la tranche la plus rissolée, et ses yeux riaient derrière ses lunettes d’or.
Et pour mieux faire paraître la noblesse et illustration des façons dont en usait mon parrain envers mademoiselle Élise Guerrier, élève lauréat du Conservatoire, je transcrirai ici ce que M. de Courtin écrivait à Paris au commencement du XVIIIe siècle dans son Nouveau Traité de la Civilité qui se pratique en France, parmi les honnestes gens :
« Comme le petit côté de l’aloyau est toujours le plus tendre, il passe aussi pour le plus recherché. Pour la longe de veau, elle se coupe ordinairement par le milieu à l’endroit le plus charnu, et le rognon s’en présente par honneur. »
M. de Courtin ajoute que « dans un cochon de lait, ce que les plus friands y trouvent de meilleur est la peau et les oreilles. »
Ce que je dis des hommages culinaires dont mon parrain se plaisait à favoriser mademoiselle Élise Guerrier, je le dis sans envie ; la jalousie en ce cas serait incongrue et partirait d’un mauvais cœur, car mon parrain, me soupçonnant avec raison d’aimer sans mesure la pâtisserie, m’envoyait des parts énormes de tarte ou de flan.
Si l’on rappelle à propos de ces dîners chers à mon enfance les services magnifiques d’un Cambacérès ou d’un Talleyrand, et la table du duc de Chevreuse où M. de Courtin acquit ses belles connaissances, c’est par amour de la tradition et désir de trouver de la continuité dans la succession rapide des générations. En réalité, la table de M. Danquin était des plus modestes et témoignait de la sage médiocrité des mœurs bourgeoises dans les dernières années de la royauté constitutionnelle et les premières de l’Empire. La bonne madame Danquin tenait sa maison sur un petit pied. Une seule servante faisait le service. Les dîners étaient copieux et longs. L’oncle Danquin, âgé de quatre-vingt-neuf ans, y assistait parfois. On le priait de chanter au dessert. Il se levait et susurrait imperceptiblement une chanson bachique de Désaugiers :
Versez encore…
Après le dîner, on passait dans le salon, vaste pièce autour de laquelle régnaient des armoires pleines de fossiles, ossements de reptiles et de poissons, empreintes de crustacés, de zoophytes, d’insectes et de plantes, coprolithes, mâchoires de grands reptiles, défenses de mammouths. »
Les repas
Sacha Guitry
« Chaque repas que je prends en dehors de chez moi confirme mon opinion sur la déplorable façon actuelle de recevoir.
Je ne suis ni extrêmement difficile, ni ce qu’on appelle “ goinfre ”, mais comme il n’y a que deux repas par jour, il m’est désagréable, odieux même, de sacrifier l’un ou l’autre.
Je déteste la bonne franquette et je hais la fortune du pot.
Or, la coutume, ou plus exactement la mode, veut que l’on n’attache plus aucune importance aux aliments et aux boissons que l’on offre.
La personne qui vous invite estime qu’elle vous fait un plaisir, et son dérangement se borne à faire mettre un couvert de plus.
Car c’est un dérangement pour elle !
C’est inouï !
Mais, madame, lorsque je m’assieds à votre table, je vous donne une marque de confiance dont vous devez vous rendre digne.
Et, croyez-moi, je n’en fais pas uniquement une question de nourriture.
Quand un dîner est mauvais, ça ne prouve pas seulement que le dîner est mauvais. Ça prouve que le café ne sera pas buvable, ça prouve que les liqueurs seront oubliées et les cigares omis. Ça prouve que vous ne tenez pas à ce que je revienne. Ça prouve que j’ai eu tort de venir.
Pourquoi ai-je l’impression qu’autrefois on agissait différemment ?
Et à quoi faut-il attribuer cette insouciance des amphitryons ?
Á leur avarice?
Oui, d’abord, bien sûr. Mais aussi, mais surtout, cela tient à la facilité qu’on a d’ouvrir sa porte à n’importe qui, presque.
Il faut estimer ses convives. Or, on s’invite à dîner pour faire connaissance.
On commence tout simplement par la faim.
Ensuite, on se rend à l’invitation. On fait ça trois fois, quatre fois, jusqu’à ce que ça vienne…
Et, le plus souvent, on s’aperçoit — trop tard ! — que l’amitié ne vient pas en mangeant. Eh ! Oui, trop tard ! Vous ne pouvez plus vous dérober. Le pli est pris, c’est l’engrenage. Et puis, on sait que vous avez dîné à plusieurs reprises les uns chez les autres ; on croît que vous êtes des intimes et on ne s’explique pas vos sévérités réciproques, — car, pour tout le monde, vous êtes des amis, excepté pour vous.
Ainsi, vous détruisez l’un des plus grands charmes de la vie. Et, l’ayant méconnu, pour un peu vous le contesteriez.
Et, pourtant, est-il un plaisir plus savoureux que celui d’avoir à sa table deux amis gourmands et gais ?
Je dis “ deux ”, parce que pour manger, c’est comme pour causer, il ne faut pas être nombreux.
Moins on est de fous, plus on rit.
Car, il faut bien l’avouer, on ne s’amuse jamais lorsqu’on est quinze ou vingt à table — ou ailleurs.
Un grand dîner ! Mais c’est sinistre, un grand dîner !
On n’est jamais placé comme on aurait souhaité l’être. On a toujours trop chaud, on est mal et on mange un petit peu d’un tas de plats compliqués et prévus.
Ah ! que la vie est belle et que l’on bavarde bien quand on est quatre et qu’on a mangé chacun son perdreau !
Puisque vous avez la manie d’avoir chez vous des gens célèbres, ne les invitez donc pas tous à la fois !
On brille mieux quand on est seul, et les gens célèbres préfèrent ne pas se rencontrer.
Conviez-les chacun à leur tour, offrez-leur de bons mets et de bons vins, vous les aurez souvent, et au moins vous pourrez profiter d’eux.
Vous faites venir Capus, et le même soir, vous invitez Donnay pour épater Capus.
C’est une faute inutile.
Capus est plus épaté de voir Capus chez vous que d’y voir Donnay. »

Le mauvais riche se divertit à table, par Heinrich Aldegrever (1502-155).
Une halte à Gisons
Guy de Maupassant,
Le Rosier de Mme Husson
« “ Gisors, Gisors, mais je connais quelqu’un ici. Qui donc ?
Gisors ? Voyons, j’ai un ami dans cette ville. ” Un nom soudain jaillit dans mon souvenir : “ Albert Marambot ”. C’était un ancien camarade de collège, que je n’avais pas vu depuis douze ans au moins, et qui exerçait à Gisors la profession de médecin. Souvent il m’avait écrit pour m’inviter ; j’avais toujours promis, sans tenir. Cette fois, enfin je profiterai de l’occasion.
Je demande au premier passant : “ Savez-vous où demeure M. le docteur Marambot ? ” Il répondit sans hésiter, avec l’accent traînard des Normands : “ Rue Dauphine ”. J’aperçus en effet, sur la porte de la maison indiquée, une grande plaque de cuivre où était gravé le nom de mon ancien camarade. Je sonnai ; mais la servante, une fille à cheveux jaunes, aux gestes lents, répétait d’un air stupide : “ I y est paas, I est paas ”.
J’entendais un bruit de fourchettes et de verres, et je criai : “ Hé ! Marambot ”. Une porte s’ouvrit, et un gros homme à favoris parut, l’air mécontent, une serviette à la main.
Certes, je ne l’aurais pas reconnu. On lui aurait donné quarante-cinq ans au moins, et, en une seconde, toute la vie de province m’apparut, qui alourdit, épaissit et vieillit. Dans un seul élan de ma pensée, plus rapide que mon geste pour lui tendre la main, je connus son existence, sa manière d’être, son genre d’esprit et ses théories sur le monde. Je devinai les longs repas qui avaient arrondi son ventre, les somnolences après dîner, dans la torpeur d’une lourde digestion arrosée de cognac, et les vagues regards jetés sur les malades avec la pensée de la poule rôtie qui tourne devant le feu. Ses conversations sur la cuisine, sur le cidre, l’eau-de-vie et le vin, sur la manière de cuire certains plats et de bien lier certaines sauces me furent révélées, rien qu’en apercevant l’empâtement rouge de ses joues, la lourdeur de ses lèvres, l’éclat morne de ses yeux.
Je lui dis : “ Tu ne me reconnais pas. Je suis Raoul Aubertin ”.
Il ouvrit les bras et faillit m’étouffer, et sa première phrase fut celle-ci :
— Tu n’as pas déjeuné, au moins ?
— Non.
— Quelle chance ! Je me mets à table et j’ai une excellente truite.
Cinq minutes plus tard je déjeunais en face de lui.
Je lui demandai :
— Tu est resté garçon ?
— Parbleu !
— Et tu t’amuses ici ?
— Je ne m’ennuie pas, je m’occupe? J’ai des malades, des amis. Je mange bien, je me porte bien, j’aime à rire et chasser. Ça va.
— La vie n’est pas trop monotone dans cette petite ville ?
— Non, mon cher, quand on sait s’occuper. Une petite ville, en somme, c’est comme une grande. Les événements et les plaisirs y sont moins variés, mais on leur prête plus d’importance ; les relations y sont moins nombreuses, mais on se rencontre plus souvent. Quand on connaît toutes les fenêtres d’une rue, chacune d’elles vous occupe et vous intrigue davantage qu’une rue entière à Paris.
C’est très amusant, une petite ville, tu sais, très amusant, très amusant. Tiens, celle-ci, Gisors, je la connais sur le bout du doigt depuis son origine jusqu’à aujourd’hui. Tu n’as pas idée comme son histoire est drôle.
— Tu es de Gisors ?
— Moi ? Non. Je suis de Gournay, sa voisine et sa rivale. Gournay est à Gisors ce que Lucullus était à Cicéron. Ici, tout est pour la gloire, on dit : “ les orgueilleux de Gisors ”. Á Gournay,tout est pour le ventre, on dit : “ les maqueux de Gournay ». Gisors méprise Gournay, mais Gournay rit de Gisors. C’est très comique, ce pays-ci.
Je m’aperçus que je mangeais quelque chose de vraiment exquis, des œufs mollets enveloppés dans un fourreau de gelée de viande aromatisée aux herbes et légèrement saisie dans la glace.
Je dis en claquant la langue pour flatter Marambot : “ Bon, ceci ”.
Il sourit. “ Deux choses nécessaires, de la bonne gelée, difficile à obtenir, et de bons œufs. Oh ! les bons œufs, que c’est rare, avec le jaune un peu rouge, bien savoureux ! Moi, j’ai deux basses-cours, une pour l’œuf, l’autre pour la volaille. Je nourris mes pondeuses d’une manière spéciale. J’ai mes idées. Dans l’œuf comme dans la chair du poulet, du bœuf ou du mouton, dans le lait, dans tout, on retrouve et on doit goûter le suc, la quintessence des nourritures antérieures de la bête. Comme on pourrait mieux manger si on s’occupait davantage de cela !
Je riais.
— Tu es donc gourmand ?
— Parbleu ! Il n’y a que les imbéciles qui ne soient pas gourmands. On est gourmand comme on est artiste, comme est instruit, comme on est poète. Le goût, mon cher, c’est un organe délicat, perfectible et respectable comme l’œil et l’oreille. Manquer de goût, c’est être privé d’une faculté exquise, de la faculté de discerner la qualité des aliments, comme on peut être privé de celle de discerner les qualités d’un livre ou d’une œuvre d’art ; c’est être privé d’un sens essentiel; d’une partie de la supériorité humaine ; c’est appartenir à une des innombrables classes d’infirmes, de disgraciés et de sots dont se compose notre race ; c’est avoir la bouche bête, en un mot, comme on a l’esprit bête. Un homme qui ne distingue pas une langouste d’un homard, un hareng, cet admirable poisson qui porte en lui toutes les saveurs, tous les arômes de la mer, d’un maquereau ou d’un merlan, et une poire crassane d’une duchesse, est comparable à celui qui confondrait Balzac avec Eugène Sue, une symphonie de Beethoven avec une marche militaire d’un chef de musique de régiment, et l’Apollon du Belvédère avec la statue du général de Blanmont !
— Qu’est-ce donc que le général de Blanmont ?
— Ah ! c’est vrai, tu ne sais pas. On voit bien que tu n’es point de Gisors ! Mon cher, je t’ai dit tout à l’heure qu’on appelait les habitants de cette ville les “ orgueilleux de Gisors ” et jamais épithète ne fut mieux méritée. Mais déjeunons d’abord, et je te parlerai de notre ville en te la faisant visiter.
Il cessait de parler de temps en temps pour boire lentement un demi-verre de vin qu’il regardait avec tendresse en le reposant sur la table.
Une serviette nouée au col, les pommettes rouges, l’œil excité, les favoris épanouis autour de sa bouche en travail, il était amusant à voir.
Il me fit manger jusqu’à la suffocation. Puis, comme je voulais regagner la gare, il me saisit le bras et m’entraîna par les rues. »
Un second couvert
Colette,
La naissance du jour
« Que tout est devenu simple… Tout, et jusqu’au second couvert que parfois je dispose, sur la table ombragée, en face du mien.
Un second couvert… Cela tient peu de place, maintenant : une assiette verte, un gros verre ancien, un peu trouble. Si je fais signe qu’on l’enlève à jamais, aucun souffle pernicieux, accouru soudain de l’horizon, ne lèvera mes cheveux droits et ne fera tourner — cela s’est vu — ma vie dans un autre sens. Ce couvert ôté de ma table, je mangerai pourtant avec appétit. Il n’y a plus de mystère, plus de serpent lové sous la serviette que pince et marque, pour la distinguer de la mienne, la lyre de cuivre qui maintenait, au-dessus d’un vieil ophicléide du siècle dernier, les pages désertes d’une partition où l’on ne lisait que des “ temps forts ”, semés à intervalles égaux comme des larmes… Ce couvert est celui de l’ami qui vient et s’en va, ce n’est plus celui d’un maître du logis qui foule, aux heures nocturnes, le sonore plancher d’une chambre, là-haut… Les jours où l’assiette, le verre, la lyre manquent en face de moi, je suis simplement seule, et non délaissée. Rassurés, mes amis me font confiance. »
Un dîner de famille morose
Ménandre (Athènes, v. 342 - v. 292)
Fragments.
[…] Que la bonté des dieux
« Me préserve à jamais d’un dîner de famille,
Réunion lugubre où la parenté brille,
Mais où l’estomac souffre ! où, gravement assis,
Cousins, petits-cousins, neveux et petits-fils,
Paraissant assister à quelque sacrifice,
D’un jeûne solennel subissent le supplice !
D’abord, le verre en main, le maître du logis,
De contes du vieux temps entretient ses amis :
Tout l’édifice tremble à sa voix formidable.
Sa femme près de lui, matrone respectable,
Mêle un aigre fausset à ses graves discours,
Et du triste repas interrompant le cours,
Á chaque nouveau mets ajoute un commentaire.
Non loin d’elle, je vois oncle, tante et grand’mère,
De préceptes moraux assaisonnant les plats,
Et blâmant des plaisirs… que nous ne goûtons pas. »
Le souper

Laurence Sterne*,
Voyage sentimental à travers la France et l’Italie, 1767 ?
« Le fer d’un des pieds de devant du limonier menaçant de se détacher, au bas de la côte qui monte au mont Tarare, le postillon descendit de cheval, arracha le fer et le mit dans sa poche ; comme la montée était de cinq ou six milles et que ce cheval était notre principale ressource, j’insistai pour qu’on reclouât le fer aussi bien que possible ; mais le postillon avait jeté les clous, et comme le marteau du coffre, sans eux, ne pouvait servir à grand’chose, je me résignai à continuer.
Le cheval n’avait pas monté plus d’un demi-mille qu’en arrivant à un endroit pierreux, la pauvre bête perdit un second fer, justement celui de son autre pied de devant ; je descendis alors de la chaise pour tout de bon, et apercevant une maison à environ un quart de mille sur la gauche, je décidai à grand’peine le postillon à tourner pour s’y rendre. L’aspect de la maison et de ses dépendances, quand nous en approchâmes, me fit vite accepter mon accident. — C’était une petite ferme, entourée d’environ vingt acres de vignes, et d’à peu près autant de blé — contre la maison, il y avait d’un côté un potager d’une acre et demie, plein de tout ce qui pouvait entretenir l’abondance dans une maison de paysan français — et de l’autre un petit bois qui fournissait de quoi faire cuire les produits du potager. Il était environ huit heures du soir quand j’y arrivai — je laissai donc le postillon se tirer d’affaire comme il pouvait — et quant à moi, j’entrai tout droit dans la maison.
La famille se composait d’un vieillard à cheveux gris et de sa femme, avec cinq ou six fils, gendres, et leurs femmes respectives, et, derrière eux, une joyeuse lignée.
Ils étaient assis, tous ensemble, autour de leur soupe aux lentilles ; il y avait un gros pain de froment au milieu de la table ; et un cruchon de vin à chaque bout promettait de la joie aux divers stades du repas — c’était un festin d’amour.
Le vieillard se leva pour m’accueillir et, avec une respectueuse cordialité, m’invita à prendre place à table ; mon cœur y avait pris place dès l’instant où j’étais entré dans la salle ; je m’y assis donc aussitôt, comme un enfant de la famille ; et pour entrer le plus vite possible dans mon rôle, j’empruntai immédiatement le couteau du vieillard et prenant le pain je m’en coupai un bon morceau ; pendant que je le faisais, je voyais dans tous les yeux un témoignage, non seulement de bon accueil, mais d’un accueil mélangé de gratitude à mon égard pour n’avoir point paru en douter.
Était-ce cela ? ou alors dis-moi quelle autre raison, Nature, me rendit si agréable ce morceau de pain — ou quelle magie me rendit la rasade prise à leur cruchon si délicieuse, que la saveur m’en est restée au palais jusqu’à cette heure ?
Si le souper fut de mon goût — les grâces qui le suivirent le furent bien plus encore. »
* Sterne garda un souvenir ébloui de son voyage dans le Bourbonnais au milieu des années 1760. « Il n'était…
Le dîner du chanoine
Lesage
Gil Blas de Santillane, II, 1 (?)
« Nous suivîmes la dame Jacinthe. Le chanoine était logé par bas, et son appartement consistait en quatre pièces de plain-pied, bien boisées. […]
D’abord que Fabrice vit que j’étais arrêté, il fit une grande révérence au chanoine, une autre encore plus profonde à la gouvernante, et se retira fort satisfait, après m’avoir dit tout bas que nous nous reverrions, et que je n’avais qu’à rester là. Dès qu’il fut sorti, le licencié me demanda comment je m’appelais, pourquoi j’avais quitté ma patrie ; et par ses questions, il m’engagea, devant dame Jacinthe, à raconter mon histoire. Je les divertis tous deux, surtout par le récit de ma dernière aventure. Camille et don Raphaël leur donnèrent une si forte envie de rire, qu’il en pensa coûter la vie au vieux goutteux ; car, comme il riait de toute sa force, il lui prit une toux si violente, que je crus qu’il allait passer. Il n’avait pas encore fait son testament, jugez si la gouvernante fut alarmée ! Je la vis, tremblante, éperdue, courir au secours du bonhomme, et, faisant ce qu’on fait pour soulager les enfants qui toussent, lui frotter le front et lui taper sur le dos. Ce ne fut pourtant qu’une fausse alarme ; le vieillard cessa de tousser, et sa gouvernante de le tourmenter. Alors je voulus achever mon récit ; mais la dame Jacinthe, craignant une seconde toux, s’y opposa. Elle m’emmena même de la chambre du chanoine dans une garde-robe, où parmi plusieurs habits était celui de mon prédécesseur. Elle me le fit prendre, et mit à sa place le mien, que je n’étais pas fâché de conserver, dans l’espérance qu’il me servirait encore. Nous allâmes ensuite tous deux préparer le dîner.
Je ne parus pas neuf dans l’art de faire la cuisine. Il est vrai que j’en avais fait l’heureux appentissage sous la dame Léonarde, qui pouvait passer pour une bonne cuisinière. Elle n’était toutefois pas comparable à la dame Jacinthe : celle-ci l’emportait peut-être sur le cuisinier même de l’archevêque de Tolède. Elle excellait en tout. On trouvait ses bisques exquises, tant elle savait bien choisir et mêler les sucs de viandes qu’elle y faisait entrer ; et ses hachis étaient assaisonnés d’une manière qui les rendait très agréables au goût. Quand le dîner fut prêt, nous retournâmes dans la chambre du chanoine, où, pendant que je dressais une table auprès de son fauteuil, la gouvernante passa sous le menton du vieillard une serviette, et la lui attacha aux épaules. Un moment après, je servis un potage qu’on aurait pu présenter au plus fameux directeur de Madrid, et deux entrées qui auraient eu de quoi piquer la sensualité d’un vice-roi, si la dame Jacinthe n’y eût pas épargné les épices, de peur d’irriter la goutte du licencié. Á la vue de ces bons plats, mon vieux maître, que je croyais perclus de tous ses membres, me montra qu’il n’avait pas encore entièrement perdu l’usage de ses bras ; il s’en aida pour se débarrasser de son oreiller et de ses coussins, et se disposa gaiement à manger. Quoique la main lui tremblât, elle ne refusa pas le service ; il la faisait aller et venir assez librement, de façon pourtant qu’il répandait sur la nappe et sur sa serviette la moitié de ce qu’il portait à sa bouche. J’ôtai la bisque lorsq’il n’en voulut plus, et j’apportai une perdrix flanquée de deux cailles rôties, que la dame Jacinthe lui dépeça. Elle avait aussi soin de lui faire boire de temps en temps de grands coups de vin un peu trempé, dans une coupe d’argent large et profonde, qu’elle lui tenait comme à un enfant de quinze mois. Il s’acharna sur les entrées, et ne fit pas moins d’honneur aux petits pieds. Quand il se fut bien empiffré, la béate lui détacha sa serviette, lui remit son oreiller et ses coussins, puis, le laissant dans son fauteuil goûter tranquillement le repos qu’on prend d’ordinaire après le dîner, nous desservîmes et nous allâmes manger à notre tour.
Voilà de quelle manière dînait tous les jours notre chanoine, qui était peut-être le plus grand mangeur du chapitre. Mais il soupait plus légèrement : il se contentait d’un poulet et de quelques compotes de fruits. Je faisais bonne chère dans cette maison, j’y menais une vie très douce ; […]. »
Le souper de Monseigneur
Lesage
Gil Blas de Santillane, X, 10 (?)
« Je marchais le long des rues en rêvant où je pourrais, avec deux réaux, que j’avais pour tout bien, aller gîter. J’arrivai à la porte de l’archevêché, et, comme on travaillait au souper de monseigneur, il sortait des cuisines une agréable odeur qui se faisait sentir d’une lieue à la ronde. “ Peste ! dis-je en moi-même, je m’accommoderais volontiers de quelqu’un de ces ragoûts qui prennent au nez ; je me contenterais même d’y tremper les quatre doigts et le pouce. Mais quoi ! ne puis-je imaginer un moyen de goûter de ces bonnes viandes, dont je ne fais que sentir la fumée ? Pourquoi non ? cela ne paraît pas impossible. ” Je m’échauffai l’imagination là-dessus ; et, à force de rêver, il me vint dans l’esprit une ruse que j’employai sur-le-champ, et qui réussit. J’entrai dans la cour du palais archiépiscopal en courant vers les cuisines, et en criant de toute ma force : Au secours ! au secours !comme si quelqu’un m’eût poursuivi pour m’assassiner.
Á mes cris redoublés, maître Diego, le cuisinier de l’archevêque, accourut avec trois ou quatre marmitons pour en savoir la cause ; et, ne voyant personne que moi, il me demanda pour quel sujet je criais si fort. “ Ah ! seigneur, lui répondis-je en faisant toutes les démonstrations d’un homme épouvanté, par saint Polycarpe ! sauvez-moi, je vous prie, de la fureur d’un spadassin qui veut me tuer. — Où est-il donc ce spadassin ? s’écria Diego. Vous êtes tout seul de votre compagnie, et je ne vois pas un chat à vos trousses. Allez, mon enfant, rassurez-vous : c’est apparemment quelqu’un qui a voulu vous faire peur pour se divertir, et qui a bien fait de ne pas vous suivre dans ce palais, car nous lui aurions pour le moins coupé les oreilles. — Non, non, dis-je au cuisinier, ce n’est pas pour rire qu’il m’a poursuivi. C’est un grand pendard qui voulat me dépouiller, et je suis sûr qu’il m’attend dans la rue. — Il vous y attendra donc longtemps, reprit-il, puisque vous demeurerez ici jusqu’à demain. Vous y souperez et coucherez.
Je fus transporté de joie quand j’entendis ces dernières paroles, et ce fut pour moi un spectacle ravissant, lorsque, ayant été conduit par maître Diego dans les cuisines, j’y vis les préparatifs du souper de monseigneur. Je comptai jusqu’à quinze personnes qui en étaient occupées ; mais je ne pus nombrer les mets qui s’offrirent à ma vue, tant la Providence avait soin d’en pourvoir l’archevêché. Ce fut alors que, respirant à plein nez la fumée des ragoûts que je n’avais sentis que de loin, j’appris à connaître la sensualité. J’eus l’honneur de souper et coucher avec les marmitons, dont je gagnai si bien l’amitié, que le jour suivant, lorsque j’allai remercier maître Diego de m’avoir donné si généreusement un asile, il me dit “ Nos garçons de cuisine m’ont témoigné tous q’ils seraient ravis de vous avoir pour camarade, tant ils trouvent à leur gré votre humeur. De votre côté, seriez-vous bien aise d’être leur compagnon ? ” Je lui répondis que si j’avais ce bonheur-là, je me croirais au comble de mes vœux. “ Si cela est, reprit-il, mon ami, regardez-vous dès à présent comme un officier de l’archevêché. ” Á ces mots, il me mena et présenta au majordome, qui, sur mon air réveillé, me jugea digne d’être reçu parmi les fouille-au-pot.
Je ne fus pas plutôt en possession d’un emploi si honorable, que maître Diego, suivant l’usage des cuisiniers de grandes maisons, qui envoient secrètement des viandes à leurs mignonnes, me choisit pour porter chez une dame du voisinage, tantôt des longes de veau, et tantôt de la volaille ou du gibier. Cette bonne dame était une veuve de trente ans tout au plus, très jolie, très vive, et qui avait l’air de n’être pas exactement fidèle à son cuisinier. Il ne se contentait pas de lui fournir de la viande, du pain, du sucre et de l’huile ; il faisait aussi sa provision de vin, et tout cela aux dépens de monseigneur l’archevêque.
J’achevai de me dégourdir dans le palais de Sa grandeur […]. »
Un repas de bienvenue frugal
Honoré de Balzac,
La Rabouilleuse, 1822
« Après avoir mis les effets de sa mère et les siens dans les deux chambres en mansarde et les avoir examinées, Joseph observa cette maison silencieuse où les murs, l’escalier, les boiseries étaient sans ornement et distillaient le froid, où il n’y avait en tout que le strict nécessaire. Il fut alors saisi de cette brusque transition du poëtique Paris à la muette et sèche province. Mais quand, en descendant, il aperçut monsieur Hochon coupant lui-même pour chacun des tranches de pain, il comprit, pour la première fois de sa vie, Harpagon de Molière.
— Nous aurions mieux fait d’aller à l’auberge, se dit-il en lui-même.
L’aspect du dîner confirma ses appréhensions. Après une soupe dont le bouillon clair annonçait qu’on tenait plus à la quantité qu’à la qualité, on servit un bouilli triomphalement entouré de persil. Les légumes, mis à part dans un plat, comptaient dans l’ordonnance du repas. Ce bouilli trônait au milieu de la table, accompagné de trois autres plats : des œufs durs sur de l’oseille placés en face des légumes ; puis une salade tout accommodée à l’huile de noix en face de petits pots de crème où la vanille était remplacée par de l’avoine brûlée, et qui ressemble à la vanille comme le café de chicorée ressemble au moka. Du beurre et des radis dans deux plateaux aux deux extrémités, des radis noirs et des cornichons complétaient ce service, qui eut l’approbation de madame Hochon. La bonne vieille fit un signe de tête en femme heureuse de voir que son mari, pour le premier jour du moins, avait bien fait les choses. Le vieillard répondit par une œillade et un mouvement d’épaules facile à traduire : “ Voilà les folies que vous me faites faire ! … ”
Immédiatement après avoir été comme disséqué par monsieur Hochon en tranches semblables à des semelles d’escarpins, le bouilli fut remplacé par trois pigeons. Le vin du cru fut du vin de 1811. Par un conseil de sa grand’mère, Adolphine avait orné de deux bouquets les bouts de la table.
— Á la guerre comme à la guerre, pensa l’artiste en contemplant la table.
Et il se mit à manger en homme qui avait déjeuné à Vierzon, à six heures du matin, d’une exécrable tasse de café. Quand Joseph eut avalé son pain et qu’il en redemanda, monsieur Hochon se leva, chercha lentement une clef dans le fond de la poche de sa redingote, ouvrit une armoire derrière lui, brandit le chanteau d’un pain d’un douze livres, en coupa cérémonieusement une autre rouelle, la fendit en deux, la posa sur une assiette et passa l’assiette à travers la table au jeune peintre avec le silence et le sang-froid d’un vieux soldat qui se dit au commencement d’une bataille : “ Allons, aujourd’hui, je puis être tué ”. Joseph prit la moitié de cette rouelle et comprit qu’il ne devait plus redemander de pain. Aucun membre de la famille ne s’étonna de cette scène si monstrueuse pour Joseph. La conversation allait bon train. Agathe apprit que la maison où elle était née, la maison de son père avant qu’il eût hérité de celle des Descoings, avait été rachetée par les Borniche, elle manifesta le désir de la revoir.
— Sans doute, lui dit sa marraine, les Borniche viendront ce soir, car nous aurons toute la ville qui voudra vous examiner, dit-elle à Joseph, et ils vous inviteront à venir chez eux.
La servante apporta pour dessert le fameux fromage mou de la Touraine et du Berry, fait avec du lait de chèvre et qui reproduit si bien en nielles les dessins des feuilles de vigne sur lesquelles on le sert, qu’on aurait dû faire inventer la gravure en Touraine. De chaque côté de ces petits fromages, Gritte mit avec une sorte de cérémonie des noix et des biscuits inamovibles.
— Allons donc, Gritte, du fruit ? dit madame Hochon.
— Mais, madame, n’y en a plus de pourri, répondit Gritte.
Joseph partit d’un éclat de rire comme s’il était dans son atelier avec des camarades, car il comprit tout à coup que la précaution de commencer par les fruits attaqués était dégénérée en habitude.
— Bah ! nous les mangerons tout de même, répondit-il avec l’entrain de gaieté d’un homme qui prend son parti.
— Mais va donc, monsieur Hochon, s’écria la vieille dame.
Monsieur Hochon, très-scandalisé du mot de l’artiste, rapporta des pêches de vigne, des poires et des prunes de Sainte-Catherine.
— Adolphine, va nous cueillir du raisin, dit madame Hochon à sa petite-fille.
Joseph regarda les deux jeunes gens d’un air qui disait : “ Est-ce à ce régime-là que vous devez vos figures prospères ? ” Baruch comprit ce coup d’œil incisif et se prit à sourire, car son cousin Hochon et lui s’étaient montrés discrets. La vie au logis était assez indifférente à des gens qui soupaient trois fois par semaine chez la Cognette. D’ailleurs, avant le dîner, Baruch avait reçu l’avis que le Grand-Maître convoquait l’Ordre au complet à minuit pour le traiter avec magnificence en demandant un coup de main. Ce repas de bienvenue offert à ses hôtes par le vieil Hochon, explique combien les festoiements nocturnes chez la Cognette étaient nécessaires à l’alimentation de ces deux grands garçons bien endentés qui n’en manquaient pas un.
— Nous prendrons la liqueur au salon, dit madame Hochon en se levant et demandant par un geste le bras de Joseph. En sortant la première, elle put dire au peintre : “ Eh ! bien, mon pauvre garçon, ce dîner ne te donnera pas d’indigestion ; mais j’ai eu bien de la peine à te l’obtenir. Tu feras carême ici, tu ne mangeras que ce qu’il faut pour vivre, et voilà tout. ainsi prends la table en patience… ”
La bonhomie de cette excellente vieille qui se faisait ainsi son procès à elle-même plut à l’artiste.
— J’aurais vécu cinquante ans avec cet homme-là, sans avoir entendu vingt écus ballantdans ma bourse ! Oh ! s’il ne s’agissait pas de vous sauver une fortune, je ne vous aurais jamais attirés, ta mère et toi, dans ma prison.
— Mais comment vivez-vous encore ? dit naïvement le peintre avec cette gaieté qui n’abandonne jamais les artistes français.
— Ah ! voilà, reprit-elle. Je prie.
Joseph eut un léger frisson en entendant ce mot, qui lui grandissait tellement cette vieille femme qu’il se recula de trois pas pour contempler sa figure ; il la trouva radieuse, empreinte d’une sérénité si tendre qu’il lui dit : “ Je ferai votre portrait ! ”
— Non, non, dit-elle, je me suis trop ennuyée sur la terre pour vouloir y rester en peinture !
En disant gaiement cette triste parole, elle tirait d’une armoire une fiole contenant du cassis, une liqueur de ménage faite par elle, car elle en avait eu la recette de ces si célèbres religieuses auxquelles on doit le gâteau d’Issoudun, l’une des plus grandes créations de la confiturerie française, et qu’aucun chef d’office, cuisinier, pâtissier et confiturier n’a pu contrefaire. Monsieur de Rivière, ambassadeur à Constantinople, en demandait tous les ans d’énormes quantités pour le sérail de Mahmoud. Adolphine tenait une assiette de laque pleine de vieux petits verres à pans gravés et dont le bord est doré ; puis, à mesure que sa grand’mère en remplissait un, elle allait l’offrir. »
Les dîners de ma grand-mère
Théodore de Banville
« Certes, j’étais destiné dans l’avenir à dîner souvent par cœur, d’abord comme écolier à la pension, et plus tard comme poète lyrique ; mais si j’ai maintes fois déjeuné d’une fabuleuse rime riche, éblouie et stupéfaite, et soupé du clair de lune, du moins, dans ma petite enfance, j’ai si bien par avance pris mon éclatante revanche, que j’ai pu ensuite frapper orgueilleusement sur ma poche où manque ce qui sonne, et rire au nez de la Faim ironique en lui disant :
— Tu me tiens à présent, mais rappelle-toi que je t’en ai fait voir de grises !
En effet, grâce aux victuailles que de ses domaines des Coquats mon fantasque bisaïeul envoyait à sa fille, — encombrée de brochets, de carpes géantes, de lièvres, de perdrix, de bécasses, de gibier de tout poil et de toute plume, et aussi de légumes, de volailles, de fleurs coupées, de fruits à la chair vermeille, la maison de ma grand’mère eût ressemblé à un festin de Jordaens si elle avait eu des convives ; mais les convives étaient uniquement moi et ma petite sœur.
Un peu avant deux heures, j’arrivais de la petite école tenue par M. Pérille et par son sous-maître Dusselle ; j’étais serré, embrassé, étouffé, baisé sur toutes les coutures, je voyais la table mise où fumaient des plats délicieux ; mais avant de m’y asseoir, je ne manquais pas de m’écrier du ton le plus convaincu :
— Maman Huet, j’ai bien besoin d’un violon rouge !
Si, en entendant ces mots, les servantes qui allaient et venaient derrière nous ne s’étaient pas déjà mises en route, ma grand’mère leur lavait la tête de la belle façon :
— Eh bien ! Lize, Nanon, Marion, qu’est-ce que vous faites là, immobiles comme des souches ? Vous n’êtes pas encore parties chez Chapié ? Vous n’avez pas entendu que cet enfant a besoin d’un violon rouge !
Oh ! chère âme ! comme elle me comprenait bien !
Elle savait en effet que je lui demandais le violon, non pas du tout par caprice et comme un jouet enfantin, mais parce qu’il me le fallait et qu’il m’était utile. Et, mon cher petit Georges, vois ce que c’est d’avoir été bien élevé. Plus tard, bien plus tard, lorsque c’est moi qui ai été vieux et que tu m’as dit :
— J’ai bien besoin d’une boîte de soldats !
Á mon tour je t’ai parfaitement compris, ce qui ne serait pas arrivé si, tout petit enfant, on ne m’avait pas appris à quel point sont indispensables et nécessaires les choses qui nous amusent.
Quand je m’étais bien régalé de bécasses, de perdreaux, d’œufs de carpe cuits au bleu, les servantes revenaient toujours courant, et le plus souvent, tant elles avaient peur d’être encore grondées, m’apportaient plusieurs violons rouges, en général accompagnés de quelques pantins, ma grand’mère leur ayant dit une fois pour toutes que pour moi on pouvait acheter tout ce qu’on voulait. Á ce moment-là, il ne tenait qu’à moi de retourner dans la classe de M. Dusselle, mais il était bien rare que j’en eusse la fantaisie. Au contraire, je prenais ma petite sœur par la main, et nous allions courir ensemble dans le vaste jardin que notre grand’mère ne devait jamais revoir ; nous nous en donnions à cœur joie, rouges, palpitants, essouflés, regardant voler les insectes, dévastant les fruits et tout, comme des Vandales, et nous barbouillant de raisins noires et de mûres. Quand nous étions bien fatigués, nous nous asseyions sur un banc, nous écoutions chanter les oiseaux, et je les accompagnais sur mon beau violon rouge. Á vrai dire, ce violon, que Chapié avait coloré du vermillon le plus fulgurant, ne produisait que des sons vagues et bizarres, et d’ailleurs je n’en savais pas jouer. J’en jouais cependant, pour le plaisir de me figurer que j’étais un petit musicien ; plus tard j’ai encore vécu d’une illusion pareille à celle-là ; j’ai passé ma vie à jouer d’un petit violon rouge que personne n’écoute, et qui peut-être reste muet sous mes doigts agiles, quand je me figure qu’il pleure et qu’il chante.
Cependant cinq grands cris d’airain sonore retentissaient dans l’air ; c’étaient monsieur et madame Jacquemart qui sonnaient cinq heures à l’horloge de la ville.
Au chant de la cloche envolée, je m’en allais chez mes parents, dans la maison voisine. Là, nouvelles caresses, nouveaux baisers, nouveaux joujoux, et, il faut bien l’avouer, nouveau festin. Après un premier dîner comme celui que j’avais fait déjà, Gargantua n’aurait pas eu faim ; mais moi j’avais presque faim, car il y a des grâces d’état pour les enfants de six ans, et cet âge est plein de pitié pour les friandises.
Et puis, bien qu’alors ils ne fussent pas riches, mes parents avaient une Nanette qui, mieux que l’ingénieux moine, aurait véritablement fait une soupe au caillou rien qu’avec un caillou, et un mets appétissant avec la culotte de peau d’un capitaine. Il fallait voir comme elle accommodait un chou farci, comme elle écrivait bien mon nom sur les crèmes avec du caramel, et quel savoureux coulis elle versait sur l’omelette aux laitances ! Ah ! Nanette, j’ai bien des fois songé à toi, lorsque, ma grand’mère morte, j’ai été amené à Paris, et écroué prisonnier dans la pension où il n’y avait jamais de violons rouges ! Là, dans le triste jardin où les arbres étaient plantés en rang dans le sable comme des quilles, il n’y avait aussi ni pruniers, ni abricotiers, ni framboisiers, ni groseilliers, ni pièce d’eau où croissent des lotus et où voltigent les libellules ! Il y avait bien des oiseaux, mais c’étaient des moineaux de Paris, ironiques et gouailleurs comme les autres écoliers ; il est vrai qu’ils m’ont appris à prendre le temps comme il vient et à me moquer du monde ; mais ce talent que je leur ai dû ne m’empêchait pas de regretter les fauvettes et les rossignols.
Le premier repas qu’il me fut donné de voir dans le réfectoire de cette pension me laissa prodigieusement ébloui et stupéfait. Je dis voir, car, grâce à Dieu, je n’ai jamais goûté à ces nourritures que je ne veux ni me rappeler ni décrire ; j’aimais mieux avoir toujours faim ; et quelles relations aurais-je pu entretenir avec les soupes claires comme le ruisseau d’argent qui court sous les saules, avec les poissons navrés et les viandes anémiques, moi nourri de la cuisine savante et raffinée d’une Nanette Coudour. Dès que la frissonnante Aurore secouait dans les cieux son voile rose, l’abondance était soigneusement mélangée dans des carafes de verre sans bouchon aux larges gueules, et on l’exposait au soleil, où elle cuisait dans son amertume. Quant au pain, toujours non cuit, il était acheté pour dix jours et rangé dans un placard en contre-bas tapissé de papier bleu ; quand on nous le donnait, la mie était devenue dure, et sur la croûte blanche et molle s’étaient collés de grands morceaux de papier bleu ! Voilà comment, ainsi préparé et guéri par de telles épreuves, j’ai pu sans terreur embrasser la profession de poète lyrique, où on ne mange pas, mais où du moins on ne fait pas semblant de manger, ce qui est beaucoup plus net. »
Chez madame de Warens
Jean-Jacques Rousseau,
Les Confessions, Livre troisième
« On ne trouvait pas chez Madame de Warens la magnificence que j’avois vue à Turin, mais on y trouvoit la propreté, la décence et une abondance patriarcale avec laquelle le faste ne s’allie jamais. Elle avoit peu de vaisselle d’argent, point de porcelaine, point de gibier dans sa cuisine, ni dans sa cave de vins étrangers ; mais l’une et l’autre étoient bien garnies au service de tout le monde, et dans des tasses de fayance, elle donnoit d’excellent café. Quiconque la venoit voir étoit invité à dîner avec elle ou chez elle, et jamais ouvrier, messager ou passant ne sortoit sans manger ou boire. Son domestique étoit composé d’une femme de chambre fribourgeoise assez jolie appellée Merceret, d’un valet de son pays appellé Claude Anet dont il sera question dans la suite, d’une cuisinière et de deux porteurs de louage quand elle alloit en visite, ce qu’elle faisoit rarement. […]
La manière dont son ménage étoit monté étoit precisement celle que j’aurois choisie ; on peut croire que j’en profitois avec plaisir. Ce qui m’en plaisoit moins étoit qu’il falloit rester très longtems à table. Elle supportoit avec peine la prémière odeur du potage et des mets. Cette odeur la faisoit presque tomber en défaillance, et ce dégout duroit lontems. Elle se remettoit peu-à-peu, causoit, et ne mangeoit point. Ce n’étoit qu’au bout d’une demie heure qu’elle essayoit le premier morceau. J’aurois dîné trois fois dans cet intervalle : mon repas étoit fait lontems avant qu’elle eut commencé le sien. Je recommençois de compagnie ; ainsi je mangeois pour deux, et ne m’en trouvois pas plus mal. »
Un menu de convives
Émile Legouvé,
1883*
« Le comte de B…, que j’ai connu dans ma jeunesse, me faisait l’effet d’un portrait du dix-huitième siècle. Il était célèbre par ses dîners. J’y ai assisté quelquefois, et j’en ai gardé souvenir. Á quoi tenait leur charme ? Á ce qu’il y avait deux menus également excellents, menu de mets et menu de convives.
Le comte s’occupait avant tout du second, mais sans négliger le premier. Il prétendait que pour avoir une bonne maison, il faut que le mari ou la femme soit un peu gourmand, et comme la comtesse n’y entendait rien, il l’était pour elle et pour lui. Aujourd’hui, un homme qui dîne en ville cinq fois dans une semaine, fait cinq fois le même dîner. La salle à manger change, le repas ne change point. Parti de chez un des grands marchands de comestibles de Paris, il porte toujours la même marque de fabrique ; c’est de la cuisine d’exportation. Le comte méprisait fort ces repas de pacotille. Quand on dînait chez lui, il ne voulait pas qu’on crût dîner chez un traiteur ; ses prétentions de famille s’étendaient jusqu’à l’office ; il avait des traditions d’entremets. Je l’entends encore me dire, un jour où j’étais assis à côté de lui, et où l’on m’offrait un plat que je refusais :
— Prenez, mon cher ami, c’est de l’ancienne cuisine.
Je ne voudrais pas qu’on prît là-dessus mon hôte pour un disciple de Brillat-Savarin. La gourmandise chez lui n’était qu’une des formes de l’hospitalité ; il en avait toutes les coquetteries. S’il tenait tant au choix de ses vins et de ses plats, c’est qu’il les estimait très propres à mettre les esprits en belle humeur et les imaginations en éveil. Aussi le menu des convives était-il son grand souci. Il le composait comme on compose un concert : un mélange de voix qui s’harmonisent et d’instruments qui se complètent ! Il se défiait des gens qui se connaissent beaucoup et des gens qui ne se connaissent pas du tout. Les premiers, disait-il, font trop d’aparté ; les seconds, trop de silences. Ce qu’il aimait à combiner, c’étaient ces rencontres imprévues, ces petits mariages d’inclination subite entre personnes qu’on présente l’une à l’autre, et qui s’écrient : “ Ah ! Monsieur ! il y a bien longtemps que j’avais envie de vous voir ! ” Le choix des places à table l’occupait fort aussi. Dans les dîners officiels, en province surtout, la préséance joue un grand rôle. Le culte de la hiérarchie dans la salle à manger est un des talents d’un préfet. Tel grand fonctionnaire s’est brouillé avec la préfecture pour n’avoir pas eu à table la place qu’il jugeait la sienne. Rien de pareil chez le comte de B… La fonction, le titre, la fortune, l’âge même, ne comptaient pas chez lui. Le mérite et la convenance marquaient seuls les rangs ; puis, une fois le service commencé, commençait son petit travail de chef d’orchestre.
On raconte que sous le ministère de M. Necker, les grandes réceptions, les grands dîners, constituaient pour Mme Necker une préoccupation qui était presque une profession. Elle travaillait ses causeries trois jours d’avance. On a trouvé sur un de ses carnets ce mot caractéristique : “ Penser à relouer M. Thomas sur sa Pétréide. ” Le comte de B… était trop homme du monde pour avoir un tel souci. Sachant que la causerie est, de sa nature, chose ailée et demande, avant tout, souplesse et liberté, il se gardait bien de faire des scénarios de conversation ; seulement il pensait d’avance à deux ou trois faits curieux, à deux ou trois livres intéressants, pour pouvoir au besoin les jeter au milieu de la conversation languissante, comme on jette une brassée de bruyère dans un foyer près de s’éteindre. Cela fait reflamber, disait-il, l’imagination et l’esprit. Il n’aimait pas à sa table les oracles qui prennent le dé et ne le quittent pas ! Ces gens-là lui faisaient l’effet d’un violoniste qui voudrait jouer tout seul dans un orchestre. Chacun son tour ! était sa devise, et j’admirais son art merveilleux pour utiliser toutes les supériorités admises chez lui : il les introduisait successivement dans la conversation, sans qu’elles s’en doutassent, par un mélange de transitions adroites, et faisait succéder un savant à un artiste, et un homme politique à un voyageur, comme il faisait passer un pâté de foie gras après des suprêmes de volaille, et le vin de Champagne après le vin de Bordeaux.
Je l’ai vu un jour bien malheureux. Il avait invité un député et un professeur. Le député avait la rage de s’écrier, en frappant la table du poing : “ Messieurs, posons la question. — Mais non, non mon cher ami, répliquait vivement le comte, ne la posons pas ! La question ici c’est de s’amuser comme des honnêtes gens ; laissez-nous tranquilles avec vos effets de tribune !… ” Le député se mit à rire et se consola de se taire en buvant. Mais il n’en alla pas si facilement avec le professeur. Il avait un grand malheur : il était éloquent ! Les éloquents tiennent beaucoup de place ! ils aiment à s’étaler ! Quand le professeur tenait un sujet, il ne le lâchait qu’après l’avoir traité à fond. Le comte avait beau tenter des diversions et couper le fil du discours ; l’orateur reprenait de plus belle après l’interruption ; le flot recommençait à couler, les phrases interrompues se rejoignaient comme des tronçons de serpent, si bien que le comte, désespéré de voir les figures de ses convives s’allonger, et son dîner tourner à l’ennui, prit le parti héroïque de renverser, comme par hasard, sur la nappe un verre de vin rouge. Cela noya tout, et la voix de l’orateur se perdit dans le brouhaha de cette maladresse préméditée.
Ce petit fait en dit plus sur le comte de B… que toutes les paroles ; et il m’a semblé que dans ce temps de grands banquets à toastset à speeches, on ne regarderait pas sans quelque plaisir cette figure d’un artiste en causerie, artiste désintéressé, n’ayant d’autre prétention à l’esprit que de faire valoir l’esprit des autres, mettant toute son ambition à ce qu’on s’amusât chez lui, à ce qu’on fût aimable chez lui, et satisfait de sa journée quand chacun de ses convives se levait de sa table, content de ses voisins et de lui-même. »
* Ce texte appartient à une lettre adressée par son auteur à Édouard Charton, directeur du Magasin Pittoresque. Elle fut, d’ailleurs, publiée dans cette revue, en juillet 1883.

Le plus beau dîner du monde
Villiers de L’Isle-Adam
Contes Cruels, 1883
« Xanthus, le maître d’Ésope, déclara, sur la suggestion du fabuliste, que, s’il a avait parié qu’il boirait la mer, il n’avait point parié de boire les fleuves qui “ entrent dedans ”, pour me servir de l’aimable français de nos traducteurs universitaires.
Certes, une telle échappatoire était fort avisée ; mais, l’Esprit de progrès aidant, ne saurions-nous en trouver, aujourd’hui, d’équivalentes ? de tout aussi ingénieuses ? — Par exemple :
“ Retirez, au préalable, les poissons, qui ne sont point compris dans la gageure ; filtrez ! — Défalcation faite de ces derniers, la chose ira de soi. ”
Ou, mieux encore :
“ J’ai parié que je boirais la mer ! bien ; mais pas d’un seul trait ! Le sage doit ne jamais précipiter ses actions : je bois lentement. Ce sera donc, simplement, une goutte, n’est-ce pas ? chaque année. ”
Bref, il est peu d’engagements qu’on ne puisse tenir d’une certaine façon… et cette façon pourrait être qualifiée de philosophique.
» — Le plus beau dîner du monde !
Telles furent les expressions dont se servit, formellement, Me Percenoix, l’ange de l’Emphytéose, pour définir, d’une façon positive, le repas qu’il se proposait d’offrir aux notabilités de la petite ville de D***, où son étude florissait depuis trente ans et plus.
Oui. Ce fut au cercle, — le dos au feu, les basques de son habit sous les bras, les mains dans les poches, les épaules tendues et effacées, les yeux au ciel, les sourcils relevés, les lunettes d’or sur les plis de son front, la toque en arrière, la jambe droite repliée sur la gauche et la pointe de son soulier verni touchant à peine à terre, — qu’il prononça ces paroles.
Elles furent soigneusement notées en la mémoire de son vieux rival, Me Lecastelier, l’ange du Paraphernal, lequel, assis en face de Me Percenoix, le considérait d’un œil venimeux, à l’abri d’un vaste abat-jour vert.
Entre ces deux collègues, c’était une guerre sourde depuis le lointain des âges ! Le repas devenait le champ de bataille longuement étudié par Me Percenoix et proposé par lui pour en finir. Aussi Me Lecastelier, forçant à sourire l’acier terni de sa face de couteau-poignard, ne répondit-il rien, sur le moment. Il se sentait attaqué. C’était l’aîné : il laissait Percenoix, son cadet, parler et s’engager comme une petite folle. — Sûr de lui (mais prudent !), il voulait, avant d’accepter la lutte, se rendre un compte méticuleux des positions et des forces de l’ennemi.
Dès le lendemain, toute la petite ville de D*** fut en rumeur. On se demandait quel serait le menu du dîner.
Évoquant des sauces oubliées, le receveur particulier se perdait en conjectures. Le sous-préfet calculait et prophétisait des suprêmes de phénix servis sur leurs cendres ; — des phénicoptères inconnus voletaient dans ses rêves. Il citait Apicius.
Le conseil municipal relisait Pétrone, le critiquait. Les notables disaient : — “ il faut attendre ”, et calmaient un peu l’effervescence générale. Tous les invités, sur l’avis du sous-préfet, prirent des amers huit jours à l’avance.
Enfin, le grand jour arriva.
La maison de Me Percenoix était sise près des Promenades, à une portée de fusil de celle de son rival.
Dès quatre heures du soir, une haie s’était formée, devant la porte. sur deux rangs, pour voir venir les convives. Au coup de six heures, on les signala.
L’on s’était rencontré aux Promenades, comme par hasard, et l’on arrivait ensemble.
Il y avait, d’abord, le sous-préfet, donnant le bras à Mme Lecastelier ; puis le receveur particulier et le directeur de la poste ; puis trois personnes d’une haute influence ; puis le docteur, donnant le bras au banquier ; puis une célébrité, l’Introducteur du phylloxera en France; puis le proviseur du lycée, et quelques propriétaires fonciers. Me Lecastelier fermait la marche, prisant, parfois, d’un air méditatif.
Ces messieurs étaient en habit noir, en cravate blanche, et montraient une fleur à leur boutonnière : Mme Lecastelier, maigre, était en robe de soie couleur souris-qui-trotte, un peu montante.
Arrivés devant le portail, et à l’aspect des panonceaux qui brillaient des feux du couchant, les convives se retournèrent vers l’horizon magique : les arbres lointains s’illuminaient ; les oiseaux s’apaisaient dans les vergers voisins.
— Quel sublime spectacle ! s’écria l’Introducteur du phylloxera en embrassant, du regard, l’occident.
Cette opinion fut partagée par les convives, qui humèrent, un instant les beautés de la Nature, comme pour en dorer le dîner.
L’on entra. Chacun retint son pas dans le vestibule, par dignité.
Enfin, les battants de la salle à manger s’entrouvrirent. Percenoix, qui était veuf, s’y tenait seul, debout, affable. — D’un air à la fois modeste et vainqueur, il fit le geste circulaire de prendre place. De petits papiers portant le nom des convives étaient placés, comme des aigrettes, sur les serviettes pliées en forme de mitre. Mme Lecastelier compta du regard les convives, espérant que l’on serait treize à table : l’on était dix-sept. — Ces préliminaires terminés, le repas commença, d’abord silencieux ; on sentait que les convives se recueillaient et prenaient, comme on dit, leur élan.
La salle était haute, agréable, bien éclairée ; tout était bien servi. Le dîner était simple : deux potages, trois entrées, trois rôtis, trois entremets, des vins irréprochables, une demi-douzaine de plats divers, puis le dessert.
Mais tout était exquis !
De sorte que, en y réfléchissant, le dîner, eu égard aux convives et à leur nature, était, précisément, pour eux “ le plus beau dîner du monde ! ” Autre chose eût été de la fantaisie, de l’ostentation, — eût choqué. Un dîner différent eût, peut-être été qualifié d’atellane, eût éveillé des idées d’inconvenance, d’orgie…, et Mme Lecastelier se fût levée. Le plus beau dîner du monde n’est-il pas celui qui est à la pleine satisfaction du goût de ses convives ?
Percenoix triomphait. Chacun le félicitait avec chaleur.
Soudain, après avoir pris le café, Me Lecastelier, que tout le monde regardait et plaignait sincèrement, se leva, froid, austère, et, avec lenteur, prononça ces paroles — au milieu d’un silence de mort:
— J’en donnerai un plus beau l’année prochaine.
Puis, saluant, il sortit avec sa femme.
Me Percenoix s’était levé. Il calma, par son air digne, l’inexprimable agitation des convives et le brouhaha qui s’était produit après le départ des Lecastelier.
De toutes parts, les questions se croisaient :
— Comment ferait-il pour en donner un plus beau l’année prochaine, puisque celui de Me Percenoix était le plus beau dîner du monde ?
— Projet absurde !
— Équivoque !
— Inqualifiable !
— Non avenu…
— Risible !!!
— Puéril…
— Indigne d’un homme de sens !
— La passion l’avait emporté ! ; — l’âge, peut-être !
On rit beaucoup. — L’Introducteur du phylloxera, qui, pendant le festin, avait fait des mamours à Mme Lecastelier, ne tarissait pas en épigrammes :
— Ah ! ah ! En vérité !… Un plus beau ! — Et comment cela ? — Oui, comment cela ?… La chose était des plus gaies !
Il ne tarissait pas.
Me Percenoix se tenait les côtes.
Cet incident termina joyeusement le banquet. Portant aux nues l’amphitryon, les convives, bras dessus, bras dessous, s’élancèrent à la débandade hors de la maison, précédés des lanternes de leurs domestiques. Ils n’en pouvaient plus de rire devant l’idée saugrenue, présomptueuse même, et qui ne pouvait se discuter, de vouloir donner “ un plus beau dîner que le plus beau dîner du monde ”.
Ils passèrent ainsi, fantastiques et hilares, dans la haie qui les avait attendus à la porte pour avoir des nouvelles.
Puis — chacun rentra chez soi.
Me Lecastelier eut une indigestion épouvantable. On craignit pour ses jours. Et Percenoix, qui ne “ voulait pas la mort du pêcheur ”, et qui, d’ailleurs, espérait encore jouir, l’année suivante, du fiascoque ferait, nécessairement, son collègue, envoyait quotidiennement prendre le bulletin de la santé du digne tabellion. Ce bulletin fut inséré dans la feuille départementale, car tout le monde s’intéressait au pari imprudent : on ne parlait que du dîner. Les convives ne s’abordaient qu’en échangeant des mots à voix basse. C’était grave, très grave : l’honneur de l’endroit était en jeu.
Pendant toute l’année, Me Lecastelier se déroba aux questions. Huit jours avant l’anniversaire, ses invitations furent lancées. Deux heures après la tournée matinale du facteur, ce fut un branle-bas extraordinaire dans la ville. Le sous-préfet crut immédiatement de son devoir de renouveler la tournée des amers, par esprit d’équité.
Quand vint le soir du grand jour, les cœurs battaient. Ainsi que l’année précédente, les convives se rencontrèrent aux Promenades, comme par hasard. L’avant-garde fut signalée à l’horizon par les cris de la haie enthousiaste.
Et le même ciel empourprait, à l’Occident, la ligne des beaux arbres, lesquels étaient de magnifiques pieds de hêtre appartenant, par préciput et hors part, à Me Percenoix.
Les convives admirèrent tout cela de nouveau. Puis l’on entra chez M. et Mme Lecastelier, et l’on pénétra dans la salle à manger. Une fois assis, après les cérémonies, les convives, en parcourant le menu d’un œil sévère, s’aperçurent, avec une stupeur menaçante, que c’était le mêmedîner !
Étaient-ils mystifiés ? Á cette idée, le sous-préfet fronça le sourcil et fit, en lui-même, ses réserves.
Chacun baissa les yeux, ne voulant point (par ce sentiment de courtoisie, de tact parfait, qui distingue les personnes de province), laisser éprouver à l’amphitryon et à sa femme l’impression du profond mépris que l’on ressentait pour eux.
Percenoix ne cherchait même pas à dissimuler la joie d’un triomphe qu’il crut désormais assuré. Et l’on déplia les serviettes.
O surprise ! Chacun trouvait sur son assiette, — quoi ?… — ce qu’on appelle un jeton de présence, — une pièce de vingt francs.
Instantanément, comme si une bonne fée eût donné un coup de baguette, il y eut un sorte de “ passez, muscade ! ” général, et tous les “ jaunets ” disparurent dans l’enchantement d’une rapidité inconnue.
Seul, l’Introducteur du phylloxera, préoccupé d’un madrigal, n’aperçut le napoléon de son assiette qu’un bon moment après les autres. — Il y eut là un retard. — Aussi, d’un air gauche, embarrassé, et avec un sourire d’enfant, murmura-t-il du côté de sa voisine, quelques vagues paroles qui sonnèrent comme une petite sérénade :
— Suis-je étourdi ! quelle inadvertance ! — J’ai failli faire tomber… maudite poche !… Cependant, c’est celle qui a introduit en France… On perd souvent, faute de précautions… l’on met son argent dans un gousset, par mégarde ; puis, au moindre faux mouvement, — en déployant sa serviette, par exemple, — vlan ! crac ! bing ! bonsoir !
Mme Lecastelier sourit, en fine mouche.
— Distraction des grands esprits ! … dit-elle.
— Ne sont-ce pas les beaux yeux qui les causent ? répondit galamment le célèbre savant, en remettant dans sa poche de montre, avec une négligence enjouée, la belle pièce d’or qu’il avait failli perdre.
Les femmes comprennent tout ce qui est délicatesse, — et, tenant compte de l’intention qu’avait eue l’Introducteur du phylloxera, Mme Lecastelier lui fit la gracieuseté de rougir deux ou trois fois pendant le dîner, alors que le savant, se penchant vers elle, lui parlait à voix basse.
— Paix, monsieur Redoubté ! murmurait-elle.
Percenoix, en vraie tête de linotte, ne s’était aperçu de rien et n’avait rien eu ; — il jasait, en ce moment-là, comme une pie borgne, et s’écoutait lui-même, les yeux au plafond.
Le dîner fut brillant, très brillant. La politique des cabinets de l’Europe y fut analysée : le sous-préfet dut même regarder silencieusement, plusieurs fois, les trois personnes d’une haute influence, et celles-ci, pour lesquelles la Diplomatie n’avait dès longtemps plus d’arcanes, détournèrent les chiens par une volée de calembours qui firent l’effet de pétards. Et la joie des convives fut à son comble quand on servit le nougat, qui représentait, comme l’année précédente, la petite ville de D*** elle-même.
Vers les neuf heures de la soirée, chaque invité, en remuant discrètement le sucre dans sa tasse de café, se tourna vers son voisin. Tous les sourcils étaient haussés et les yeux avaient cette expression atone propre aux personnes qui, après un banquet, vont émettre une opinion.
— C’est le même dîner ?
— Oui, le même.
Puis, après un soupir, un silence et une grimace méditative :
— Le même, absolument.
— Cependant, n’y avait-il pas quelque chose ?
— Oui, oui, il y avait quelque chose !
— Enfin, — là, — il est plus beau !
— Oui, c’est curieux. C’est le même… et, cependant, il est plus beau !
— Ah ! voilà qui est particulier !
Mais en quoi était-ilplus beau ? Chacun se creusait inutilement la cervelle.
On se croyait, tout à coup, le doigt sur le point précis qui légitimait cette impression indéfinissable de différence que chacun ressentait — et l’idée, rebelle, s’enfuyait comme une Galathée qui ne voudrait pas être vue.
Puis on se sépara, pour mûrir le problème plus librement.
Et, depuis lors, toute la petite ville de D*** est en proie à l’incertitude la plus lamentable. C’est comme une fatalité !… Personne ne peut éclaircir le mystère qui pèse encore aujourd’hui sur le festin victorieux de Me Lecastelier.
Me Percenoix, quelques jours après, étant plongé dans cette préoccupation, — glissa dans son escalier et fit une chute dont il décéda. — Lecastelier le pleura bien amèrement.
Aujourd’hui, durant les longues soirées d’hiver, soit à la sous-préfecture, soit à la recette particulière, on parle, on devise, on se demande, on rêve, et le thème éternel est remis sur le tapis. On y renonce !… On arrive bien à un cheveu près, comme à l’aide d’une 168e décimale, puis l’xdu rapport se recule indéfiniment, entre ces deux affirmations à confondre l’Esprit humain, — mais qui constituent le Symbole des préférences indiscutables de la Conscience publique, sous la voûte des cieux :
Le même… et, cependant, plus beau ! »

La collation
Eugène Sue
Le Juif Errant, 1845 ?
« La princesse, suivie de Mme Grivois, sa femme de charge, donnait ses derniers ordres relativement à quelques préparatifs qui se faisaient dans un vaste salon. Au milieu de cette pièce était une grande table ronde, recouverte d’un tapis de velours cramoisi et entourée de plusieurs chaises, au milieu desquelles on remarquait, à la place d’honneur, un fauteuil de bois doré. Dans un des angles du salon, non loin de la cheminée, où brûlait un excellent feu, se dressait une sorte de buffet improvisé ; l’on y voyait les éléments variés de la plus friande, de la plus exquise collation. Ainsi, sur des plats d’argent, là s’élevaient en pyramides les sandwiches de laitance de carpe au beurre d’anchois, émincée de thon mariné et de truffes de Périgord (on était en carême) ; plus loin sur des réchauds d’argent à l’esprit-de-vin, afin de les conserver bien chaudes, des bouchées de queues d’écrevisses de la Meuse à la crème cuite fumaient dans leur pâte feuilletée, croustillante et dorée, et semblant défier en excellence, en succulence, de petits pâtés aux huîtres de Marennes étuvées dans du vin de Madère et aiguisées d’un hachis d’esturgeon aux quatre épices. Á côté de ces œuvres sérieuses venaient des œuvres plus légères, de petits biscuits soufflés à l’ananas, des fondants aux fraises, primeur alors fort rare ; des gelées d’orange servies dans l’écorce entière de ces fruits, artistement vidés à cet effet ; rubis et topazes, les vins de Bordeaux, de Madère et d’Alicante étincelaient dans de larges flacons de cristal, tandis que le vin de Champagne et deux aiguières de porcelaine de Sèvres, remplies l’une de café à la crème et l’autre de chocolat à la vanille ambrée, arrivaient presque à l’état de sorbets, plongés qu’ils étaient dans un grand rafraîchissoir d’argent ciselé, rempli de glace. Mais ce qui donnait à cette friande collation un caractère singulièrement apostolique et romain, c’étaient certains produits de l’office religieusement élaborés. Ainsi on remarquait de charmants petits calvaires en pâte d’abricot, des mitres sacerdotales pralinées, des crosses épiscopales en massepain auxquelles la princesse avait joint, par une attention toute pleine de délicatesse, un petit chapeau de cardinal en sucre de cerises, orné de cordelières en fil de caramel ; la pièce la plus importante de ces sucreries catholiques, le chef-d’œuvre du chef d’office de Mme de Saint-Dizier, était un superbe crucifix en angélique avec sa couronne d’épine-vinette candie.
Ce sont là d’étranges profanations dont s’indignent avec raison les gens même peu dévots. Mais, depuis l’impudente jonglerie de la tunique de Trève jusqu’à la plaisanterie effrontée de la châsse d’Argenteuil, les gens pieux à la façon de la princesse de Saint-Dizier semblent prendre à tâche de ridiculiser, à force de zèle, des traditions respectables. »

A la table d'un célèbre acteur
Victor Hugo
« Théâtre », Choses vues
« Frédérick Lemaître est bourru, morose, et bon. Il vit retiré avec ses enfants et sa maîtresse, qui est en ce moment Mlle Clarisse Miroy.
Frédérick aime la table. Il n’invite jamais personne à dîner que Porcher, le chef de la claque. Frédérick et Porcher se tutoient. Porcher a du bon sens, de bonnes manières et beaucoup d’argent, qu’il prête galamment aux auteurs dont le terme va échoir. Porcher est l’homme dont Harel disait : — Il aime, protège et méprise les gens de lettres.
Frédérick n’a jamais moins d’une quinzaine de plats à sa table. Quand la servante les apporte, il les regarde et les juge sans les goûter. Souvent il dit : — C’est mauvais. — En avez-vous mangé ? — Non, Dieu m’en garde ! — Mais goûtez-y. — C’est détestable. — Moi, je vais y goûter, dit Clarisse. — C’est exécrable. Je vous le défends. — Mais laissez-moi essayer. — Qu’on emporte ce plat ! c’est une ordure. — Et il fait venir sa cuisinière et lui lave la tête.
Il est extrêmement craint de tous dans sa maison. Ses domestiques vivent dans la terreur. Á table, s’il ne parle pas, personne ne dit mot. Qui oserait rompre le silence quand il se tait ? On dirait un dîner de muets ou un souper de trappistes, à la chère près. Il mange volontiers le poisson à la fin. S’il a un turbot, il se le fait servir après les crèmes. Il boit en dînant une bouteille et demie de vin de Bordeaux. Puis, après dîner, il allume son cigare et, tout en le fumant, il boit deux autres bouteilles de vin.
Avec tout cela, un comédien de génie et fort bonhomme. Il pleure aisément et pour un mot, dur ou doux, qu’on lui dit fâché. »
Un repas historique…


Un repas de « pensionnaire »
Honoré de Balzac
L’envers de l’histoire contemporaine
« La salle à manger, entièrement peinte en gris et garnie de boiseries, dont les dessins trahissaient le goût du siècle de Louis XIV, était contiguë à cette espèce d’antichambre où se tenait Manon, et paraissait être parallèle à la chambre de madame de La Chanterie qui communiquait sans doute avec le salon. Cette pièce n’avait pas d’autre ornement qu’un vieux cartel. Le mobilier consistait en six chaises dont le dossier de forme ovale offrait des tapisseries évidemment faites à la main par madame de La Chanterie, en deux buffets et une table d’acajou, sur laquelle manon ne mettait pas de nappe pour le déjeuner. Ce déjeuner, d’une frugalité monastique, se composait d’un petit turbot accompagné d’une sauce blanche, de pommes de terre, d’une salade et de quatre assiettées de fruits : des pêches, du raisin, des fraises et des amandes fraîches ; puis, pour hors-d’œuvre, du miel dans son gâteau comme en Suisse, du beurre et des radis, des concombres et des sardines. C’était servi dans cette porcelaine fleuretée de bluets et de feuilles vertes et menues qui, sans doute, fut un grand luxe sous Louis XVI, mais que les croissantes exigences de la vie actuelle ont rendue commune. »
Au pensionnat
Paul Verlaine,
Confessions
« La soupe fut servie, combien médiocre au prix des consommés parentals ! Du bouilli s’ensuivit, sec autant qu’était délicieusement entrelardé le bœuf d’à la maison avec son cortège de ces légumes divins dits du pot-au-feu : vinrent des haricots… rouges… de ne ressembler en rien aux farineux tendres et blancs, sous des condiments “ puissants et doux ” de la bonne table de papa et maman. En fait de dessert une pomme, comment déjà ? calvi, reinette, non certes, mais si peu mûre et tant meurtrie !… (ô les desserts de la rue alors Saint-Louis-des-Batignolles !) Et l’abondance dans la pourtant si belle timbale d’argent avec un beau V gravé et un beau 5 qui était mon numéro, l’abondance, mot charmant, seul mot vraiment digne d’être proféré, odieusement détourné de son sens, pour s’appliquer à une sorte d’eau de rinçure de bouteille que c’eût été encore un abus d’appeler de l’eau rougie ! Cette boisson pire que de l’eau tiède, je la comparai avec le doigt de bon vin pur qui m’était octroyé chez nous au dessert du déjeuner et, après la soupe, à dîner. C’en était trop ! ces impressions gastronomiques jointes à celles de l’étude sinistre et de la lugubre dictée me dictaient, sinon mon devoir, du moins l’acte à faire.
Et profitant, au retour du réfectoire, de la porte ouverte pour le départ des externes et de la confusion produite par ce départ croisant la théorie des pensionnaires revenant du réfectoire, — je m’enfuis. »
Pour adoucir la rigueur des colles
Marcel Pagnol
Souvenirs d'enfance, « Le Temps des Amours »
« Lagneau était le fils unique d'un maître camionneur du port de Marseille. […] Le camionneur, assez peu instruit lui-même, croyait à la vertu des études, et il était sur ce chapitre fort sévère pour son fils. C'est pourquoi, pendant la première année de sixième, Lagneau avait reçu un certain nombre de “ corrections ”, c'est-à-dire quelques volées de coups de canne dont la plus remarquable avait failli — selon lui — l'envoyer à l'hôpital : il me confia que sa peau en était restée zébrée de profondes cicatrices, […]. J'étais effrayé par la description d'aussi graves sévices, et je le regardai d'un air apitoyé : mais il cligna de l'œil et délara :
— Tout ça, c'est du passé, ça n'existe plus, parce que ma mère et ma tante, à force de réfléchir, ont trouvé un truc formidable, et maintenant je peux m'offrir gratuitement une ou deux retenues par semaine, et j'en rigole de bon cœur ! […]
Tous les jeudis matin, la tante-marraine, déguisée en alpiniste, venait appeler son neveu-filleul. Sous deux sacs tyroliens, qui contenaient le saucisson de l'excursionniste, l'omelette aux tomates, la côtelette crue, le pain, le gilet de laine et l'imperméable, griffant les trottoirs de leurs souliers à clous, ils partaient glorieusement pour aller purger deux heures de retenue, et parfois quatre, et parfois six… Le camionneur, comme la tante le lui avait promis, n'eut plus jamais à signer de bulletin de retenue : son épouse s'en était chargée, après un long entraînement clandestin… En arrivant au coin de la rue du lycée, la tante s'emparait du sac de son neveu, et Lagneau, pour gagner le lieu de sa détention, patinait gaiement sur le marbre des couloirs, dont ses clous d'alpiniste tiraient des fusées d'étincelles. Libéré à midi, il allait s'installer chez sa tante, pour y déguster non pas le casse-croûte du vaillant excursionniste, mais le pilaf de moules au riz, merveilleusement safrané, puis le poulet de grain rôti à la broche, entouré de pommes soufflées ou de champignons grillés sur une braise de sarments. Il croquait ensuite le dur nougat d'Arles, mastiquait l'onctueux calisson d'Aix, et se faisait enfin la bonne bouche avec un petit verre d'une liqueur appelée “ crème de cacao ”.
Parfois, il lui fallait retourner au lycée pour reprendre ses fers jusqu'à quatre heures, parfois même jusqu'à six heures. Mais, le plus souvent, il passait son après-midi au parc Borély, pour y faire de la bicyclette ou du canotage. Enfin, avant de rentrer chez lui, il étudiait les cartes des excursionnistes marseillais, et choisissait l'itinéraire de l'imaginaire randonnée, afin d'être en état de répondre aux questions vespérales que posait parfois le camionneur. »
Robert Burns,
Le Samedi soir du métayer
« Mais sur une table simple et rustique on a préparé le souper écossais. Ici est le Parritch, souverain des repas de la Calédonie ; le poudding favori des habitants de la montagne et de la plaine. Le lait de la seule vache de la maison a fourni cette soupe fumante : et Maggie (c’est le nom de la nourricière), séparée par une cloison légère, repose tout à côté en ruminant aussi son repas. La ménagère a soin d’observer qu’elle fait honneur à son jeune hôte, et que ce fromage, précieusement conservé depuis l’époque où le chanvre était en fleurs, tombe en sacrifice dans un si grand jour. On le presse ; il revient à ce mets favori ; cent fois, il lui prodigue des louanges qui gagnent le cœur de la frugale villageoise. Enfin le repas se termine ; un cercle se forme autour du foyer ; tout le monde a pris place et l’on se prépare en silence à écouter la lecture des saints Évangiles. »
Henry Miller,
Printemps Noir
« J’ai toujours été ahuri de la gaieté qui régnait dans ma famille, malgré toutes les calamités qui ne cessaient de nous menacer. Gais, en dépit de tout ! […] Une bande de rigolos, et la table toujours chargée de bonnes choses — choux rouges et salade verte, rôti de porc, dindon et choucroute, kartoffeln-kloösze au jus noir et aigre, radis et céleri, oie farcie et pois et carottes, beaux choux-fleurs blancs, compote de pommes et figues de Smyrne, bananes aussi grosses qu’une matraque, gâteaux à la cannelle et Streussel Kuchen, gâteaux au chocolat et noix de toute espèce, noix simples, noix huileuses, noix pékan, noix hickory, amandes, bière en tonneau et bière en bouteille, vins rouges et blancs, champagne, kümmel, malaga, porto, schnaps, fromages très forts, fromages sans goût et innocents, Hollande insipide, limburger et schmierkäse, vins maison, vin de sureau, cidre sec et doux, puddings au riz et au tapioca, châtaignes rôties, mandarines, olives, cornichons, caviar rouge et noir, esturgeon fumé, meringues au citron, biscuits à la cuillère, éclairs au chocolat, macarons, millefeuilles à la crème, cigares noirs, longs Virginias maigres, tabac Bull Durham et tabac Long Tom, meerschaums, épis de maïs et cure-dents, cure-dents en bois qui vous donnaient des abcès aux gencives le lendemain, serviettes immenses avec les initiales brodées dans le coin, et un feu de charbon ronflant et les fenêtres couvertes de buée, tout au monde, sauf un rince-doigts. »

Un pique-nique au bord de l'eau

Colette,
Le blé en herbe
« Par le plus beau matin d’août, Phil et Vinca décidèrent d’abandonner la table familiale et d’emporter, dans une anse à leur taille, leur déjeuner, leurs maillots de bain, et Lisette. Les années précédentes, ils avaient souvent déjeuné seuls, en explorateurs, dans des creux de falaises ; plaisir usé, plaisir gâté maintenant par l’inquiétude et le scrupule. Mais le plus beau matin rajeunissait jusaqu’à ces enfants égarés et qui se tournaient parfois, plaintivement, vers la porte invisible par où ils étaient sortis de leur enfance. Philippe alla devant, sur le chemin de la douane, portant les havenets pour la pêche d’après-midi, et le filet où tintaient le litre de cidre mousseux et la bouteille d’eau minérale. Lisette, en chandail et maillot de bain, balançait le pain tiède noué dans une serviette, et Vinca fermait la marche, ficelée de sweater bleu et de culottes blanches, chargée de paniers comme un âne d’Afrique. Aux tournants accidentés, Philippe criait sans se retourner :
— Attends, je vais prendre un des paniers !
— Ce n’est pas la peine, répondait Vinca.
Et elle trouvait moyen de diriger Lisette, quand les fougères hautes submergeaient la petite tête et sa calotte de raides cheveux blonds.
Ils choisirent leur crique, une faille entre deux rochers, que les marées avaient pourvue de sable fin, et qui s’évasait en corne d’abondance jusqu’à la mer. Lisette quitta ses sandales et joua vec des coquilles vides. Vinca roula sur ses cuisses brunes sa culotte blanche et creusa la sable humide sous une roche, pour y coucher au frais les bouteilles.
— Tu veux que je t’aide ? proposa mollement Philippe.
Elle ne daigna pas répondre et le regarda en riant silencieusement. Le bleu rare de ses yeux, ses joues assombries par le fard chaud qu’on voit aux brugnons d’espalier, la double lame courbe de ses dents, brillèrent un moment avec une force de couleurs inexprimable dont Philippe se sentit comme blessé. Mais elle se détourna, et il la vit sans trouble aller, venir, se baisser agilement, libre et dévêtue comme un jeune garçon.
— On le sait, va, que tu n’as apporté que ta bouche pour manger ! cria Vinca. Ah ! ces hommes !
L’“ homme ” de seize ans accepta la raillerie et l’hommage. Il appela sévèrement Lisette quand la table fut mise, mangea les sandwiches que lui beurrait sion amie, but le cidre pur, trempa dans le sel la laitue et les dés de gruyère, lécha sur ses doigts l’eau des poires fondantes.Vinca veillait à tout comme un jeune échanson au front ceint d’une bandelette bleue. Elle détachait pour Lisette l’arête des sardines, dosait la boisson, pelait les fruits, puis se hâtait de manger, à grands coups de dents bien plantées. La mer descendante chuchotait bas, à quelques mètres ; une batteuse à grain bourdonnait là-haut sur la côte, et la roche, barbue d’herbe et de fleurettes jaunes, distillait près d’eux une eau sans sel, qui sentait la terre…
Philippe s’étendit, un bras plié sous la tête.
— Il fait beau, murmura-t-il.
Vinca, debout, les mains occupées à essuyer couteaux et verres, laissa tomber sur lui le rayon bleu de son regard. Il ne bougea pas, cachant le plaisir qu’il ressentait lorsque son amie l’admirait. Il se savait beau à cette minute, les joues chaudes, la bouche lustrée, le front couché dans un désordre harmonieux de cheveux noirs.
Vinca reprit sans mot dire sa besogne de petite squaw et Philippe ferma les yeux, bercé par le reflux, une lointaine cloche de midi, la chanson à mi-voix de Lisette. Un prompt et léger sommeil descendit sur lui, sommeil de sieste, percé par chaque bruit, mais utilisant chaque bruit au profit d’un rêve tenace : gisant sur cette côte blonde, après une dînette d’enfants, il fut en même temps un Phil très ancien et sauvage, dénué de tout, mais originairement comblé, puisqu’il possédait une femme… »

Le piège
Friedrich Dürrenmatt,
Le juge et son bourreau (trad. fr., 1970)
« Le soir même, à huit heures précises, comme il le lui avait expressément recommandé au téléphone, Tschanz arriva chez le commissaire Baerlach, dans sa maison de l’Altenberg. Á sa grande surprise, ce fut une soubrette en tablier blanc qui vint lui ouvrir. Dans l’entrée, tandis qu’elle lui prenait son manteau, le visiteur perçut les bruits caractéristiques d’une activité aussi fébrile qu’insolite dans la cuisine de cette maison de célibataire. Tschanz avait le bras gauche en écharpe, ce qui ne l’avait pourtant pas empêché de venir en auto. Lorsque la bonne lui ouvrit la porte de la salle à manger, sa surprise fut complète : la table était dressée pour deux, comme pour un festin, et éclairée aux chandelles. Baerlach, dans son fauteuil, le visage rosi par la paisible lumière, était l’image même de la sérénité imperturbable au haut bout de la table.
— Prends place, Tschanz ! fit-il en l’invitant du geste à s’asseoir dans le second fauteuil, avancé à l’autre bout de la table. Abasourdi, l’invité s’installa.
— Je ne savais pas que vous m’aviez prié à dîner! finit-il par articuler.
— Nous avons à fêter ton succès, dit le vieux commissaire, tout en écartant un peu le chandelier afin de voir son hôte bien dans les yeux. Puis il frappa dans ses mains et la porte s’ouvrit, livrant passage à une avenante et ronde femme qui portait un énorme plat à hors-d’ouvre copieusement garni. Sardines, écrevisses, macédoine de légumes, salades diverses, tomates, concombres, fèves, œufs mimosa, viandes froides, charcuterie, saumon rose, avec des montagnes de mayonnaise. Le vieux commissaire prit de tout et Tschanz, stupéfait de voir ce qu’il destinait à son estomac malade, se servit distraitement d’un peu de salade de pommes de terre.
— Que boirons-nous ? Du Gléresse ? offrit Baerlach.
— Allons pour le Gléresse ! répondit Tschanz comme dans un rêve.
La servante arriva et remplit leurs verres, cependant que Baerlach dévorait, et avec du pain ! son assiettée gargantuesque. Lorsqu’il eut tout englouti, les sardines, les écrevisses rouges, le saumon, les saucissons et la viande froide, le blanc de poulet et les salades, il frappa dans ses mains, rappelant la servante et se resservit. Tschanz, éberlué, n’avait qu’à peine touché à sa salade de pommes de terre. Baerlach tendait son verre pour la troisième fois.
— Et maintenant les pâtés et le Neuchâtel rouge ! lança-t-il en terminant son assiette.
On leur changea les couverts et Baerlach déposa sur son assiette trois sortes de pâtés, tous trois truffés et relevés de foie gras.
— Mais, commissaire, et votre estomac ? finit par s’inquiéter Tschanz qui ne revenait pas de son étonnement;
— Pas aujourd’hui, Tschanz ! Pas le jour où je célèbre la capture de l’assassin de Schmiel, enfin ! dit le commissaire qui but deux grands verres de Neuchâtel, en absorbant avec enthousiasme es pâtés. On eût dit qu’il était avide de déguster tous les plats du monde, de manger toutes les nourritures de la terre, tel un démon qui aurait eu à apaiser une faim sans mesure. Et son ombre, double de taille, dessinait sur le mur sa silhouette puissante, amplifiant le mouvement des bras, de la tête, dansant une sorte de ballet cannibale. Tschanz ne pouvait laisser des yeux le spectacle inquiétant de ce grand malade, de cet homme mortellement atteint, qui déployait une activité triomphante à sa table, devant lui ; figé, raidi sur son siège, lui-même ne touchait à rien et il laissa jusqu’à son verre intact. L’infatigable Baerlach en était aux côtelettes de veau, au riz, aux pommes frites et à la salade verte, après quoi il se rafraîchit au champagne. Tschanz en eut le frisson.
— Ce n’est pas possible, vous n’êtes pas malade, dit-il presque sans voix. Vous nous avez joué la comédie.
La réponse ne vint pas aussitôt. Le commissaire se contenta de rire et se remit à déguster sa salade, feuille par feuille. Étrange et inquiétant vieillard, qui intimidait Tschanz au point qu’il n’osa lui adresser la parole de nouveau !
— Exactement, Tschanz ! finit-il par affirmer avec un éclat sauvage dans le regard. J’ai joué la comédie ; je n’ai jamais été malade;
Et il se remit à manger, reprenant de la viande et mastiquant infatigablement, sans s’occuper de rien d’autre, insatiablement.
Tschanz comprit alors qu’il était tombé dans un piège et que la trappe avait claqué derrière lui. Frissonnant, il se sentit soudain couvert de sueur froide et une affreuse angoisse le mordit au cœur. Une peur terrible l’envahit. Trop tard, il se rendait compte trop tard de sa position, quand déjà le salut n’était plus possible !
— Commissaire, vous savez ! dit-il d’une voix à peine audible.
— Oui, Tschanz, je sais ! fit Baerlach de sa voix tranquille et sûre, mais sans élever le ton, comme s’il ne disait rien que d’ordinaire. Tu es l’assassin de Schmiel.
Et, saisissant sa coupe de champagne, il la vida d’un trait.
— J’ai toujours eu le sentiment que vous le saviez, murmura Tschanz, sans voix. Le vieil homme eut l’air de n’y pas seulement prendre garde ; rien ne l’intéressait apparemment que le repas qu’il était en train de faire. Il se resservit copieusement de riz, qu’il arrosa de sauce, et prit une autre côtelette. Fourchette et couteau en mains, il se remit à sa dévoration colossale, contre laquelle Tschanz ne pouvait rien, devant laquelle il se sentait impuissant, bien qu’il voulût essayer encore de se défendre.
— La balle a été tirée par l’arme qu’on a trouvée dans la main du serviteur, s’obstina-t-il, mais sans parvenir à cacher le trouble désespéré de sa voix.
Les yeux plissés de Baerlach laissèrent fuser un éclair de dédain.
— C’est idiot, Tschanz ! Tu sais très bien que c’est ton revolver qui était dans la main de l’homme, quand on l’a trouvé. Et dans cette main, c’est toi qui l’avais mis. C’est uniquement parce qu’on a découvert en Gastmann un grand malfaiteur, que ton petit jeu n’a pas été percé à jour.
— Mais c’est ce que vous ne pourrez jamais prouver ! lança Tschanz au comble du désespoir.
Le vieux commissaire s’étira dans son fauteuil et se laissa aller à son confort, tout en vidant une nouvelle coupe de champagne. Il n’avait plus rien d’un malade à présent, plus rien de l’homme miné par une maladie grave et par l’âge : il apparaissait à la fois puissant et détendu, tel un fauve jouant avec sa proie, impressionnant de supériorité assurée et invincible. Il se fit apporter les fromages et encore des amuse-gueule acides, petits oignons blancs marinés, concombres au sel, radis noirs et autres. il avait l’air de ne vouloir pas s’arrêter de manger avant d’avoir goûté une dernière fois à toutes les délices que la terre peut offrir à l’homme ! C’était décourageant. »

Copyright Annie Perrier-Robert. © Tous droits réservés.
Ajouter un commentaire
Commentaires