A L'HEURE
DES FESTIVITES
« Notre monde est bien petit à côté du monde antique,
nos fêtes sont mesquines auprès des effrayantes somptuosités des patriciens romains et des princes asiatiques ; leurs repas ordinaires passeraient aujourd'hui pour des orgies effrénées,
et toute une ville moderne vivrait pendant huit jours de la desserte de Lucullus soupant avec quelques amis intimes. Nous avons peine à concevoir, avec nos habitudes misérables,
ces existences énormes, réalisant tout ce que l'imagination peut inventer de hardi, d'étrange
et de plus monstrueusement en dehors du possible. […] »
Théophile Gautier

Un repas
chez les « petits bourgeois »
Honoré de Balzac
Les petits bourgeois, 1839-1840
« […] Brigitte eut la satisfaction de voir la table bordée des principaux personnages de ce drame, que d'ailleurs son salon allait contenir tous, à l'exception de l'affreux Cérizet. Le portrait de cette vieille faiseuse de sacs serait peut-être incomplet si l'on omettait la description d'un de ses meilleurs dîners. La physionomie de la cuisinière bourgeoise en 1840 est d'ailleurs un de ces détails nécessaires à l'histoire des mœurs, et les habiles ménagères y trouveront des leçons. On n'a pas fait pendant vingt ans des sacs vides sans chercher les moyens d'en remplir quelques-uns pour soi. Or, Brigitte avait ceci de particulier, qu'elle unissait à la fois l'économie à laquelle on doit la fortune et l'entente des dépenses nécessaires. Sa prodigalité relative, dès qu'il s'agissait de son frère ou de Céleste, était l'antipode de l'avarice. Aussi se plaignait-elle souvent de ne pas être avare. Á son dernier dîner, elle avait raconté comment, après avoir combattu pendant dix minutes et avoir souffert le martyre, elle avait fini par donner dix francs à une pauvre ouvrière du quartier qu'elle savait pertinemment être à jeun depuis deux jours.
— La nature, dit-elle naïvement, a été plus forte que la raison.
La soupe offrait un bouillon quasi blanc ; car, même dans une occasion de ce genre, il y avait recommandation à la cuisinière de faire beaucoup de bouillon ; puis, comme le bœuf devait nourrir la famille le lendemain et le surlendeman, moins il fournissait de sucs au bouillon, plus substantiel il était. Le bœuf, peu cuit, s'enlevait toujours à cette phrase dite par Brigitte pendant que Thuillier y plongeait le couteau :
— Je le crois un peu dur ; d'ailleurs, va, Thuillier, personne n'en mangera, nous avons autre chose !
Ce bouillon était, en effet, flanqué de quatre plats montés sur de vieux réchauds désargentés et qui dans ce dîner, dit de la candidature, consistaient en deux canards aux olives, ayant en vis-à-vis une assez grande tourte aux quenelles et une anguille à la tartare répondant à un fricandeau sur de la chicorée.Le second service avait pour plat du milieu une sérénissime oie pleine de marrons, une salade de mâches ornée de ronds de betterave rouge, faisait vis-à-vis des pots de crème, et des navets au sucre regardaient une timbale de macaroni. Ce dîner de concierge qui fait noces et festins coûtait tout au plus vingt francs, les restes défrayaient la maison pendant deux jours, et Brigitte disait :
— Dame ! quand on reçoit, l'argent file !… c'en est effrayant !
La table était éclairée par deux affreux flambeaux de cuivre argenté, à quatre branches, et où brillait la bougie économique dite de l'étoile.Le linge resplendissait de blancheur, et la vieille argenterie à filets était de l'héritage paternel, le fruit d'achats faits pendant la Révolution par le père Thuillier, et qui servirent à l'exploitation du restaurant anonyme qu'il tenait dans sa loge, et qui fut supprimé en 1816 dans tous les ministères. Ainsi, la chère était en harmonie avec la salle à manger, avec la maison, avec les Thuillier, qui ne devaient pas s'élever au-dessus de ce régime et de leurs mœurs. Les Minard, Colleville et la Peyrade échangèrent quelques-uns de ces sourires qui trahissent une communauté de pensées satiriques, mais contenues. Eux seuls connaissaient le luxe supérieur, et les Minard disaient assez leur arrière-pensée en acceptant un pareil dîner. […]
[… ] Tout-à-coup, la vieille fille s'élança dans a cuisine en criant à Joséphine :
— Viens à la cave, ma fille !… il faut du vin de derrière les fagots !
— Mes amis, dit Thuillier d'une voix émue, voici le plus beau jour de ma vie, il est plus beau que ne sera celui de mon élection, si je puis consenttir à me laisser désigner aux suffrages de mes concitoyens (Allons ! allons !), car je me sens bien usé par trente ans de service public, et vous penserez qu'un homme d'honneur doit consulter ses forces et ses capacités avant d'assumer sur soi les fonctions de l'édilité…
— Je n'attendais pas moins de vous, môsieur Thuillier ! s'écria Phellion. Pardon ! voici la première fois de ma vie que j'interromps, et un ancien supérieur encore ; mais il y a des circonstances…
— Acceptez ! acceptez ! s'écria Zélie ; et nom d'un petit bonhomme ! il nous faut des hommes comme vous pour gouverner.
— Résignez-vous, mon chef ! dit Dutocq, et vive le futur conseiller municipal !… mais nous n'avons rien à boire…
[…] En ce moment, mademoiselle Thuillier parut suivie de ses deux domestiques ; elle avait la clef de la cave passée dans sa ceinture, et trois bouteilles de vin de Champagne, trois bouteilles de vin [vieux] de l'Hermitage, une bouteille de vin de Malaga, furent placées sur la table ; mais elle portait avec une attention presque respectueuse une petie bouteille, semblable à une fée Carabosse, qu'elle mit devant elle. Au milieu de l'hilarité causée par cette abondance de choses exquises, fruit de la reconnaissance, et que la pauvre fille, dans son délire, versait avec une profusion qui faisait le procès de son hospitalité de chaque quinzaine, il arrivait de nombreux plats de dessert : des quatre-mendiants en monceaux, des pyramides d'oranges, des tas de pommes, des fromages, des confitures, des fruits confits venus des profondeurs de ses armoires, qui, sans les circonstances, n'auraient pas figuré sur la nappe.
— Céleste, on va t'apporter une bouteille d'eau-de-vie que mon père a eue en 1802 ; fais-en une salade d'oranges ! cria-t-elle à sa belle-sœur. — Monsieur Phellion, débouchez le vin de Champagne ; cette bouteille est pour vous trois. — Monsieur Dutocq, prenez celle-ci ! — Monsieur Colleville, vous qui savez faire partir les bouchons !…
Les deux filles distribuaient des verres à vin de Champagne, des verres à vin de Bordeaux et des petits verres, car Joséphine apporta trois bouteilles de vin de Bordeaux.
— De l'année de la comète ! s'écria Thuillier. Messieurs, vous avez fait perdre la tête à ma sœur.
— Et, ce soir, du punch et des gâteaux, dit-elle. J'ai envoyé chercher du thé chez le pharmacien. Mon, Dieu ! si j'avais su qu'il s'agissait d'une élection, s'écriait-elle en regardant sa belle-sœur, j'aurais mis la dinde…
Un rire général accueillit cette phrase.
— Oh ! nous avions une oie, dit Minard fils en riant.
— Les charrettes y versent ! s'écria madame Thuillier en voyant servir des marrrons glacés et des meringues.
Mademoiselle Thuillier avait le visage en feu ; elle était superbe à voir, et jamais l'amour d'une sœur n'eut une expression si furibonde.
— Pour qui la connaît, c'est atendrissant ! s'écria madame Colleville.
Les verres étaient pleins, chacun se regardait, on semblait attendre un toast, et la Peyrade dit :
— Messieurs, buvons à quelque chose de sublime!…
Tout le monde fut dans l'étonnement.
— Á mademoiselle Brigitte !…
On se leva, l'on trinqua, l'on cria : “ Vive mademoiselle Thuillier ! ” tant l'expansion d'un sentiment vrai produit d'enthousiasme. »

La splendeur de Cléopâtre
Théophile Gautier,
Une nuit de Cléopâtre, VI
Cette nouvelle de Théophile Gautier fut initialement publiée, en six épisodes, dans La Presse, en 1838. Elle devait inspirer un opéra à Victor Massé, Une nuit de Cléopâtre, créé à l’Opéra-Comique, de Paris, en 1885.
« La salle du festin avait des proportions énormes et babyloniennes ; l’œil ne pouvait en pénétrer la profondeur incommensurable ; de monstrueuses colonnes, courtes, trapues, solides à porter le pôle, épataient lourdement leur fût évasé sur un socle bigarré d’hiéroglyphes, et soutenaient de leurs chapiteaux ventrus de gigantesques arcades de granit s’avançant par assises comme des escaliers renversés. Entre chaque pilier un sphinx colossal de basalte, coiffé du pschent, allongeait sa tête à l’œil oblique, au menton cornu, et jetait dans la salle un regard fixe et mystérieux. Au second étage, en recul du premier, les chapiteaux des colonnes, plus sveltes de tournure, étaient remplacés par quatre têtes de femmes adossées avec les barbes cannelées et les enroulements de la coiffure égyptienne ; au lieu de sphinx, des idoles à tête de taureau, spectateurs impassibles des délires nocturnes et des fureurs orgiaques, étaient assis dans des sièges de pierre comme des hôtes patients qui attendent que les festin commence.
Un troisième étage d'un ordre différent, avec des éléphants de bronze lançant de l'eau de senteur par la trompe couronnait l'édifice ; par-dessus, le ciel s'ouvrait comme un gouffre bleu, et les étoiles curieuses s'accoudaient sur la frise.
De prodigieux escaliers de porphyre, si polis qu’ils réfléchissaient les corps comme des miroirs, montaient et descendaient de tous côtés et liaient entre elles ces grandes masses d’architecture.
[…] Meïamoun était vêtu d’une tunique de lin constellée d’étoiles avec un manteau de pourpre et des bandelettes dans les cheveux comme un roi oriental. Cléopâtre portait une robe glauque, fendue sur le côté et retenue par des abeilles d’or ; autour de ses bras nus jouaient deux rangs de grosses perles ; sur sa tête rayonnait la couronne à pointes d’or. Malgré le sourire de sa bouche, un nuage de préoccupation ombrait légèrement son beau front, et ses sourcils se rapprochaient quelquefois avec un mouvement fébrile. Quel sujet peut donc contrarier la grande reine ! Quant à Meïamoun, il avait le teint ardent et lumineux d’un homme dans l’extase ou dans la vision ; des effluves rayonnants, partant de ses tempes et de son front, lui faisaient un nimbe d’or, comme à un des douze grands dieux de l’Olympe.
Une joie grave et profonde brillait dans tous ses traits ; il avait embrassé sa chimère aux ailes inquiètes sans qu’elle s’envolât ; il avait touché le but de sa vie. […]
Cléopâtre le fit asseoir à côté d’elle sur un trône côtoyé de griffons d’or et frappa ses petites mains l’une contre l’autre. Tout à coup des lignes de feux, des cordons scintillants dessinèrent toutes les saillies de l’architecture ; les yeux du sphinx lancèrent des éclairs phosphoriques, une haleine enflammée sortit du muffle des idoles ; les éléphants, au lieu d’eau parfumée, soufflèrent une colonne rougeâtre ; des bras de bronze jaillirent des murailles avec des torches au poing : dans le cœur sculpté des lotus s’épanouirent des aigrettes éclatantes.
De larges flammes bleuâtres palpitaient dans les trépieds d’airain, des candélabres géants secouaient leur lumière échevelée dans une ardente vapeur ; tout scintillait et rayonnait. Les iris prismatiques se croisaient et se brisaient en l’air ; les facettes des coupes, les angles des marbres et des jaspes, les ciselures des vases, tout prenait une paillette, un luisant ou un éclair.La clarté ruisselait par torrents et tombait de marche en marche comme une cascade sur un escalier de porphyre, l’on aurait dit la réverbération d’un incendie dans une rivière ; si la reine de Saba y eût monté, elle eût relevé le pli de sa robe, croyant marcher dans l’eau comme sur le parquet de glace de Salomon. Á travers ce brouillard étincelant, les figures monstrueuses des colosses, les animaux, les hiéroglyphes semblaient s’animer et vivre d’une vie factice ; les béliers de granit noir ricanaient ironiquement et choquaient leurs cornes dorées, les idoles respiraient avec bruit par leurs naseaux haletants.
L’orgie était à son plus haut degré ; les plats de langues de phénicoptères et de foies de scarus, les murènes engraissées de chair humaine et préparées de garum, les cervelles de paon, les sangliers pleins d’oiseaux vivants, et toutes les merveilles des festins antiques, décuplées et centuplées, s’entassaient sur les trois pans du gigantesque triclinium. Les vins de Crète, de Massique et de Falerne écumaient dans les cratères d’or couronnés de roses, remplis par des pages asiatiques dont les belles chevelures flottantes servaient à essuyer les mains des convives. Des musiciens jouant du sistre, du tympanon, de la sambuque et de la harpe à vingt et une cordes remplissaient les travées supérieures et jetaient leur bruissement harmonieux dans la tempête de bruit qui planait sur la fête : la foudre n’aurait pas eu la voix assez haute pour se faire entendre.
Meïamoun, la tête penchée sur l’épaule de Cléopâtre, sentait sa raison lui échapper ; la salle du festin tourbillonnait autour de lui comme un immense cauchemar architectural ; il voyait, à travers ses éblouissements, des perspectives et des colonnades sans fin ; de nouvelles zones de portiques se superposaient aux véritables, et s’enfonçaient dans les cieux à des hauteurs où les Babels ne sont jamais parvenues. S’il n’eût senti dans sa main la main douce et froide de Cléopâtre, il eût cru être transporté dans le monde des enchantements par un sorcier de Thessalie ou un mage de Perse. »
L’obscur pêcheur, qui avait osé déclarer son amour à la reine et à qui celle-ci avait accordé de vivre à son côté une nuit extravagante, devait s’effacer avec son rêve, aux premières lueurs du jour, en acceptant de vider d’un trait une coupe emplie d’une liqueur empoisonnée…

Carte postale publicitaire pour le Thé de l'Eléphant…
Le Festin
Philoxène de Cythère (IVe s. av. J. - C.)
Celui qu’Aristote qualifiait « d’amateur de dîner » était tout à la fois cuisinier et poète. On lui attribuait un grand savoir-faire en l’art d’accommoder les poissons.
« Puis des enfants, deux par deux,
Dressèrent pour nous de splendides
Tables, et d’autres suivaient,
Et d’autres encore jusqu’à
Remplir la pièce.
Elles brillaient sous l’éclat
Profond des lustres,
Auréolées de plats d’or,
De mets doucereux ou piquants,
Offrant en abondance
Tout ce que l’art inventa
Jamais pour ouvrir l’appétit
Et pour réjouir les papilles.
On apporta des paniers
De galettes plus blanches que neige,
Puis s’avança, oui mon cher,
Non pas un fait-tout de quat’sous,
Mais un rang de plateaux gigantesques
Où se pressaient des anguilles
Qui luisaient de fraîcheur et des gros
Congres panés à l’ancienne
Si bons que les dieux en raffolent.
Et dans un plat grand et rond,
Arriva une raie toute ronde,
Puis de petits poêlons
Qui portaient des paupiettes de raie,
Du foie de requin…
Suivit un mets raffiné
Et riche mêlant aux calmars
Les seiches aux bras innombrables,
Tendres bouclettes de chair.
Là-dessus, un poisson aussi large
Que notre table apparut,
Tout chaud arraché à la flamme ;
Ensuite, crachant
Force jets de vapeur, arrivèrent,
O doux ami, des sépias
Et des écrevisses dorées
Et croustillantes.
Puis des purées de légumes verts, frais cueillis, qui fondaient
Dessous la langue,
Et des pains bis, des chaussons
Garnis d’un mélange aigre-doux,
Bombés comme des marmites […]
Nous, au comble du bien-être,
On rotait déjà, rendant les armes !
Mais, par les dieux, on servit
Après, un grand monstre de thon
Braisé et sa sauce à l’oseille,
Dont le gras ventre brûlant
Fut bientôt découpé en rouelles
Par un couteau acéré.
Comme on lui aurait fait sa fête
Volontiers à ce thon,
Si on en avait eu la charge !…
Mais revenons au festin
Toujours pas fini ! Je m’engage
Á rapporter sans faiblir
Quels plats on servit dans la suite
— Tâche dont nul ne saurait
S’acquitter jusqu’au bout ! De bouillantes
Tripes nous furent livrées,
Puis ce fut le boyau d’un cochon
Nourri en ces murs, du jambon,
Du lard grésillant dans la poêle,
Et la cervelle coupée
En deux et bouillie d’un chevreau
De lait mijoté dans son jus
Qu’on vint déposer sur la table.
Des abats cuits à point,
Flanqués de plusieurs côtelettes
Grasses et blanches, suivaient,
Et le groin et la tête et les pieds,
Enfin, des gayettes de porc
Aux quatre épices.
Puis on porta des carrés
D’agneaux, de chevreaux cuits en broche,
Et — sublissime bonheur ! —,
De tendres tripes,
Suc de chevreaux et d’agneaux,
Qui font les délices des dieux,
Et que toi, doux ami,
Tu t’engloutirais volontiers !
Des râbles de lièvre, des grives
Farcies et, bien chaudes,
Des perdrix et des cailles affluaient sur les tables,
Près des corbeilles de pains
Moëlleux. Puis entrèrent les deux
Inséparables :
C’est le miel blond et la crème
Ferme, que tous les convives
(Moi y compris) proclamaient
Bien haut le plus doux des fromages.
Quand l’assistance eut mangé
Et bu tout son soûl, les servantes
Débarrassèrent les tables et des esclaves versèrent sur tous les doigts la caresse
Tiède de l’eau parfumée
De baume et d’huile d’iris.
Ils en versèrent
Á profusion pour chacun
De nous puis ils distribuèrent
Des serviettes en lin
Soyeux, des flacons qui fleuraient
L’ambroisie, et des tresses de fleurs violettes. »
Les lois du banquet
Lucien, Dialogues divers
Cronosolon ou le Législateur des Saturnales
On ira au bain lorsque l’ombre du cadran sera de six pieds. Auparavant, on pourra s’amuser à jouer aux noix et aux dés. On s’asseoira à table comme on se trouvera, et l’on n’aura aucun égard à la dignité, à la noblesse, ou à la fortune, pour accorder quelque préférence. Tous les convives boiront du même vin. Le riche pour en boire un plus délicat, ne pourra alléguer aucun prétexte, ni mal d’estomac, ni douleur de tête ; la distribution des mets se fera avec égalité à tous les convives. Ceux qui serviront ne donneront rien à la faveur, ils ne feront point attendre, ils ne reculeront pas le service tant qu’il leur plaira; ils ne mettront point devant celui-ci une grosse pièce, et devant l’autre une pièce ridiculement petite, une cuisse de porc d’un côté, et de l’autre une bajoue ; mais ils serviront tout le monde également.
L’échanson aura continuellement les yeux fixés sur chacun des convives, plus encore que sur son maître ; il doit avoir l’oreille très fine, et entendre la moindre demande. Les vases de toute espèce seront préparés, et il sera permis, à qui le voudra, de porter une santé. Tout le monde pourra s’envoyer réciproquement la coupe après l’avoir goûtée, et l’envoyer même au patron. On ne forcera personne de boire plus qu’il ne peut. Il ne sera pas permis d’amener au banquet un danseur ou un musicien qui est encore à son apprentissage. On pourra plaisanter et faire des railleries tant qu’on voudra, pourvu qu’elles ne puissent fâcher personne ; ensuite on jouera des noix au damier. Si quelqu’un joue de l’argent, il sera condamné à ne pas manger jusqu’au lendemain. Chacun s’en ira ou restera quand il le voudra. Quand le patron régalera ses esclaves, il les servira lui-même, secondé de ses amis.
Que chaque riche ait soin de faire graver ces lois sur une colonne d’airain, qui sera dressée au milieu de sa cour, afin qu’on puisse les lire. Qu’il sache que tant que cette colonne subsistera, ni la famine, ni la peste, ni l’incendie n’entreront dans sa maison. Mais si jamais on la détruit (puisse cela n’arriver jamais !) je n’ose dire de quels maux affreux ils seront punis.

Illustration de William Strang, The Banquet of Beans, 1894
Un festin
dans l'antique Carthage
Gustave Flaubert,
Salambô
« C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar.
Les soldats qu’il avait commandés en Sicile se donnaient, un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d’Éryx, et, comme le maître était absent et qu’ils se trouvaient nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté.
Les capitaines, portant des cothurnes de bronze, s’étaient placés dans le chemin du milieu, sous un voile de pourpre à franges d’or, qui s’étendait depuis le mur des écuries jusqu’à la première terrasse du palais ; le commun des soldats était répandu sous les arbres, où l’on distinguait quantité de bâtiments à toit plat, pressoirs, celliers, magasins, boulangeries et arsenaux, avec une cour pour les éléphants, des fosses pour les bêtes féroces, une prison pour les esclaves.
Des figuiers entouraient les cuisines ; un bois de sycomores se prolongeait jusqu’à des masses de verdure, où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers ; des vignes, chargées de grappes, montaient dans le branchage des pins ; un champ de roses s’épanouissait sous des platanes ; de place en place sur des gazons se balançaient des lis ; un sable noir, mêlé à de la poudre de corail, parsemait les sentiers, et, au milieu, l’avenue des cyprès faisait d’un bout à l’autre comme une double colonnade d’obélisques verts.
Le palais, bâti en marbre numidique tacheté de jaune, superposait tout au fond, sur de larges assises, ses quatre étages en terrasses. Avec son grand escalier droit en bois d’ébène, portant aux angles de chaque marche la proue d’une galère vaincue, ses portes rouges écartelées d’une croix noire, ses grillages d’airain qui le défendaient en bas des scorpions, et ses treillis de baguettes dorées qui bouchaient en haut ses ouvertures, il semblait aux soldats, dans son opulence farouche, aussi solennel et impénétrable que le visage d’Hamilcar.
Le Conseil leur avait désigné sa maison pour y tenir ce festin ; les convalescents qui couchaient dans le temple d’Eschmoûn, se mettant en marche dès l’aurore, s’y étaient traînés sur leurs béquilles. Á chaque minute, d’autres arrivaient. Par tous les sentiers, il en débouchait incessamment, comme des torrents qui se précipitent dans un lac. On voyait, entre les arbres, courir les esclaves des cuisines, effarés et à demi nus ; les gazelles sur les pelouses s’enfuyaient en bêlant ; le soleil se couchait, et le parfum des citronniers rendait encore plus lourde l’exhalaison de cette foule en sueur.
Il y avait là des hommes de toutes les nations : des Ligures, des Lusitaniens, des Baléares, des Nègres et des fugitifs de Rome. On entendait, à côté du lourd patois dorien, retentir les syllabes celtiques bruissantes comme des chars de bataille, et les terminaisons ioniennes se heurtaient aux consonnes du désert, âpres comme des cris de chacal. Le Grec se reconnaissait à sa taille mince, l’Égyptien à ses épaules remontées, le Cantabre à ses larges mollets. Des Cariens balançaient orgueilleusement les plumes de leur casque, des archers de Cappadoce s’étaient peint avec des jus d’herbes de larges fleurs sur le corps, et quelques Lydiens portant des robes de femme dînaient en pantoufles et avec des boucles d’oreilles. D’autres, qui s’étaient par pompe barbouillés de vermillon, ressemblaient à des statues de corail.
Ils s’allongeaient sur les coussins, ils mangeaient accroupis autour de grands plateaux, ou bien, couchés sur le ventre, ils tiraient à eux les morceaux de viande, et se rassasiaient appuyés sur les coudes, dans la pose pacifique des lions lorsqu’ils dépècent leur proie. Les derniers venus, debout contre les arbres, regardaient les tables basses disparaissant à moitié sous des tapis d’écarlate, et attendaient leur tour.
Les cuisines d’Hamilcar n’étant pas suffisantes, le Conseil leur avait envoyé des esclaves, de la vaisselle, des lits ; et l’on voyait au milieu du jardin, comme sur un champ de bataille quand on brûle des morts, de grands feux clairs où rôtissaient des bœufs. Les pains saupoudrés d’anis alternaient avec les gros fromages plus lourds que des disques, et les cratères pleins de vin, et les canthares pleins d’eau auprès des corbeilles en filigrane d’or qui contenaient des fleurs. La joie de pouvoir enfin se gorger à l’aise dilatait tous les cœurs ; çà et là, les chansons commençaient.
D’abord on leur servit des oiseaux à la sauce verte, dans des assiettes d’argile rouge rehaussée de dessins noirs, puis toutes les espèces de coquillages que l’on ramasse sur les côtes puniques, des bouillies de froment, de fève et d’orge, et des escargots au cumin, sur des plats d’ambre jaune.
Ensuite les tables furent couvertes de viandes : antilopes avec leurs cornes, paons avec leurs plumes, moutons entiers cuits au vin doux, gigots de chamelles et de buffles, hérissons au garum, cigales frites et loirs confits. Dans des gamelles en bois de Tamrapanni flottaient, au milieu du safran, de grands morceaux de graisse. Tout débordait de saumur, de truffes et d’assa fœtida. Les pyramides de fruits s’éboulaient sur les gâteaux de miel, et l’on n’avait pas oublié quelques-uns de ces petits chiens à gros ventre et à soies roses que l’on engraissait avec du marc d’olive, mets carthaginois en abomination aux autres peuples. La surprise des nourritures nouvelles excitait la cupidité des estomacs. Les Gaulois aux longs cheveux retroussés sur le sommet de la tête s’arrachaient les pastèques et les limons qu’ils croquaient avec l’écorce. Des Nègres n’ayant jamais vu de langoustes se déchiraient le visage avec leurs piquants rouges. Mais les Grecs, rasés, plus blancs que des marbres, jetaient derrière eux les épluchures de leur assiette, tandis que les pâtres du Brutium, vêtus de peaux de loup, dévoraient silencieusement, le visage dans leur portion.
La nuit tombait. On retira le velarium étalé sur l’avenue des cyprès et l’on apporta des flambeaux.
Les lueurs vacillantes du pétrole qui brûlait dans des vases de porphyre effrayèrent, au haut des cèdres, les singes consacrés à la Lune.Ils poussèrent des cris, ce qui mit les soldats en gaieté.
Des flammes oblongues tremblaient sur les cuirasses d’airain. Toutes sortes de scintillements jaillissaient des plats incrustés de pierres précieuses. Les cratères, à bordure de miroirs convexes, multipliaient l’image élargie des choses ; les soldats se pressant autour s’y regardaient avec ébahissement et grimaçaient pour se faire rire. Ils se lançaient, par-dessus les tables, les escabeaux d’ivoire et les spatules d’or. Ils avalaient à pleine gorge tous les vins grecs qui sont dans des outres, les vins de Campanie enfermés dans des amphores, les vins des Cantabres que l’on apporte dans des tonneaux, et les vins de jujubier, de cinnamome et de lotus. Il y en avait des flaques par terre où l’on glissait. La fumée des viandes montait dans les feuillages avec la vapeur des haleines. On entendait à la fois le claquement des mâchoires, le bruit des paroles, des chansons, des coupes, le fracas des vases campaniens qui s’écroulaient en mille morceaux, ou le son limpide d’un grand plat d’argent. »
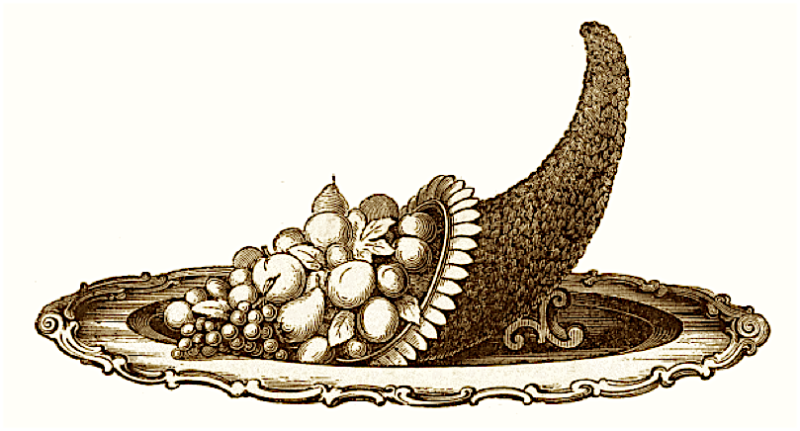
Un festin moyenâgeux
Edmond Richardin,
L’Art du Bien Manger, 1913
Edmond Richardin commente ce festin dans les termes suivants : « En 1367, vers Pâques fleuries, fut scellée à Vaucouleurs, entre le roi Charles V et Jean, duc de Lorraine, une alliance destinée à réprimer les actes de férocité commis par les bandes d’aventuriers qui désolaient à cette époque les campagnes du Barrois, de la Lorraine et de la Champagne. […]
Á l’occasion de ce traité célèbre, eut lieu chez Guérard, sire de Gombervaux, un festin fameux où Guillaume Tirel, dit Taillevent, maître-queux de Charles V, s’illustra par ses combinaisons gastronomiques. »
Il convient de noter que le château de Gombervaux, aujourd’hui en ruines, se dressait à trois kilomètres au nord de Vaucouleurs.
« Le cortège royal gravissait les coteaux,
Par les sentiers fleuris menant à Gombervaux,
Traversant la forêt dans les ombres du soir…
Enfin, les chevaliers arrivent au manoir !
Le guetteur, du donjon, annonce le retour
Aux Varlets empressés… Le gentil Troubadour,
Héros des cours d’amour, convie au gai festin
La Dame à robe d’or, que coiffe le hennin.
Dans la salle profonde, aux gothiques splendeurs,
S’avancent Charles cinq et Jean de Vaucouleurs,
Le duc de Bar, Robert, la duchesse Marie,
En une chappe d’or et de muguets fleurie,
Duguesclin et Clisson, le Bailli de Chaumont,
Le sire Jean de Longue et Thiébaut de Blamont,
Le Chevalier de Ville, et Guyot de Hamel,
Des Pages, des hérauts, maint joyeux Ménestrel.
Les murs sombres, tendus de cuir de l’Aragon,
Butin des longs combats, apporté d’outre-mont,
Heaumes et boucliers, accrochés aux portiques,
Redisent les exploits des âges héroïques ;
Des écuyers, porteurs de torches, de flambeaux,
Animent de lueurs les fresques des arceaux.
Les fleurs, les fruits dorés, les gerbes de glaïeuls,
Se mêlent, sur la table, aux rameaux des tilleuls,
De beaux Pages suivis d’un Varlet diligent,
Font couler l’hypocras dans les hanaps d’argent.
Les maîtres-queux, servant des sangliers entiers,
Des cerfs et des hérons, des faisans, des ramiers,
Précèdent le Trouvère au pourpoint de velours ;
Puis viennent des Jongleurs, Pastourels et Pastours,
Et les Joueurs de luths, de hautbois, de buccines,
Harmonisent leurs chants aux accords des doulcines.
La fête bat son plein : les Manants, les Rustauds,
S’ébattent librement à l’abri des préaux.
L’écho de leurs clameurs par la nuit des vallons,
Retentit, puis s’éteint dans le lointain des monts.
C’est fini ! Les Seigneurs descendent les coteaux,
Par les sentiers fleuris venant de Gombervaux,
Ils s’en vont chevauchant le vallon sinueux,
Dans la blonde clarté du matin lumineux. »

Un banquet princier
Walter Scott
Ivanhoe, 1819
« Le prince Jean tint son grand banquet dans le château d’Ashby. Ce n’était pas le même édifice que celui dont les superbes ruines intéressent encore le voyageur; et qui fut construit à une époque postérieure par lord Hastings, grand chambellan d’Angleterre, une des premières victimes de la tyrannie de Richard III, et plus connu encore comme un des principaux héros de Shakespeare que comme personnage historique.
Le château et la ville d’Ashby appartenaient alors à Roger de Quincy, comte de Winchester, qui, lors de notre histoire;, se trouvait en Palestine. Pendant son absence, le prince Jean occupa son château et disposa de ses domaines sans scrupule ; et, voulant en ce moment éblouir le peuple par son hospitalité et sa magnificence, il avait ordonné de grands préparatifs afin de rendre ce festin aussi splendide que possible. Les fournisseurs du prince, qui, en cette occasion comme en d’autres, s’arrogeaient l’autorité royale, avaient dépouillé le pays de tout ce qu’on avait pu trouver de convenable pour la table de leur maître. Les convives aussi furent invités en grand nombre, et, dans la nécessité où le prince Jean se trouvait alors de quêter la popularité, il avait étendu ses invitations à toutes les familles distinguées des Saxons et des Danois, aussi bien qu’aux seigneurs normands et à la petite noblesse des environs.
Quelque méprisés et déchus qu’ils fussent ordinairement, les Anglo-Saxons, par leur force numérique, devenaient nécessairement formidables dans les commotions civiles qui menaçaient l’État, et il était évidemment d’une saine politique de s’assurer la popularité de leurs chefs.
Il entrait donc dans les intentions du prince, intentions qu’il maintint pendant quelque temps, de traiter ces hôtes inaccoutumés avec une courtoisie à laquelle ils n’étaient pas habitués. Mais, bien que personne n’apportât moins de scrupule à faire plier devant les intérêts ses habitudes et ses sentiments ordinaires, la fatalité du prince voulait que sa légèreté et sa pétulance éclatassent sans cesse, détruisant ainsi tout ce qu’il avait gagné par sa dissimulation.
[…] D’après la résolution qu’il avait formée pendant ses moments de réflexion, le prince Jean reçut Cédric et Athelsthane avec une courtoisie parfaite, et exprima sans ressentiment ses regrets, quand le premier allégua l’indisposition de lady Rowena comme prétexte de ce qu’elle ne se rendait pas à sa gracieuse invitation.
Cédric et Athelsthane portaient l’un et l’autre l’ancien costume saxon, lequel, sans être laid, et bien que pour cette occasion, fait d’étoffes coûteuses, différait tellement de coupe et de forme de celui des autres convives, que le prince Jean se fit un titre de modération aux yeux de Waldemar Fitzurze de ne pas s’être mis à rire à la vue d’un costume que la mode du jour rendait ridicule.
[…] Les convives étaient placés à une table qui pliait sous le poids des mets. De nombreux cuisiniers, qui suivaient le prince dans ses voyages et qui avaient mis en œuvre toute leur science pour multiplier les formes sous lesquelles les provisions ordinaires étaient servies, avaient réussi, presque aussi bien que nos professeurs actuels dans l’art culinaire, à les rendre complètement méconnaissables à la vue.
Outre les produits indiqués, il y avait là une foule de friandises venues de l’étranger, et une grande quantité de pâtisseries de luxe, ainsi que des pains et des gâteaux savoureux employés seulement sur les tables de la haute noblesse.
Des vins exquis, tant indigènes qu’étrangers, mettaient le comble au luxe du festin.
Mais, bien qu’adonnés au luxe, les seigneurs, en général, n’étaient pas d’une race intempérante. En se livrant aux plaisirs de la table, ils recherchaient la délicatesse et évitaient les excès, et avaient l’habitude de reprocher l’ivrognerie et la gloutonnerie aux Saxons vaincus, comme des vices inhérents à leur basse condition.
Le prince Jean, à la vérité, et ceux qui cherchaient à lui plaire en imitant ses défauts, aimaient à se livrer aux plaisirs de la table. On sait que sa mort eut pour cause une indigestion causée par des pêches et de l’ale nouvelle. Sa conduite, toutefois, offrait une exception à celle de ses compatriotes. Avec une gravité moqueuse, seulement interrompue par des signes particuliers qu’ils se faisaient entre eux, les chevaliers normands observèrent le maintien rude d’Athelsthane et de Cédric pendant le banquet, à la forme duquel ils n’étaient pas habitués. Ce fut tandis qu’ils étaient l’objet d’une attention railleuse que les Saxons ignorants transgressèrent, à leur insu, plusieurs des règles arbitraires qu’on avait établies pour l’observation des convenances. Or, on sait bien qu’un homme est reconnu comme plus excusable en violant les lois morales, qu’en paraissant ignorer la moindre minutie des lois de l’étiquette.
Aussi Cédric, qui essuya ses mains avec une serviette au lieu de faire évaporer l’humidité en les secouant avec grâce en l’air, encourut-il plus de ridicule que son compagnon Athelsthane avalant à lui seul un pâté entier composé des friandises étrangères les plus exquises, et qu’on nommait en ce temps un karum pie.Quand on s’aperçut, par un examen plus approfondi, que le thane de Coningsburg, ou le franklin, comme disaient les Normands, n’avait nulle idée de la chose qu’il venait de dévorer, et qu’il avait pris le contenu du karum piepour des alouettes et des pigeons, tandis que c’étaient des becfigues et des rossignols, son ignorance l’exposa à un ridicule qu’il eût été plus juste d’attribuer à sa gloutonnerie.
Le long festin finit par avoir un terme, et tandis que la coupe circulait librement, les hommes causaient entre eux des prouesses du vainqueur inconnu au jeu de l’arc dans le tournoi ; du chevalier noir, que son désintéressement avait engagé à décliner les distinctions qui lui étaient dues, et du vaillant Invanhoé, qui avait payé si cher les honneurs de la journée. »

La générosité du général
Comtesse de Ségur,
L’Auberge de l’Ange-Gardien
« […] La porte du fond s’ouvrit, et un maître d’hôtel, en grande tenue parisienne, annonça :
“ Le général est servi. ”
Une salle immense s’offrit à la vue des convives étonnés et d’Elfy enchantée. La cour avait été convertie en salle à manger ; des tentures rouges garnissaient tous les murs ; un vitrage l’éclairait par en haut ; la table, de cinquante-deux couverts, était splendidement garnie et ornée de cristaux, de bronzes, de candélabres, etc.
Le général donna le bras à Elfy, qu’il plaça à sa droite ; à sa gauche, le curé ; près d’Elfy, son mari ; près du curé, le notaire. En face du général, Mme Blidot ; à sa droite, Dérigny et ses enfants ; à sa gauche, le maire et l’adjoint. puis les autres convives se placèrent à leur convenance.
“ Potages : bisque aux écrevisses ! potage à la tortue ! ” annonça le maître d’hôtel.
Tout le monde voulut goûter des deux pour savoir lequel était le meilleur ; la question resta indécise. Le général goûta, approuva et en redemanda deux fois. On se léchait les lèvres, les gourmands regardaient avec des yeux de convoitise ce qui restait des potages inconnus et admirables.
“ Turbot sauce crevette ! saumon sauce impériale! filets de chevreuil sauce madère ! ”
Le silence régnait parmi les convives ; chacun mangeait, savourait ; quelques vieux pleuraient d’attendrissement de la bonté du dîner et de la magnificence du général. Le citoyen qui connaissait si bien Paris et ses théâtres approuvait tout haut :
“ Bon ! très bon ! bien cuit ! bonne sauce ! comme chez Véry. ”
“ Ailes de perdreaux aux truffes ! ”
Mouvement général ; aucun des convives n’avait de sa vie goûté ni flairé une truffe ; aussi le maître d’hôtel estima-t-il fort heureux de pouvoir en fournir à toute la table ; le plat se dégarnissait à toute minute ; mais il y en avait toujours de rechange grâce à la prévoyance du général, qui avait dit :
“ Nous serons cinquante-deux ; comptez sur cent quatre gros mangeurs, et vous n’aurez pas de restes. ”
“ Volailles à la suprême ! ” reprit le maître d’hôtel quand les perdreaux et les truffes eurent disparu sans laisser de traces sur leur passage.
Jacques et Paul avaient mangé jusque-là sans mot dire. Á la vue des volailles ils reconnurent enfin ce qu’ils mangeaient.
‘ Ah ! voilà enfin de la viande, s’écria Paul.
— De la viande ? reprit le général indigné ; où vois-tu de la viande, mon garçon ?
Jacques.
Voilà, général ! dans ce plat. Ce sont les poulets de tante Elfy.
Le général, indigné.
Ma bonne madame Blidot, de grâce, expliquez à ces enfants que ce sont des poulardes du Mans, les plus fines et les plus délicates qui se puissent manger !
Elfy, riant.
Croyez-vous, général, que mes poulets ne soient pas fins et délicats ?
— Vos poulets ! vos poulets ! reprit le général contenant son indignation. Mon enfant, mais ces bêtes que vous mangez sont des poulardes perdues de graisse, la chair en est succulente…
Elfy.
Et mes poulets ?
Le général.
Que diantre ! vos poulets sont des bêtes sèches, noires, misérables, qui ne ressemblent en rien à ces grasses et admirables volailles.
Elfy.
Pardon, mon bon général ; ce que j’en dis, c’est pour excuser les petits, là-bas, qui ne comprennent rien au dîner splendide que vous nous faites manger.
Le général.
Bien, mon enfant ! ne perdons pas notre temps à parler, ne troublons pas notre digestion à discuter, mangeons et buvons. ”
Le général en était à son dixième verre de vin, on avait déjà servi du madère, du bordeaux-laffite, du bourgogne, du vin du Rhin : le tout première qualité. On commençait à s’animer, à ne plus manger avec le même acharnement.
“ Faisans rôtis ! coqs de bruyère ! gelinottes ! ”
Un frémissement de surprise et de satisfaction parcourut la salle. Le général regardait de l’air d’un triomphateur tous ces visages qui exprimaient l’admiration et la reconnaissance.
Succès complet ; il n’en resta que quelques os que les mauvaises dents n’avaient pu croquer.
“ Jambons de marcassin ! homards en salade ! ”
Chacun goûta, chacun mangea, et chacun en redemanda.
Le tour des légumes arriva enfin ; on était à table depuis deux heures. Les enfants de la noce, avec Jacques et Paul en tête, eurent permission de sortir de table et d’aller jouer dehors ; on devait les ramener pour les sucreries.
Après les asperges, les petits pois, les haricots verts, les artichauts farcis, vinrent les crèmes fouettées, non fouettées, glacées, prises, tournées. Puis les pâtisseries, babas, mont-blanc, saint-honoré, talmouses, croquembouches, achevèrent le triomphe du moderne Vatel et celui du général. Les enfants étaient revenus chercher leur part de friandises, et ils ne quittèrent la place que lorsqu’on eut bu les santés du général, des mariés, de Mme Blidot, avec un champagne exquis, trop exquis, car la plupart des invités quittèrent la table en chancelant et furent obligés de laisser passer l’effet du champagne dans des fauteuils, où ils dormirent jusqu’au soir.
Á la fin du dîner, après les glaces de diverses espèces, les ananas, les fruits de toutes saisons, les bonbons et autres friandises, Elfy proposa de boire à la santé de l’artiste auteur du dîner merveilleux dont on venait de se régaler.
Le général reçut cette proposition avec une reconnaissance sans égale. Il vit qu’Elfy savait apprécier une bonne cuisine, et, dans sa joie, il la proclama la perle des femmes. On but cette santé devant le héros artiste, que le général fit venir pour le complimenter, qui se rengorgea, qui remercia et qui se retira récompensé de ses fatigues et de ses ennuis.
La journée s’avançait ; le général demanda si l’on n’aimerait pas à la finir par un bal. on accepta avec empressement ; mais où trouver un violon ? Personne n’y avait pensé.
“ Que cela ne vous inquiète pas ! ne suis-je pas là, non ? Allons danser sur le pré d’Elfy ; nous trouverons bien une petite musique ; il n’en faut pas tant pour danser ; le premier crincrin fera notre affaire. ”
La noce se dirigea vers l’Ange-Gardien, qu’on trouva décoré comme la veille. On passa dans le jardin. Sur le pré étaient dressées deux grandes tentes, l’une pour danser, l’autre pour manger ; un buffet entourait de trois côtés cette dernière et devait, jusqu’au lendemain, se trouver couvert de viandes froides, de poissons, de pâtisseries, de crèmes, de gelées ; la tente de bal était couverte d’un côté et garnie des trois autres de candélabres, de fleurs et de banquettes de velours rouge à franges d’or. Au fond, sur une estrade, était un orchestre composé de six musiciens, qui commencèrent une contredanse dès que le général eut fait son entrée avec la mariée.
Les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde dansa ; le général ouvrit le bal avec Elfy, valsa avec Mme Blidot, dansa, valsa toute la soirée, presque toute la nuit comme un vrai sous-lieutenant ; il suait à grosses gouttes, mais la gaieté générale l’avait gagné, et il accomplissait les exploits d’un jeune homme. Elfy et Moutier dansèrent à s’exténuer, tout le monde en fit autant, en entrecoupant les danses de visites aux buffets ; on eut fort à faire pour satisfaire l’appétit des danseurs.
Á dix heures il y eut un quart d’heure de relâche pour voir tirer un feu d’artifice qui redoubla l’admiration des invités. Jamais à Loumigny on n’avait tiré que des pétards. Aussi le souvenir de la noce de Moutier à l’Ange-Gardien y est-il aussi vivant qu’au lendemain de cette fête si complète et si splendide. Mais tout a une fin, et la fatigue fit sonner la retraite à une heure avancée de la nuit. Chacun alla enfin se coucher, heureux, joyeux, éreinté. »
Le souper du roi
Akeandre Dumas,
Le Vicomte de Bragelonne, CLIII
« Le roi s’était mis à table pendant ce temps, et la suite peu nombreuse des invités du jour avait pris place à ses côtés après le geste habituel qui prescrivait de s’asseoir.
Dès cette époque, bien que l’étiquette ne fût pas encore réglée comme elle le fut plus tard, la France avait entièrement rompu avec les traditions de bonhomie et de patriarcale affabilité qu’on retrouvait encore chez Henri IV, et que l’esprit soupçonneux de Louis XIII avait peu à peu effacées, pour les remplacer par des habitudes fastueuses de grandeur qu’il était désespéré de ne pouvoir atteindre.
Le roi dînait donc à une petite table séparée qui dominait, comme le bureau d’un président, les tables voisines ; petite table, avons-nous dit : hâtons-nous cependant d’ajouter que cette petite table était encore la plus grande de toutes.
En outre, c’était celle sur laquelle s’entassaient un plus prodigieux nombre de mets variés, poissons, gibiers, viandes domestiques, fruits, légumes et conserves.
Le roi, jeune et vigoureux, grand chasseur, adonné à tous les exercices violents, avait, en outre, cette chaleur naturelle du sang commune à tous les Bourbons, qui cuit rapidement les digestions et renouvelle les appétits.
Louis XIV était un redoutable convive ; il aimait à critiquer ses cuisiniers ; mais, lorsqu’il leur faisait honneur, cet honneur était gigantesque.
Le roi commençait par manger plusieurs potages, soit ensemble, dans une espèce de macédoine, soit séparément. Il entremêlait ou plutôt il séparait chacun de ces potages d’un verre de vin vieux.
Il mangeait vite et assez avidement.
Porthos, qui dès l’abord avait par respect attendu un coup de coude de d’Artagnan, voyant le roi s’escrimer de la sorte, se retourna vers le mousquetaire, et dit à demi-voix :
— Il me semble qu’on peut aller, dit-il, Sa Majesté encourage. Voyez donc.
— Le roi mange, dit d’Artagnan, mais il cause en même temps ; arrangez-vous de façon à ce que si, par hasard, il vous adressait la parole, il ne vous prenne pas la bouche pleine, ce qui serait disgracieux.
— Le bon moyen alors, dit Porthos, c’est de ne point souper. Cependant j’ai faim, je l’avoue, et cela sent des odeurs appétissantes, et qui sollicitent à la fois mon odorat et mon appétit.
— N’allez pas vous aviser de ne point manger, dit d’Artagnan, vous fâcheriez Sa Majesté. Le roi a pour habitude de dire que celui-là travaille bien qui mange bien, et il n’aime pas qu’on fasse petite bouche à sa table.
— Alors, comment éviter d’avoir la bouche pleine si on mange ? dit Porthos.
— Il s’agit simplement, répondit le capitaine des mousquetaires, d’avaler lorsque le roi vous fera l’honneur de vous adresser la parole.
— Très-bien.
Et, à partir de ce moment, Porthos se mit à manger avec un enthousiasme poli.
Le roi, de temps en temps, levait les yeux sur le groupe, et, en connaisseur, appréciait les dispositions de son convive.
— Monsieur du Vallon ! dit-il.
Porthos en était à un salmis de lièvre, et en engloutissait un demi-râble.
Son nom, prononcé ainsi, le fit tressaillir, et, d’un vigoureux élan du gosier, il absorba la bouchée entière.
— Sire, dit Porthos d’une voix étouffée, mais suffisamment intelligible néanmoins.
— Que l’on passe à M. du Vallon ces filets d’agneau, dit le roi. Aimez-vous les viandes jaunes, monsieur du Vallon ?
— Sire, j’aime tout, répliqua Porthos.
Et d’Artagnan lui souffla :
— Tout ce que m’envoie Votre Majesté.
Porthos répéta :
— Tout ce que m’envoie Votre Majesté.
Le roi fit, avec la tête, un signe de satisfaction.
— On mange bien quand on travaille bien, repartit le roi, enchanté d’avoir en tête-à-tête un mangeur de la force de Porthos.
Porthos reçut le plat d’agneau et en fit glisser une partie sur son assiette.
— Eh bien ? dit le roi.
— Exquis ! fit tranquillement Porthos.
— A-t-on d’aussi fins moutons dans votre province, monsieur du Vallon ? continua le roi.
— Sire, dit Porthos, je crois qu’en ma province, comme partout, ce qu’il y a de meilleur est d’abord au roi ; mais, ensuite, je ne mange pas le mouton de la même façon que le mange Votre Majesté.
— Ah ! ah ! Et comment le mangez-vous ?
— D’ordinaire, je me fais accommoder un agneau tout entier.
— Tout entier ?
— Oui, sire.
— Et de quelle façon ?
— Voici : mon cuisinier, le drôle est Allemand, sire ; mon cuisinier bourre l’agneau en question de petites saucisses qu’il fait venir de Strasbourg ; d’andouillettes, qu’il fait venir de Troyes ; de mauviettes, qu’il fait venir de Pithiviers ; par je ne sais quel moyen, il désosse le mouton, comme il ferait d’une volaille, tout en lui laissant la peau, qui fait autour de l’animal une croûte rissolée ; lorsqu’on le coupe par belles tranches, comme on ferait d’un énorme saucisson, il en sort un jus tout rosé qui est à la fois agréable à l’œil et exquis au palais.
Et Porthos fit clapper sa langue.
Le roi ouvrit de grands yeux charmés, et, tout en attaquant du faisan en daube qu’on lui présentait :
— Voilà, monsieur du Vallon, un manger que je convoiterais, dit-il. Quoi ! le mouton entier ?
— Entier ; oui, sire.
— Passez donc ces faisans à M. du Vallon ; je vois que c’est un amateur.
L’ordre fut exécuté.
Puis, revenant au mouton :
— Et cela n’est pas trop gras ?
— Non, sire ; les graisses tombent en même temps que le jus et surnagent ; alors mon écuyer tranchant les enlève avec une cuiller d’argent, que j’ai fait faire exprès.
— Et vous demeurez ? demanda le roi.
— À Pierrefonds, sire.
— À Pierrefonds ; où est cela, monsieur du Vallon ? du côté de Belle-Isle ?
— Oh ! non pas, sire ; Pierrefonds est dans le Soissonnais.
— Je croyais que vous me parliez de ces moutons à cause des prés salés.
— Non, sire ; j’ai des prés qui ne sont pas salés, c’est vrai, mais qui n’en valent pas moins.
Le roi passa aux entremets, mais sans perdre de vue Porthos, qui continuait d’officier de son mieux.
— Ah ! ma foi ! sire, si Votre Majesté venait jamais à Pierrefonds, nous mangerions bien notre mouton à nous deux, car vous ne manquez pas d’appétit non plus, vous.
D’Artagnan poussa un bon coup de pied à Porthos sous la table. Porthos rougit.
— À l’âge heureux de Votre Majesté, dit Porthos pour se rattraper, j’étais aux mousquetaires, et nul ne pouvait me rassasier. Votre Majesté a bel appétit, comme j’avais l’honneur de le lui dire, mais elle choisit avec trop de délicatesse pour être appelée un grand mangeur.
Le roi parut charmé de la politesse de son antagoniste.
— Tâterez-vous de ces crèmes ? dit-il à Porthos.
— Sire, Votre Majesté me traite trop bien pour que je ne lui dise pas la vérité tout entière.
— Dites, monsieur du Vallon, dites.
— Eh bien, sire, en fait de sucreries, je ne connais que les pâtes, et encore il faut qu’elles soient bien compactes ; toutes ces mousses m’enflent l’estomac, et tiennent une place qui me paraît trop précieuse pour la si mal occuper.
— Ah ! Messieurs, dit le roi en montrant Porthos, voilà un véritable modèle de gastronomie. Ainsi mangeaient nos pères, qui savaient si bien manger, ajouta Sa Majesté, tandis que nous, nous picorons.
Et, en disant ces mots, il prit une assiette de blanc de volaille mêlée de jambon.
Porthos, de son côté, entama une terrine de perdreaux et de râles.
L’échanson remplit joyeusement le verre de Sa Majesté.
— Donnez de mon vin à M. du Vallon, dit le roi.
C’était un des grands honneurs de la table royale.
D’Artagnan pressa le genou de son ami.
— Si vous pouvez avaler seulement la moitié de cette hure de sanglier que je vois là, dit-il à Porthos, je vous juge duc et pair dans un an.
— Tout à l’heure, dit flegmatiquement Porthos, je m’y mettrai.
Le tour de la hure ne tarda pas à venir en effet, car le roi prenait plaisir à pousser ce beau convive ; il ne fit point passer de mets à Porthos qu’il ne les eût dégustés lui-même ; il goûta donc la hure. Porthos se montra beau joueur ; au lieu d’en manger la moitié, comme avait dit d’Artagnan, il en mangea les trois quarts.
— Il est impossible, dit le roi à demi-voix, qu’un gentilhomme qui soupe si bien tous les jours, et avec de si belles dents, ne soit pas le plus honnête homme de mon royaume.
— Entendez-vous ? dit d’Artagnan à l’oreille de son ami.
— Oui, je crois que j’ai un peu de faveur, dit Porthos en se balançant sur sa chaise.
— Oh ! vous avez le vent en poupe. Oui ! oui ! oui !
Le roi et Porthos continuèrent de manger ainsi à la grande satisfaction des conviés, dont quelques-uns, par émulation, avaient essayé de les suivre, mais avaient dû renoncer en chemin.
Le roi rougissait, et la réaction du sang à son visage annonçait le commencement de la plénitude.
C’est alors que Louis XIV, au lieu de prendre de la gaieté, comme tous les buveurs, s’assombrissait et devenait taciturne.
Porthos, au contraire, devenait guilleret et expansif.
Le pied de d’Artagnan dut lui rappeler plus d’une fois cette particularité.
Le dessert parut.
Le roi ne songeait plus à Porthos ; il tournait ses yeux vers la porte d’entrée, et on l’entendit demander parfois pourquoi M. de Saint-Aignan tardait tant à venir.
Enfin, au moment où Sa Majesté terminait un pot de confitures de prunes avec un grand soupir, M. de Saint-Aignan parut.
Les yeux du roi, qui s’étaient éteints peu à peu, brillèrent aussitôt.
Le comte se dirigea vers la table du roi, et, à son approche, Louis XIV se leva.
Tout le monde se leva, Porthos même, qui achevait un nougat capable de coller l’une à l’autre les deux mâchoires d’un crocodile. Le souper était fini. »
Le cadre de la noce
Victor Hugo
Les Misérables, V, 6
« Un banquet avait été dressé dans la salle à manger.
Un éclairage à giorno est l’assaisonnement nécessaire d’une grande joie. La brume et l’obscurité ne sont point acceptées par les heureux. Ils ne consentent pas à être noirs. La nuit, oui ; les ténèbres, non. Si l’on n’a pas de soleil, il faut en faire un.
La salle à manger était une fournaise de choses gaies. Au centre, au-dessus de la table blanche et éclatante, un lustre de Venise à lames plates, avec toutes sortes d’oiseaux de couleur, bleus, violets, rouges, verts, perchés au milieu des bougies ; autour du lustre des girandoles, sur les murs des miroirs-appliques à triples et quintuples branches ; glaces, cristaux, verreries, vaisselles, porcelaines, faïences, poteries, orfèvreries, argenteries, tout étincelait et se réjouissait. Les vides entre les candélabres étaient comblés par des bouquets, en sorte que, où il n’y avait pas une lumière, il y avait une fleur. »
La saveur de la dinde farcie
François Coppée,
Les Vrais Riches
« Á travers le brouillard moins épais et bleuté légèrement par la clarté lunaire, le prêtre distingua, au-dessus d’une muraille, une rondeur énorme et vague qui était le dôme du Panthéon. Il put même lire, au-dessus d’une porte grillée, ces mots peints en grosses lettres jaunes sur un écriteau noir :
“ Externat de jeunes filles, dirigé par Mlle Latournure. ”
C’était bien là qu’il avait affaire. Il sonna.
Une petite servante accourut, le bougeoir en main, et fut tout de suite impressionnée par la soutane et les cheveux blancs du vicaire.
“ Mademoiselle est à table… Mais çà ne fait rien… Entrez, monsieur l’abbé. ”
Et, après avoir fait traverser au bonhomme un minuscule jardinet où grelottaient dans la nuit quelques maigres squelettes de lilas, la petite servante ouvrit brusquement une porte d’où s’échappa, dans une vive clarté, une fusée de rires enfantins.
Ah ! l’aimable et gracieux spectacle !
C’était dans la classe, — la classe d’une pauvre école, — avec ses murailles badigeonnées de jaune, sa cathèdre noire surmontée du tableau des poids et mesures, ses cartes de France et d’Europe se faisant pendant, ses placards de ba be bi bo bu. Mais les tables à pupitres avaient été repoussées dans un coin, les bancs avaient été dressés contre les murs pour faire de la place ; et, au beau milieu de la vaste pièce, autour d’une nappe où deux grosses lampes à pétrole faisaient étinceler les verres et les assiettes, étaient attablées une vieille dame et une dizaine de petites filles.
La vieille dame avait dû être, dans les environs de la dictature du général Cavaignac, ce que certains vieillards appelaient encore, à cette époque, une brune piquante, et elle avait conservé, malgré les ans, des yeux noirs pleins de vivacité et un teint de pomme de reinette. Seulement ses “ anglaises ” — les dernières “ anglaises ”, en oreilles d’épagneul, — étaient à présent pareilles à de la soie blanche. Mais l’agréable sourire ! Et quel air de santé et de bonne humeur ! Au moment où l’abbé Moulin entra, la vieille dame, sa serviette fixée par deux épingles sur le corsage de sa robe de satin noir, de sa robe de cérémonie, — elle n’en avait évidemment pas trente-six, — venait de fendre, à l’aide d’un grand couteau à découper, le ventre d’une dinde rôtie, d’où se répandait dans le plat une cascade appétissante et parfumée de purée de marrons et de chair à saucisse. Et, devant ce beau spectacle, il fallait voir les paires d’yeux et entendre les cris des petites filles, immobiles de joie et d’admiration.
Bien sûr, elles n’en mangeaient pas tous les jours, les gamines, de la dinde rôtie aux marrons. Cela se devinait à la manière dont elles se tenaient en arrêt devant la mirifique volaille, leur couteau dans une main, leur fourchette dans l’autre, avec l’air de petites ogresses sentant la chair fraîche. Elles n’étaient pourtant pas des fillettes d’ouvriers, comme on en voit sortir de l’école primaire, en tablier noir et les cheveux dans un filet de chenille. On se nourrit bien dans le “ populo ”, au moins les samedis de quinzaine. Non, c’étaient des enfants de tout petits bourgeois, de pauvres honteux, des quasi-demoiselles, qui allaient à l’externat “ payant ”, chez Mlle Latournure, pourvue du brevet supérieur, s’il vous plaît.
Avant d’envoyer sa fille au dîner de “ Mademoiselle ”, la maman — femme d’un employé gêné ou modeste boutiquière ayant peine à joindre les deux bouts — avait fait friser la petite, l’avait paré d’un nœud de ruban, d’une collerette fraîchement repassée. Mais, n’importe ! on voyait bien que, pour tout ce monde-là, la dinde aux marrons était un régal extraordinaire et que ça les changeait, les gourmandes, des repas économiques comme on en fait dans les humbles ménages, des “ assiettes garnies ” de chez le charcutier, des restes du bouilli de la veille raccommodés avec de la sauce rousse et des cornichons.
Oh ! la belle dinde !
Entre nous, chère madame qui me lisez, cette dinde était d’une médiocre grosseur, et vous l’auriez eue, à la Halle, — en marchandant un peu et sans vous faire traiter de “ râleuse ”, — pour sept à huit francs. Elle aurait même semblé étique si on l’avait comparée aux monstres gonflés de graisse et tuméfiés de truffes qui trônent dans la vitrine de Chevet ; et l’abbé Moulin en avait vu de bien plus grosses dans ses dîners en ville chez les riches dévotes; Mais ce qu’il n’avait jamais vu, c’étaient tant de bons appétits autour d’une volaille ; et cela lui faisait plaisir, au brave homme.
Ce qui l’étonnait, par exemple, c’était l’air joyeux et bien portant de la vieille dame qui présidait le repas. Renaudel n’avait-il pas parlé de Mlle Latournure comme d’une personne triste et maladive ? Qu’est-ce que cela voulait dire ?
Á l’entrée de l’ecclésiastique, les petites filles s’étaient levées, par respect. La vieille dame en fit autant, tenant toujours à la main son grand couteau à découper.
“ Mademoiselle Latournure ? demanda le prêtre qui craignait une méprise.
— Pour vous servir, monsieur l’abbé, répondit-elle avec bonne grâce.
— Je suis désolé, mademoiselle, d’interrompre votre dîner… Mais je vous apporte une importante nouvelle… oh ! une bonne nouvelle… qui vous surprendra, très agréablement… et je désirerais vous parler un instant en particulier.
— Rien de plus facile, ” dit la vieille fille un peu émue.
Et s’adressant à la petite bonne :
“ Clémence, prenez une de ces lampes et conduisez monsieur l’abbé dans le parloir… Je vous suis, monsieur l’abbé. ”
Puis elle posa son grand couteau sur la table et promena son regard sur les petites filles.
“ Vous allez m’attendre un instant, mes enfants, et, n’est-ce pas ? vous serez bien sages ?
— Oui, mademoiselle, ” répondirent en chœur les gamines.
Mais c’était un chœur pareil à celui des tragédies antiques, un chœur de lamentations contenues et de larmes étouffées. Comment ? la belle dinde toute chaude, qui fumait et qui sentait si bon, la purée de marrons nageant dans le jus ! Il fallait rester là à les regarder sans y toucher, et les laisser refroidir !… Et il fallait répondre encore : “ Oui, mademoiselle, ” par politesse, par obéissance !
Ah ! le vilain prêtre ! […] Tout à coup, un cri aigre et prolongé, suivi de hoquets et de pleurs, se fit entendre dans la chambre voisine, à travers la cloison.
“ C’est Ernestine… s’écria Mlle Latournure en se levant d’un bond. Á cause de la dinde… Vous comprenez, un bébé, pas encore cinq ans… Mais ce n’est pas une raison, parce qu’il m’arrive un grand bonheur, pour que je les oublie, les pauvres petites. Au contraire !… Venez-vous, monsieur l’abbé ? Nous causerons aussi bien devant les enfants. ”
Très vive, elle rouvrit la porte, et sa rentrée dans la salle du festin fut saluée par une longue exclamation de toutes les petites filles. Ernestine, la pleureuse, qui était assise à côté de la place vide de l’institutrice, et rehaussée sur sa chaise par un vieux Bescherelle en deux volumes, cessa de crier immédiatement.
“ Clémence, un siège pour monsieur l’abbé, dit la vieille demoiselle en reprenant sa présidence et en s’armant de nouveau du grand couteau. Mais, j’y songe, monsieur l’abbé, vous n’avez sans doute pas encore dîné… Si vous vouliez nous faire le grand honneur ? … ”
Le bonhomme était à jeun et, en toute autre circonstance, il eût accepté avec empressement ; mais il lui fallait encore faire, avant minuit, deux autres visites, et puis il se fût reproché de prendre sa part de dinde, qui, nous l’avons dit, n’était pas déjà si grosse. Il s’excusa donc, et comme il avait grand’faim, il accepta seulement un doigt de vin et un biscuit.
Maintenant la volaille était découpée, oh ! en tout petits morceaux, en très minces aiguillettes ; car il fallait que tout le monde en eût, et tout le monde en avait dans son assiette, avec un peu de purée de marrons et de chair à saucisse. Clémence, la petite bonne, avait fait la distribution avec une équité salomonesque, et les gamines s’étaient mises à fonctionner énergiquement. Cette gourmande d’Ernestine, à qui le croupion était échu, avait même déjà des moustaches de graisse jusqu’aux oreilles.
“ Voyez-vous, monsieur l’abbé, dit alors Mlle Latournure qui promenait des regards ravis autour d’elle, je ne suis pas riche… ou, pour mieux dire, je n’étais pas riche, il y a cinq minutes… et mon petit externat me rapporte à peine de quoi vivre. Mais, tous les ans, la veille de Noël, je mange une dinde aux marrons avec quelques-unes de mes élèves, avec celles, vous sentez bien, chez qui je sais qu’il n’y aura pas de réveillon… Clémence, versez l’eau rougie. Ces enfants meurent de soif… C’est mon seul “ extra ” de l’année, ma petite débauche… Mais, n’est-ce pas, monsieur l’abbé, que c’est charmant à voir ? … ”
Puis, s’adressant brusquement à l’une des gamines :
“ Marie Duval, faites-moi le plaisir de ne pas sucer vos doigts et de manger plus proprement… Une grande fille de neuf ans ! … Vous n’avez pas honte ? Et maintenant que me voilà de nouveau à mon aise ! continua la bonne vieille, car, vous savez, Clémence, je vous annonce une nouvelle agréable. Vous n’aurez plus de discussions, désormais, avec le charbonnier et la laitière ; ils seront payés recta… Oui, maintenant que j’ai retrouvé mon avoir, je suis capable, monsieur l’abbé, de garder mon externat, rien qu’à cause du dîner des petites. Seulement, je m’offrirai maintenant ce régal à toutes les fêtes carillonnées, et la volaille sera énorme… Vous entendez, mes enfants ? ”
[…] En ce moment, Clémence, la petite bonne, qui avait disparu pendant deux minutes, apporta une large tarte aux pommes que les gamines saluèrent d’un long hurrah. La tarte fut placée devant Mlle Latournure, qui avant d’y porter le couteau, inspecta d’un regard circulaire toute la marmaille attablée.
“ Émilie Charron, dit-elle alors, tenez-vous droite, à moins que vous ne vouliez absolument devenir bossue… Et vous, Sophie Bellanger, que je ne vous surprenne plus à mettre vos coudes sur la table… ”
Mais la bonne vieille grondait mal. Au milieu de ses élèves, en ce repas de Noël, — son meilleur jour de l’année, — le contentement éclatait dans ses petits yeux noirs, sur ses joues vermeilles ; et sa voix, qu’elle essayait vainement de grossir, était indulgente jusqu’à la tendresse. […] »
La fête de Gervaise
Emile Zola,
L'Assommoir
« La fête tombait justement un lundi. C’était une chance : Gervaise comptait sur l’après-midi du dimanche pour commencer la cuisine. Le samedi, comme les repasseuses bâclaient leur besogne, il y eut une longue discussion dans la boutique, afin de savoir ce qu’on mangerait, décidément. Une seule pièce était adoptée depuis trois semaines : une oie grasse rôtie. On en causait avec des yeux gourmands. Même, l’oie était achetée. Maman Coupeau alla la chercher pour la faire soupeser à Clémence et à madame Putois. Et il y eut des exclamations, tant la bête parut énorme, avec sa peau rude, ballonnée de graisse jaune.
— Avant ça, le pot-au-feu, n’est-ce pas ? dit Gervaise. Le potage et un petit morceau de bouilli, c’est toujours bon… Puis, il faudrait un plat à la sauce.
La grande Clémence proposa du lapin ; mais on ne mangeait que de ça ; tout le monde en avait par-dessus la tête. Gervaise rêvait de quelque chose de plus distingué. Madame Putois ayant parlé d’une blanquette de veau, elles se regardèrent toutes avec un sourire qui grandissait. C’était une idée ; rien ne ferait l’effet d’une blanquette de veau.
— Après, reprit Gervaise, il faudrait encore un plat à la sauce.
Maman Coupeau songea à du poisson. Mais les autres eurent une grimace, en tapant leurs fers plus fort. Personne n’aimait le poisson ; ça ne tenait pas à l’estomac, et c’était plein d’arêtes. Ce louchon d’Augustine ayant osé dire qu’elle aimait la raie, Clémence lui ferma le bec d’une bourrade. Enfin, la patronne venait de trouver une épinée de cochon aux pommes de terre, qui avait de nouveau épanoui les visages, lorsque Virginie entra comme un coup de vent, la figure allumée.
— Vous arrivez bien ! cria Gervaise. Maman Coupeau, montrez-lui donc la bête.
Et maman Coupeau alla chercher une seconde fois l’oie grasse, que Virginie dut prendre sur ses mains. Elle s’exclama. Sacredié ! qu’elle était lourde ! Mais elle la posa tout de suite au bord de l’établi, entre un jupon et un paquet de chemises. Elle avait la cervelle ailleurs ; elle emmena Gervaise dans la chambre du fond.
— Dites donc, ma petite, murmura-t-elle rapidement, je veux vous avertir… Vous ne devineriez jamais qui j’ai rencontré au bout de la rue ? Lantier, ma chère ! Il est là à rôder, à guetter. Alors, je suis accourue. Ça m’a effrayée pour vous, vous comprenez.
La blanchisseuse était devenue toute pâle. Que lui voulait-il donc, ce malheureux ? Et justement il tombait en plein dans les préparatifs de la fête. Jamais elle n’avait eu de chance ; on ne pouvait pas lui laisser prendre un plaisir tranquillement. Mais Virginie lui répondait qu’elle était bien bonne de se tourner la bile. Pardi ! si Lantier s’avisait de la suivre, elle appellerait un agent et le ferait coffrer. Depuis un mois que son mari avait obtenu sa place de sergent de ville, la grande brune prenait des allures cavalières et parlait d’arrêter tout le monde. Comme elle élevait la voix, en souhaitant d’être pincée dans la rue, à la seule fin d’emmener elle-même l’insolent au poste et de le livrer à Poisson, Gervaise, d’un geste, la supplia de se taire, parce que les ouvrières écoutaient. Elle rentra la première dans la boutique ; elle reprit, en affectant beaucoup de calme :
— Maintenant, il faudrait un légume ?
— Hein ! des petits pois au lard, dit Virginie. Moi, je ne mangerais que de ça.
— Oui, oui, des petits pois au lard ! approuvèrent toutes les autres, pendant qu’Augustine, enthousiasmée, enfonçait de grands coups de tisonnier dans la mécanique.
Le lendemain dimanche, dès trois heures, maman Coupeau alluma les deux fourneaux de la maison et un troisième fourneau en terre emprunté aux Boche. Á trois heures et demie, le pot-au-feu bouillait dans une grosse marmite prêtée par le restaurant d’à-côté, la marmite du ménage ayant semblé trop petite. On avait décidé d’accommoder la veille la blanquette de veau et l’épinée de cochon, parce que ces plats-là sont meilleurs réchauffés ; seulement, on ne lierait la sauce de la blanquette qu’au moment de se mettre à table. Il resterait encore bien assez de besogne pour lundi, le potage, les pois au lard, l’oie rôtie. La chambre du fond était tout éclairée par les trois brasiers ; des roux graillonnaient dans les poêlons, avec une fumée forte de farine brûlée ; tandis que la grosse marmite soufflait des jets de vapeur comme une chaudière, les flancs secoués par des glouglous graves et profonds. Maman Coupeau et Gervaise, un tablier blanc noué devant elles, emplissaient la pièce de leur hâte à éplucher du persil, à courir après le poivre et le sel, à tourner la viande avec la mouvette de bois. Elles avaient mis Coupeau dehors pour débarrasser le plancher. Mais elles eurent quand même du monde sur le dos tout l’après-midi. Ça sentait si bon la cuisine, dans la maison, que les voisines descendirent les unes après les autres, entrèrent sous des prétextes, uniquement pour savoir ce qui cuisait ; et elles se plantaient là en attendant que la blanchisseuse fût forcée de lever les couvercles. […] Les sauces, sur les fourneaux garnis de cendre, mijotaient doucement ; la blanquette et l’épinée, quand maman Coupeau les découvrait, avaient un petit bruit, un frémissement discret ; le pot-au-feu gardait son ronflement de chantre endormi le ventre au soleil. Elles finirent par se tremper chacune une soupe dans une tasse, pour goûter le bouillon.
Enfin, le lundi arriva. Maintenant que Gervaise allait avoir quatorze personnes à dîner, elle craignait de ne pas pouvoir caser tout ce monde. Elle se décida à mettre le couvert dans la boutique ; et encore, dès le matin, mesura-t-elle avec un mètre, pour savoir dans quel sens elle placerait la table. Ensuite, il fallut déménager le linge, démonter l’établi ; c’était l’établi, posé sur d’autres tréteaux, qui devait servir de table. […]
Maman Coupeau et Gervaise parlèrent des Lorilleux, en mettant la table, dès trois heures. Elles avaient accroché de grands rideaux dans la vitrine ; mais, comme il faisait chaud, la porte restait ouverte, la rue entière passait devant la table. Les deux femmes ne posaient pas une carafe, une bouteille, une salière, sans chercher à y glisser une intention vexatoire pour les Lorilleux. Elles les avaient placés de manière à ce qu’ils pussent voir le développement superbe du couvert, et elles leur réservaient la belle vaisselle, sachant bien que les assiettes de porcelaine leur porteraient un coup.
— Non, non, maman, cria Gervaise, ne leur donnez pas ces serviettes-là ! J’en ai deux qui sont damassées.
— Ah bien ! murmura la vieille femme, ils en crèveront, c’est sûr.
Et elles se sourirent, debout aux deux côtés de cette grande table blanche, où les quatorze couverts alignés leur causaient un gonflement d’orgueil . ça faisait comme une chapelle au milieu de la boutique. »

Victor Gabriel Gilbert, La Fête de Papa.
Le repas de noces
Gustave Flaubert,
Madame Bovary, 1857
« Dans les visites que Charles faisait à la ferme, on causait des préparatifs de la noce, on se demandait dans quel appartement se donnerait le dîner ; on rêvait à la quantité de plats qu’il faudrait et quelles seraient les entrées.
Emma eût, au contraire, désiré se marier à minuit, aux flambeaux ; mais le père Rouault ne comprit rien à cette idée. Il y eut donc une noce, où vinrent quarante-trois personnes, où l’on resta seize heures à table, qui recommença le lendemain et quelque peu les jours suivants.
[…] C’était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. Il y avait dessus quatre aloyaux, six fricassées de poulets, du veau à la casserole, trois gigots et, au milieu, un joli cochon de lait rôti, flanqué de quatre andouilles à l’oseille. Aux angles, se dressait l’eau-de-vie, dans des carafes. Le cidre doux en bouteilles poussait sa mousse épaisse autour des bouchons et tous les verres, d’avance, avaient été remplis de vin jusqu’au bord. De grands plats de crème jaune, qui flottaient d’eux-mêmes au moindre choc de la table, présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesques de nonpareille. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses ; et il apporta, lui-même, au dessert, une pièce montée qui fit pousser des cris. Á la base, d’abord, c’était un carré de carton bleu figurant un temple avec portiques, colonnades et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d’étoiles en papier doré ; puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menues fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d’oranges ; et enfin, sur la plate-forme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écales de noisettes, on voyait un petit Amour, se balançant à une escarpolette de chocolat, dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturelle, en guise de boules, au sommet.
Jusqu’au soir, on mangea. Quand on était trop fatigué d’être assis, on allait se promener dans les cours ou jouer une partie de bouchon dans la grange, puis on revenait à table. Quelques-uns, vers la fin, s’y endormirent et ronflèrent. Mais, au café, tout se ranima ; alors on entonna des chansons, on fit des tours de force, on portait des poids, on passait sous son pouce, on essayait à soulever les charrettes sur ses épaules, on disait des gaudrioles, on embrassait les dames. Le soir, pour partir, les chevaux gorgés d’avoine jusqu’aux naseaux eurent du mal à entrer dans les brancards ; ils ruaient, se cabraient, les harnais se cassaient, leurs maîtres juraient ou riaient ; et toute la nuit, au clair de la lune, par les routes du pays, il y eut des carrioles emportées qui couraient au grand galop, bondissant dans les saignées, sautant par-dessus les mètres de cailloux, s’accrochant aux talus, avec des femmes qui se penchaient en dehors de la portière pour saisir les guides
Ceux qui restèrent aux Bertaux passèrent la nuit à boire dans la cuisine. Les enfants s’étaient endormis sous les bancs. »
Noël
au phare
des
Sanguinaires

Alphonse Daudet,
Nuit de Noël, « Contes d’Hiver », 1896
« Les premiers jours, il y eut de la méfiance. On me servait dans ma chambre, une chambre splendide, haute et vaste, aux lambris vernissés, et dont les trois fenêtres ouvraient sur la pleine mer ; mais, tout le temps de mon séjour, la tramontane m’obligea à tenir fermés les volets de fonte de deux de ces fenêtres, et la lumière m’arrivait du côté seul d’où ne venait pas le vent. Ces repas solitaires dans une pièce qui louchait m’ennuyèrent vite, et je demandai aux gardiens à manger avec eux. J’avais apporté des provisions, des conserves, une bonne eau-de-vie. Eux m’offraient des légumes secs, le poisson de Trophime, le provençal, très adroit pêcheur d’oursins et de rascasses. Dès le premier repas, la connaissance était faite.
Trois types très différents, ces gardiens, avec une passion commune : la haine. Ce qu’ils se haïssent tous les trois ! J’avais en arrivant commencé quelques vers restés inachevés sur la table de ma chambre. Dès le premier soir, le chef me prévint au moment de prendre la relève : “ Méfiez-vous de mes camarades, ne laissez rien traîner. ” Le lendemain, Bertolo m’en disait autant ; et le vieux Trophime, avec le sourire de Iago, m’engageait à garder sur moi la clef de ma chambre. C’est lui pourtant qui me paraît le moins enragé des trois. Il a des yeux de lézard, luisants et doux, une barbiche blanche inoffensive qui sautille si drôlement pendant qu’il chante ses motets provençaux. Très adroit cuisinier, sans rival pour l’aïoli et la bouillabaisse, il est toujours en quête de quelque fricot, il chasse, il pêche, cherche des œufs de gouaillesdans les roches et très exactement, matin et soir, fait le tour de l’île pour s’assurer si la mer n’a pas jeté d’épave bonne à prendre. Il a parfois des aubaines, entre autres un certain baril de rhum resté légendaire dans le phare. […]
Depuis quelque temps d’ailleurs, ce n’est pas seulement ce coin de l’île, mais l’île entière, et le phare, et la vie qu’on y mène, qui me semblent sinistres. Avec cette tramontane infernale, on ne peut plus pêcher. Plus de poisson, jamais de viande. Nous sommes réduits à ce qu’on appelle “ les vivres de la mer ”. Le phare en a pour six mois, la réserve ne risque donc pas de s’épuiser ; mais ce qui s’épuise, c’est ce que nous avions à nous dire. J’ai donné tous les renseignements possibles sur Caton d’Utique et Démétrius de Phalère ; je sais par cœur toutes les histoires de bandits, Quastana, Bellacoscia, que Bartolo nous raconte en hachant des feuilles de tabac frais dans le creux de sa main avec les grands ciseaux pendus à sa ceinture. Très animés d’abord, les repas sont redevenus silencieux comme avant mon arrivée. Les antipathies de ces pauvres gens, leurs crispations nerveuses commencent à me gagner. Je prends en dégoût celui-ci parce qu’il vient à table avec des mains sales, cet autre parce qu’il mange en broutant comme une vieille chèvre. J’en arriverai à la haine, moi aussi…
Aujourd’hui, le dîner a été particulièrement lugubre, on n’a pas échangé dix paroles, mais quels mauvais regards !… Est-ce l’approche de Noël, du Jour de l’An, de ces jolies fêtes de fin d’année ? Jamais je ne me suis senti le cœur angoissé comme ce soir. Dire que je regrette le Cercle d’Ajaccio ! Je voudrais voir des lumières, des nappes blanches, sortir d’ici enfin. Quand donc en sortirai-je ! Si la tramontane s’entête, j’y suis pour tout l’hiver… […]
… Onze heures sonnent à la grande horloge du phare. On entend un bruit de poids, de chaîne qui se dévide. Des pas lourds de sommeil traînent sur les dalles ; c’est la relève. La porte de la cuisine s’ouvre ; avant de monter prendre son quart, Bertolo entre boire à la bassine. […] Puis essuyant sa bouche rase avec la manche de son pelone, il ramasse sur la table la grosse pipe rouge et la lampe qu’il y a posées, et s’en va sur un “ bonné nouit, pinsouti (Français) ”, qui manque de mansuétude. Derrière lui, quand Dinelli, le gardien chef, après avoir signé le livre de bord, s’est enfermé à deux tours dans sa chambre, alors Trophime vient à moi, le doigt sur les lèvres, et me dit tout bas, avec des yeux farceurs, un rire silencieux qui fait danser sa barbiche de vieille chèvre : “ Nous aussi vieille chèvre : “ Nous aussi, nous arroserons la bûche de Noël… nous poserons cache-feu, comme on dit chez nous… vous allez voir… »
Il enjambe la fenêtre qui, de ce côté-là, se trouve de plain pied avec le rocher, et presque aussitôt il rapporte une racine de tamaris qu’il jette devant l’âtre. Puis il tire de l’armoire et pose à mesure sur la table trois flambeaux, des verres, une bouteille de Frontignan et un pain de Noël à l’anis, cuit exprès pour la circonstance ; tout cela d’un air de belle humeur, avec des clignements d’yeux, une mimique mystérieuse et enfantine qui m’amuse.
Maintenant, voilà les trois chandelles allumées, le pain de Noël doré et rebondi sur une assiette, et le Frontignan en rayon de miel dans nos deux verres. “ Minute ” dit Trophime, retenant mon bras au moment où je vais boire, et après avoir arrosé de vin blanc le pied de tamaris tordu comme un souquillonde vigne, il le jette dans le feu sur ces paroles sacramentelles : “ Allègre ! allègre ! que Notre Seigneur nous allègre ! Si l’an qui vient, nous ne sommes pas plus, mon Dieu, que nous ne soyons pas moins… bûche au feu, boutefeu ! ”
La bûche pétille et flambe jusqu’au plafond. Le vin d’or reluit dans nos verres, et nous trinquons à la Provence, en reprenant le Noêl qu’il chantait tout à l’heure, le défilé des rois mages devant la crèche de l’enfant Jésus. […]
Nos voix montent, sonnent sous les voûtes, et à mesure c’est dans tout mon être une douceur, une détente. Ces chansons, ce vin du pays… Je ne suis plus au phare des Sanguinaires, mais dans la cuisine d’un grand mas de Provence, aux murs crépis, au sol pavé de larges dalles. Dehors, au lieu des huées du vent et de la mer, je distingue très bien dans la nuit d’hiver le carillon et la messe de minuit. Je me figure, derrière les vitres allumées, les ombres qui passent et repassent. Des nuées d’étincelles montent des toits en fête et vont se perdre dans le ciel froid, criblé d’étoiles. Allègre ! allègre ! Que Notre Seigneur nous allègre !
La chanson est finie. Le vieux Trophime s’est levé, détendu lui aussi et rayonnant. Il taille une tranche de pain, du beau pain de Noël qui embaume l’anis et la pâte chaude, remplit à ras bords un verre de vin doré, pose le tout sur une assiette et clignant vers moi ses petits yeux bridés :
“ Dinelli dort trop bien pour qu’on le réveille, mais l’autre, le Bertolo, sa pipe lui donne soif… Je m’en vais trinquer avec lui… ”
Brave homme ! J’entends ses lourdes bottes monter le petit escalier, puis le vitrage de la lanterne qui s’ouvre, et des rires, des éclats de voix heureuses dont le phare n’a pas l’habitude. Ils boivent, là-haut ; faisons comme eux. Allègre ! allègre ! Sur le rocher des Sanguinaires, Noël a tué la haine, au moins pour toute une nuit. »

La bûche de Noël
Frédéric Mistral
Les Annales Politiques et Littéraires, 5 janvier 1896
« La plus grande fête pour nous était la veille de Noël. Ce jour-là, de bonne heure, les valets de charrue dételaient, ma mère leur donnait, à chacun, dans une serviette, une belle fouace à l’huile, une rouelle de nougat, une jointée de figues sèches, un céleri, et une bouteille de vin cuit, et qui d’ici et qui de là, tout ce monde gagnait les routes pour aller, comme on dit, poser la bûche au feudans son endroit, à sa maison. Au mas, il ne restait que les pauvres serviteurs qui n’avaient plus de famille ; et même, des parents à nous, quelque vieux garçon par exemple, arrivaient quelquefois à la tombée de la nuit en disant : “ Bonnes fêtes ! nous venons poser, cousins, la bûche au feu avec vous autres. ”
Tous ensemble, nous allions, joyeux, chercher la bûche — qui, toujours, devait être un tronc d’arbre fruitier — nous l’apportions dans la ferme, tous à la file, le plus âgé d’un bout, moi, le plus petit, de l’autre ; trois fois nous lui faisions faire le tour de la cuisine ; puis, arrivés devant la pierre du foyer, solennellement, mon père versait sur le tronc d’arbre un verre de vin cuit, en disant :
Allégresse ! allégresse !
Mes beaux enfants, que Dieu nous réjouisse !
Avec Noël tout bien arrive…
Dieu nous fasse la grâce de voir l’année qui vient,
Et à la Noël prochaine
Si nous ne sommes pas plus, puissions-nous ne pas être moins !
et nous crions tous : allégresse ! allégresse ! et l’on déposait alors l’arbre sur les landiers ; et sitôt que la flambée partait resplendissante :
Bûche bénie, boute feu !
disait mon père en se signant, et tous nous nous mettions à table.
O ! tablée sainte, vraiment sainte, avec, tout à l’entour, la famille complète, pacifique et heureuse ! Au lieu de la lampe romaine, pendue au lampadaire, qui dans le courant de l’année nous donnait sa clarté grêle, sur la table, ce jour-là, trois chandelles éclairaient… et si le lumignon, parfois en charbonnant, se tournait devers quelqu’un, c’était pris en mauvais augure. De chaque bout, dans une assiette, verdoyait une touffe de blé en herbe que, le jour de la Sainte-Barbe, on avait mis germer dans l’eau. Sur la grande nappe blanche apparaissaient, l’un après l’autre, les plats sacramentels, à savoir : les escargots, que chacun avec un long clou neuf tirait de la coquille ; la morue frite, la mugeaux olives, le cardon, la carde, le céleri à la poivrade, suivis d’une ribambelle de friandises pour dessert, comme gâteaux à l’huile, raisins secs, et nougat, et pommes de paradis ; puis, au-dessus de tout, le pain calendal, auquel on ne goûtait qu’après en avoir donné, religieusement, un quart au premier pauvre qui passait.
La veillée, en attendant la messe de minuit était longue ce jour-là ; et longuement autour du feu on parlait des ancêtres et l’on louait leurs actions. Mais, peu à peu et volontiers, mon brave homme de père revenait à l’Espagne et à ses souvenirs du Siège de Figuières. »
Un repas d'inauguration
E. T. A. Hoffmann,
Le Violon de Crémone, 1816
Jusqu’alors je n’avais guère parlé avec cet homme étrange ; il était à ce point absorbé par sa construction qu’il n’allait même plus chez le professeur M…, où il avait coutume de déjeuner chaque mardi ; quand celui-ci l’invita expressément à revenir, Krespel lui fit dire qu’il ne franchirait pas la porte de son jardin avant l’inauguration de sa nouvelle demeure. Tous ses amis, toutes ses connaissances espéraient qu’à cette occasion il organiserait un beau festin. Mais il n’avait invité que les maîtres compagnons, apprentis et manœuvres qui avaient construit sa maison. Il leur servit les mets les plus délicats. On vit des apprentis maçons manger avidement, et sans le moindre égard, des pâtés de perdrix ; de jeunes menuisiers raboter fort gentiment des faisans rôtis et des aides-maçons affamés réclamer les meilleurs morceaux de la fricassée de truffes. Vers le soir, on vit arriver leurs femmes et leurs filles et un grand bal commença. Krespel valsa un instant avec les femmes des contremaîtres, puis il se joignit aux musiciens de la ville, prit un violon et dirigea les danses jusqu’à l’aube.
Les préparatifs
d'un festin féerique
E. T. A. Hoffmann,
Casse-Noisette et le Roi des Rats, 1819
« Puis les dames accompagnèrent Marie et Casse-Noisette à l’intérieur du château, dans une salle dont les murs étaient faits de milliers de cristaux scintillants aux couleurs chatoyantes. Marie s’extasia surtout sur les ravissants petits secrétaires, chaises et commodes qui se trouvaient tout autour de la pièce et étaient tous en bois de cèdre ou de brésil et parsemés de fleurs d’or. Les princesses invitèrent Marie et Casse-Noisette à s’asseoir et dirent qu’elles allaient sans tarder préparer de leurs mains un festin.
Elles allèrent chercher une grosse quantité de petites marmites et de petits plats de la porcelaine japonaise la plus fine, ainsi que des cuillers, des couteaux, des fourchettes, des râpes, des casseroles et autres ustensiles qui tous étaient en or ou en argent. Puis elles rassemblèrent les plus beaux fruits et des sucreries si rares que Marie n’en avait encore jamais vu de pareilles et se mirent, le plus délicatement du monde, à presser les fruits de leurs jolies mains blanches comme neige, à broyer des assaisonnements, à râper des pralines, bref, à faire tant et si bien que Marie comprit à quel point les princesses étaient expertes en l’art de cuisiner et que ce festin serait des plus succulents.
Et, comme elle était intimement convaincue qu’elle-même s’entendait à merveille en cet art, elle se prit à désirer secrètement prendre part, elle aussi, à cette activité. Et il se trouva que la plus belle des sœurs de Casse-Noisette, comme si elle avait deviné ce secret désir, lui tendit un petit mortier d’or et lui dit :
“ Tendre amie, toi qui as sauvé la vie de mon frère, n’aimerais-tu pas piler un peu de ce sucre candi ? ”
Tandis que Marie, radieuse, frappait dans le mortier qui rendait un son joyeux et clair comme une fraîche chanson, Casse-Noisette racontait avec force détails l’horrible bataille que son armée avait livrée à celle du Roi des Rats, […]. »
Le buffet du bal
Giuseppe Tomasi de Lampedusa,
Le Guépard
« La valse finie, Angélique proposa à don Fabrice de dîner à la table qu'elle et Tancrède avaient choisie. Il n'eût pas demandé mieux, mais ses souvenirs de jeunesse vinrent lui rappeler à quel point un dîner en compagnie d'un vieil oncle lui semblait odieux, quand il aurait pu jouir de la présence de Stella. Les amoureux veulent être seuls, ou bien se perdre au milieu d'étrangers ; mais non rester avec des vieux, et qui pis est, des vieux de leur famille.
— Merci, Angéliqe, je n'ai pas faim. Je prendrai quelque chose debout. Va avec Tancrède ; ne vous occupez pas de moi.
Il attendit un peu que les jeunes gens se fussent éloignés, puis il pénétra à son tour dans la salle du buffet. Une table longue et étroite s'étendait au fond de la pièce, illuminée par les douze fameux candélabres de vermeil que le grand-père de don Diego avait reçus de la cour d'Espagne, après une ambassade à Madrid. Dressées sur de hauts piédestals de métal étincelant, six figures d'athlètes et six figures de femmes soulevaient au-dessus de leur tête la tige d'argent doré, couronnée par la flamme de douze bougies. L'habileté de l'orfèvre avait spirituellement exprimé la sereine aisance des hommes, la gracieuse lassitude des femmes, sous le poids que chacun supportait.
“ Qui sait combien d'hectares de terrain cela représente ! ” aurait dit le pauvre Sedara. Don Fabrice se souvint qu'un jour, Diego lui avait montré les écrins de ces candélabres, véritables montagnes de maroquin vert, portant, gravé sur leur flanc, l'écu d'or tiercé de Ponteleone et les chiffres enlacés des donateurs.
Au-dessous des candélabres, au-dessous des pièces montées pyramidales qui dressaient leurs cinq étages vers les plafonds lointains (on ne pourrait jamais les finir, comme d'habitude) s'étendait la monotone opulence des tables à thé des grands bals : corail des langoustes bouillies vivantes, cires et ivoires des chauds-froids de veau, acier des bars noyés dans des sauces épaisses, or des dindons rôtis au four, rose pâle des médaillons de foie gras sous leur cuirasse de gelée, ambre des bécasses désossées couchées sur des tumulus de pain grillé et décorées de leurs entrailles triturées ; rose aurore des galantines ; et mille autres délices colorées et cruelles. Aux deux extrémiés de la table, deux monumentales soupières d'argent contenaient un limpide consommé, topaze brûlé. Les maîtres queux, dans les vastes cuisines, avaient dû suer sang et eau depuis la veille au soir pour préparer le souper.
“ Sapristi ! que de choses… Donna Marguerite sait vivre. Mais il faudrait pour tout cela d'autres estomacs que le mien. ”
Il dédaigna les boissons qui se trouvaient à droite, sur une table luisante de cristaux et d'argent, et se dirigea vers la table aux pâtisseries. Là, s'offraient d'immenses babas alezans comme des robes de cheval, de neigeux monts-blancs de crème, des beignets Dauphin que les amandes diapraient de blanc et les pistaches de vert, des collines de profiteroles au chocolat, brunes et grasses comme l'humus de la plaine catanaise dont elles provenaient, d'ailleurs, après mille métamorphoses, des parfaits roses, des parfaits beiges, des parfaits champagne, qi s'effritaient en craquant lorsque la cuillère les entamait, les arpèges en majeur des griottes confites, les timbres acidulés des jaunes ananas, et enfin, “ triomphe de la gourmandise ”, d'impudiques gâteaux des Vierges, avec le vert opaque de leurs pistaches écrasées. Ce fut eux que choisit don Fabrice. Tandis qu'il les emportait sur une soucoupe, il avait l'air d'une caricature profane de sainte Agathe, exhibant ses seins coupés.
“ Comment diable le Saint-Office, alors qu'il le pouvait, ne pensa-t-il pas à interdire ces gâteaux ? Les “ triomphes de la gourmandise ” (la gourmandise, péché mortel !), les mamelles de sainte Agathe, vendues par les couvents, dévorées par les fêtards ! bah ! ”
Dans la salle odorante de vanille, de vins et de poudre de riz, don Fabrice errait à la recherche d'une place. […] »
(Les mots en taliques sont en français dans la version originale, en italien.)

Le Noël du petit joueur de violon
Camille Lemonnier,
Le Noël du petit joueur de violon
« Le pâtissier avait imaginé pour Noël une montre extraordinaire. Des cramiques étalaient leurs dos bruns piqués de raisins, laissant sortir par places la miche dorée ; et une pièce montée, superbe, avait la forme d’une tour. Cette tour, dont la base était en pâte de pouding, étageait trois rangs de galeries circulaires ; en haut de la dernière, parmi les fruits confits qui brillaient sur le sucre de la coûte glacée, une petite femme en jupe blanche, posée sur l’orteil du pied gauche, haussait en l’air sa jambe droite en ouvrant les bras comme si elle allait s’envoler. Puis des meringues soulevaient, non loin de la tour, leur écume figée au milieu de laquelle deux cerises et une prune semblaient des îlots battus par les flots. Contre la vitre, de grandes couques hérissées de drapeaux en soie rouge et bleue et de plumes frisées posaient debout, à côté d’hommes en spikelaus et en biscuit, qui avaient l’air de dire bonjour aux passants. Il y avait aussi des assiettes remplies de dragées, de pralines au chocolat, de fondants, de sucres de couleur, de caramels, mais la plus belle chose était certainement la tour aux trois étages, à cause de sa hauteur et de ses fruits.
Le petit vagabond s’arrêta longtemps devant ces merveilles, n’ayant jamais rien vu d’aussi beau. Il se baissait, se haussait, se penchait à droite, se penchait à gauche, faisait avec son haleine des trous dans le givre des vitres, pour mieux voir. Et tantôt il sautait sur une jambe tantôt sur l’autre, frappant ses vieilles semelles sur le trottoir et chantant entre ses dents un air de son pays. Doucement il passa le bout de sa langue sur la vitre et lécha le givre à petits coups, croyant lécher les confitures.
Le pâtissier s’aperçoit tout à coup qu’il y a quelqu’un derrière sa vitrine et il fait un geste de colère. Le petit joueur se sauve alors ; mais le boulanger, lui aussi, a fait de grands hommes en spikelaus, des cramiques de fine farine, des couques en forme d’oiseau, avec des plumes et des drapeaux. Et l’enfant s’arrête de nouveau, regarde ces belles choses avec le désir d’en manger.
Il n’a pris, depuis le matin, pour toute nourriture, qu’un petit pain de deux sous et une tranche de foie. À la fin il se décide, pousse la porte vitrée du maître mitron, montre du doigt les bonshommes qui sont à la vitrine, et parmi ceux-là le plus beau. Mais la boulangère appuie le pouce de sa main droite sur la paume de sa main gauche, l’avertissant ainsi qu’il doit avant tout payer. Il tire son sou et le pose sur le comptoir.
La méchante femme hausse alors les épaules et lui dit d’une voix aigre :
— Avez-vous pensé vraiment, petit drôle, que vous auriez ce grand bonhomme pour un sou ?
Puis elle prend le sou, le tourne dans ses doigts et lui donne un petit pain blanc, le plus sec de la fournée.
Comme c’est bon, du pain ! Il l’avale en quelques coups de dents et porte ensuite sa main à sa bouche pour y ramasser les miettes roulées dans les coins. »



Tombeau du roi de la fève
Anonyme,
Les Fleurs des plus excellents poètes de ce temps (1601)
« Ici gît dessous ce tréteau
Un roi de fève et de gâteau,
Roi certes, ô étranges merveilles,
De brocs, de flacons, de bouteilles,
De pâtés, boudins et lardons,
Qui fut roi l’an des grands pardons :
Roi merveilleux et qui, en somme,
Buvait et mangeait comme un homme.
Mais aussi bien que leurs sujets,
Les rois sont à la mort sujets.
Et les dieux n’arrêtent à croître :
C’est pourquoi ce roi se vit naître
Et mourir presqu’à même instant,
Après qu’il eut trinqué d’autant.
Je dis mourir d’autant qu’un prince
Est bien mort qui perd sa province :
Témoin le roi du Portugal :
Ma foi, c’est un bien fâcheux mal
D’entendre chanter devant l’heure
Que le ciel ordonne qu’on meure,
Comme sur un corps trépassé
Son resquiescat in pace.
Or nul tombeau plus convenable
Que ces tréteaux et cette table,
Pour lui ne se pouvait choisir :
Lui qui n’eut onc autre plaisir
Tant qu’il régna sinon de boire
Et faire danser la mâchoire,
Bref qui fut roi de tant de mets :
Dieu veuille qu’il y soit en paix
Et que chien ni chat n’en approche
De peur qu’ils mettent leur dent croche
Dessus ce bon roi de lardons
Qui mourut l’an des grands pardons :
Dessus ce beau roi de marmites,
De broches et de lèchefrites,
Dessus ce bon roi de gâteau
Qui repose sous ce tréteau.
Donc sur lui versons ces reliques
Suivant les coutumes antiques
Des Gaulois sur qui l’on jetait
Tout ce qui plus cher leur était.
Versons-y ces brocs et ces tasses,
Ces pots et ces écuelles grasses :
Afin au moins qu’après sa mort
Ce lui soit quelque réconfort :
Prions Dieu qu’il lui veuille faire
Dans le ciel aussi bonne chère,
Où les rois de Fève sont mis
Qu’il fit naguère à ses amis. »
De bouffonnes archives
Honoré de Balzac,
Un début dans la vie, 1822
« Aujourd’hui lundi, 25 novembre 1822, après une séance tenue hier rue de la Cerisaie, quartier de l’Arsenal, chez madame Clapart, mère de l’aspirant basochien, Oscar Husson, nous, soussignés, déclarons que le repas de réception a surpassé notre attente. Il se composait de radis noirs et roses, de cornichons, anchois, beurre et olives pour hors-d’œuvre ; d’un succulent potage au riz qui témoigne d’une sollicitude maternelle, car nous y avons reconnu un délicieux goût de volaille, et, par l’aveu du récipiendaire, nous avons appris qu’en effet l’abatis d’une belle daube préparée par les soins de madame Clapart avait été judicieusement inséré dans le pot-au-feu fait à domicile avec des soins qui ne se prennent que dans les ménages.
Item, la daube entourée d’une mer de gelée, due à la mère dudit.
Item, une langue de bœuf aux tomates qui ne nous a pas trouvés automates.
Item, une compote de pigeons d’un goût à faire croire que les anges l’avaient surveillée.
Item, une timbale de macaroni devant des pots de crème au chocolat.
Item, un dessert composé de onze plats délicats, parmi lesquels, malgré l’état d’ivresse où seize bouteilles de vins d’un choix exquis nous avaient mis, nous avons remarqué une compote de pêches d’une délicatesse auguste et mirobolante.
Les vins du Roussillon et ceux de la côte du Rhône ont enfoncé complètement ceux de Champagne et de Bourgogne. Une bouteille de marasquin et une de kirsch ont, malgré du café exquis, achevé de nous plonger dans une extase œnologique telle, qu’un de nous, le sieur Hérisson, s’est trouvé dans le bois de Boulogne en se croyant encore au boulevard du Temple ; et que Jacquinaut, le petit clerc, âgé de quatorze ans, s’est adressé à des bourgeoises de cinquante-sept ans, en les prenant pour des femmes faciles, dont acte.
Il est dans les statuts de notre ordre une loi sévèrement gardée, c’est de laisser les aspirants aux privilèges de la Basoche mesurer les magnificences de leur bienvenue à leur fortune, car il est de notoriété publique que personne ne se livre à Thémis avec des rentes, et que tout clerc est assez sévèrement tenu par ses père et mère. Aussi constatons-nous avec les plus grands éloges la conduite de madame Clapart, veuve en premières noces de monsieur Husson, père de l’impétrant, et disons qu’il est digne des hourras qui ont été poussés au dessert, et avons tous signé. »
Mangeons !
Victor Hugo
Mangeront-ils ?
Cette comédie en deux actes et en vers, parue dans le recueil Théâtre en Liberté en 1886, fut représentée pour la première fois en 1907 au Théâtre royal du parc de Bruxelles.
« Aïrolo.
[…]
Qu’on me dresse une table
Copieuse, insensée, aimable, délectable,
Je veux manger. Manger énormément.
Le roi.
Bravo !
Mangeons. Á la bonne heure !
Aïrolo.
Ayez du bœuf, du veau,
Du mouton, du chapon, tout l’idéal !
Le roi.
J’abonde !
Aïrolo,
aux soldats, aux valets et aux courtisans au fond du théâtre.
Servez !
Le roi leur fait signe d’obéir.
Aïrolo.
Que le gibier, peuplade vagabonde,
S’abatte tout roti dans des assiettes d’or !
Donnez tous vos oiseaux, de la grive au condor,
De quoi faire au seigneur Polyphème une tourte,
Bois où j’ai vu courir Diane en jupe courte !
Que les monstres exquis nageant au gouffre amer
Viennent, et pour la sauce abandonnent la mer !
Qu’un vin pur fasse fête aux poulardes friandes !
Et que de cet amas de fricots et de viandes,
Du chaudron qui les bout, du fourneau qui les cuit,
Il sorte une fumée assez épaisse, ô nuit,
Pour aller dans le ciel rougir les yeux des autres !
Au roi.
Vous n’épargnerez point les doublons et les piastres
Pour m’offrir dès ce soir un festin réussi.
Le roi.
Voilà ce que j’appelle un bon vivant ! Merci ! »
Copyright Annie Perrier-Robert. © Tous droits réservés.
Ajouter un commentaire
Commentaires